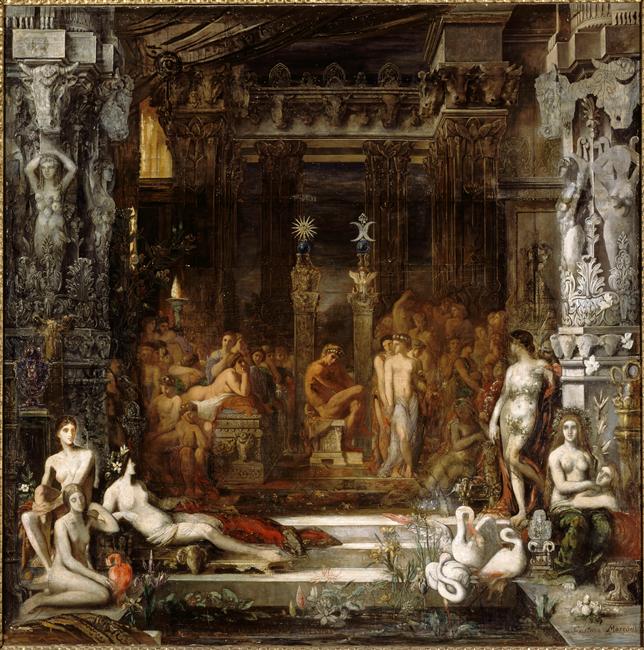Le héros s’appelle André, avec un A comme Andrée. Le premier chapitre exigeait que les deux héros portent le même prénom, au genre près. Par ailleurs, Andrée est le premier personnage féminin à s’insinuer dans le cœur d’André, l’auteur a donc choisi un prénom qui commence par A. Vous allez vite comprendre qu’il n’y a rien à comprendre.
Loin de moi l’idée de comparer André à Hercule qui enfanta les cinquante filles du roi Thespios, croyant rencontrer la même fille chaque nuit. Mais n’est-ce pas toujours la même fille qui se cache derrière toutes celles qu’a rencontrées André ? Ce serait trop simple.
Je ne voudrais pas me vanter mais j’en ai déçu plus d’une, a coutume de dire André plaisamment. Les cinquante portraits qui suivent font le tour de sa question, sans autre réponse que celle que voudra bien apporter le lecteur en même temps que sa chaise pliante. André n’est sûr que d’une chose : sa faiblesse est sa seule force.
André est un homme à cheval sur le vingtième et le vingt-et-unième siècle. Mais vous savez ce qu’on dit : profite de la première moitié de ta vie, la seconde sera plus courte.
Assez peu de mensonges dans ce récit, un peu de dissimulation tout de même – il arrive que l’âme flanche – et de l’imagination aussi. André ne dit pas tout. C’est un pudique. Surtout, André ne sait pas tout et il se la raconte un peu.
Voici donc les pérégrinations sentimentales d’André, une personne singulière qui, mieux que personne, vous les racontera à la première personne du singulier, de ses premiers émois à son premier mariage. Mais avant de vous jeter sur la camelote, voici quelques définitions qui vous aideront à entretenir la confusion dans votre esprit.
Alors, biographie fictive, exofiction ou autofiction ? C’est une affaire de marketing. La seule chose qu’on peut affirmer, c’est qu’il ne s’agit pas d’une hagiographie. La forme tient du journal pour la chronologie, des Mémoires pour le choix d’un thème, de l’exofiction pour l’absence de revendication autobiographique. Appelons cela un roman.
Recette de ce type de récit
- Choisir le point de vue du héros et la première personne du singulier pour donner de la véracité à l’ensemble
- Recueillir et transformer en récits romancés, voire romanesques, des souvenirs personnels, des souvenirs d’amis, de proches, des faits divers
- Ajouter des récits inventés de toute pièce
- Fusionner ou éclater certains récits
- Ordonner ces récits et construire une chronologie cohérente
- Créer des passerelles entre les différents récits
- Modifier les lieux et assurer leur cohérence
- Modifier les prénoms en imposant une règle (ici alphabétique) : amusez-vous à retrouver la signification des prénoms dans les textes
Bibliographie amoureuse
Bibliographie
- La chair est triste hélas (2023) OVIDIE [triste]
- les mots du Q – Manifeste joyeux des sexualités (2023) Camille AUMONT CARNEL [joyeux]
- Le voyage dans l’est (2021) Christine ANGOT [bouleversant]
- Free love (2021) Tessa Hadley [style]
- Mon mari (2021) Maud VENTURA [distrayant]
- Dîner à Montréal (2019) Philippe BESSON [style]
- Arcadie (2018) Emmanuelle BAYAMACK-TAM [style et souffle]
- Leurs enfants après eux (2018) Nicolas MATHIEU [style et souffle]
- Conversations entre amis (2017) Sally ROONEY [moderne]
- Les messieurs (2016) Claire CASTILLON [dérision]
- En attendant Bojangles (2016) Olivier BOURDEAUT [émotion]
- Heureux les heureux (2013) Yasmina REZA [acuité]
- La Chapelle Sextine (2011) Hervé LETELLIER [ludique]
- Je m’attache très facilement (2007) Hervé LETELLIER [style]
- Gemma Bovery (1999) Posy SIMMONDS [acuité]
- Positions sur l’amour (1997) Lionel KOECHLIN [chroniques de relations amoureuses écrites dans un style qui rend jaloux. Si vous n’arrivez pas à trouver cet ouvrage, certains de ces textes sont ressortis en 2021, illustrés en BD, c’est toujours ça : ISBN 978-2-36206-061-8 (20€)]
- Fuck up (1991) Arthur NERSESIAN [sincère]
- Mon propre rôle (1991) Serge Gainsbourg
- L’Amant (1984) Marguerite DURAS [sentimental]
- Vénus érotica (1977) Anaïs Nin
- Les girls du City-Boum-Boum (1975) Vassilis ALEXAKIS [désinvolte]
- Les Années Lula (1968) Serge REZVANI [passionné]
- Marelle (1963) Julio CORTAZAR [onirique]
- La centaine d’amour (1959) Pablo Neruda
- Lolita (1955) Vladimir NABOKOV [grand style]
- Bonjour tristesse (1954) Françoise SAGAN [désenchanté]
- Le pur et l’impur (1932) COLETTE [mystèrieux]
- Les Enfants terribles (1929) Jean Cocteau
- Le Blé en herbe (1923) Colette [sensuel]
- Le Diable au corps (1923) Raymond Radiguet [grand style]
- Le Grand Meaulnes (1913) Alain FOURNIER [magique]
- L’éducation sentimentale (1869) Gustave FLAUBERT [fataliste]
- Les Fleurs du mal (1857) Charles Baudelaire
- Madame Bovary (1856) Gustave FLAUBERT [grand style]
- Splendeur et misère des courtisannes (1838) BALZAC [la suite du précédent]
- Les illusions perdues (1837) Honoré de BALZAC [épicurisme épique]
- Justine ou les Malheurs de la vertu (1791) SADE [polémiquemiquemique]
- La Folle journée, ou le Mariage de Figaro (1778) Beaumarchais [fou]
- Le Jeu de l’amour et du hasard (Théâtre 1730) Marivaux [jubilatoire]
- Dom Juan ou le Festin de Pierre (1682) Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière
- Phèdre (1677) Racine
- Le Cid (1637) Corneille
- Le Songe d’une nuit d’été (1595) William Shakespeare
- Tristan et Iseut (XIIe siècle)
- Œdipe roi (430 av. J.-C.) Sophocle
- L’Odyssée (fin du VIIIe siècle av. J.-C.) Homère
Sommaire
AMITIE (T)
PHANTASME (P)
FLIRT (F)
AMOUR (A)
Andrée
J’ai rencontré ma cousine Andrée, trois fois dans ma vie. À chaque fois j’avais éprouvé le même émerveillement devant sa beauté maximale. Pourtant, à chaque nouvelle rencontre, j’avais dû admettre contre toute attente qu’elle avait encore gagné en charme et en attrait. Physiquement, j’avais toujours un train de retard, la croissance des garçons étant plus lente que celle des filles.
Sa mère s’appelait comme la mienne – toutes deux répondaient au sobriquet d’après-guerre de Gaby – et j’avais remarqué avec horreur que mon père n’était pas indifférent à ses appâts. Andrée était la fille du fils de l’oncle maternelle de mon père. Une cousine issue de germain, si j’ai bien compris. Mais pour moi, c’était ma cousine. C’est d’ailleurs ainsi qu’on me l’avait présentée.
La première fois, ma famille avait rendu visite au cousin paternel. Ils louaient un pavillon avec jardin, au bout d’une allée privative mal entretenue. Les grillages étaient doublés de palissades en canis qui donnaient un charme provincial à cet endroit dont on conjecturait qu’on y vivait au-dessus de ses moyens. Andrée, son petit frère et moi avions joué avec un vélo Solex trop grand pour nous, jusqu’à tard dans la soirée. Il se dégageait de tout cela, un parfum de fantaisie et de liberté qui avait bouleversé mes sens et mis un grand coup de pied dans mon imaginaire. Puis il avait fallu faire ses adieux et je dû ne rien laisser paraître de mon déchirement. C’était une cousine, voilà tout.
La deuxième fois, nous les avions accueillis dans cette maison que mes parents avaient construite avec la rage de ceux qui n’ont rien et qui ne comptent que sur eux-mêmes. La déco intérieure était d’un mauvais goût très sûr que même le manque de moyens n’avait su endiguer. Mais le plus moche des fauteuils n’aurait pu atténuer la splendeur de l’adolescente qu’Andrée était devenue. Nous avions joué au ping-pong dans la cour. Il y avait trop de vent. Je n’avais rien à offrir mais j’aurais tout donné pour un effleurement. Puis ils sont montés dans leur automobile et sont repartis en disant du mal de nous. Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées, s’était exclamé mon camarade Arthur.
Je l’ai revue une dernière fois à l’occasion de ses fiançailles. Elle était affreusement belle. Le prétendant, un blondinet au cheveu fou, faisait un numéro bien rôdé de tête brulée, assisté d’une bande de potes. En arrivant devant l’orchestre, il avait arraché son manteau et sa veste qu’il avait abandonnés entre les mains de son écuyer pour prendre d’assaut l’estrade et remplacer le batteur. En milieu de soirée, mon père déambulait au bras de la maîtresse de maison à moitié soule qui l’appelait « mon petit Jean-Phi ». Andrée et sa cour avaient quitté ce barnum assez tôt, pour continuer la soirée autre part. Je restai avec ma déconfiture sentimentale, mes illusions perdues, ma solitude envahissante.
Quelques mois plus tard, lorsque l’oncle de mon père me prêta une chambre de bonne, au dernier étage de son immeuble, pour que je mette fin dans de bonnes conditions à cette première année de médecine que j’allais consacrer à tordre le cou aux derniers espoirs que ma famille avait placés en moi, je m’aperçus avec stupeur, au cours d’une de ses visites, que le fils prodigieux avait les yeux noirs alors que son père et sa mère avaient les yeux aussi bleus que les lacs des montagnes suisses dont ils étaient descendus jadis. Fort de mes nouvelles connaissances en génétique, je déduisis qu’il ne pouvait y avoir aucune consanguinité entre Andrée et moi. Mais il était trop tard pour échafauder des stratégies matrimoniales.
Des années plus tard j’appris que mon grand-cousin, qui travaillait à la comptabilité d’une association caritative, avait fait de la prison pour avoir détourné des sommes considérables, peut-être dans le but de satisfaire les exigences d’une famille demandeuse.
La dernière fois que j’entendis parler de cette famille, il était question de divorce et de haine féroce. La mère avait ligué les enfants contre leur père et, à la mort du grand-père, avait séquestré la grand-mère pour garder la mainmise sur un patrimoine immobilier. À quelques temps de là, la grand-mère décéda et fut enterrée sans que son fils n’en fût averti.
Pour ne pas céder à la mélancolie, il me plut d’imaginer qu’Andrée était ma demi-sœur. Après tout, sa mère, mon père et son cousin se connaissaient bien avant notre naissance, ils sortaient ensemble et, des années plus tard, mon père était encore sensible à l’affection que lui portait Gaby… Non l’autre. Le facteur sonne toujours deux fois. Dans le doute, je me dis finalement qu’André et Andrée ça aurait fait bizarre sur un livret de famille, non ?
Bernadette
Bernadette était ma voisine. À l’époque, notre maison n’était qu’un trou dans la terre sablonneuse, à la périphérie de cette ancienne aspergeraie qu’une municipalité encore très rurale avait transformée en lotissement. Son père, un petit homme au cheveu dru et gris, était marié à une grande femme élégante, discrète et gentille que je trouvais très belle. Cette alliance constituait un mystère qui échappait à mon entendement de petit garçon de sept ans. Ils avaient trois filles, Bernadette était l’ainée. Nous avions approximativement le même âge. Heureusement, elle avait hérité du physique de sa mère. Avait-elle les yeux marrons ou bleus ? Ce n’est pas important.
Nous passions nos journées à jouer au bord du trou, notre timidité commune s’accommodant de silences qui pouvaient durer des après-midis entières. Je n’ai pas souvenir d’avoir jamais été méchant avec elle. Je pensais que son père avait les cheveux gris parce qu’il était plâtrier. C’était un teigneux. Mon père était son seul ami. Il avait installé dans son grenier une plateforme de trains électriques, avec des décors et des tunnels. Il était le seul à avoir le droit d’entrer dans ce local où il s’enfermait des heures durant, tel un Barbe Bleue de province. Il frappait Bernadette quand elle rapportait son bulletin scolaire. C’était la seule contribution qu’il pouvait offrir.
Comme ses parents, Bernadette n’était pas douée pour les études. Nous parcourrions ensemble le chemin qui nous séparait de l’école. Je passais l’attendre devant sa jolie maison et nous partions main dans la main. Lorsqu’on ne pouvait plus nous voir depuis la fenêtre de la cuisine, nous nous lâchions la main pour ne pas être la risée des enfants du village, une bande de sauvageons agressifs et dégénérés, tous cousins, dont les parents étaient alcooliques depuis des générations. Bernadette avait deux ans de retard mais la plupart des enfants du village en avaient davantage. Tous étaient des enfants battus qui ne pensaient qu’à se bagarrer, excepté lorsqu’ils se liguaient contre un bouc émissaire. Jean-Louis et moi étions dans la cible. Nous étions tous deux de complétion chétive – on me surnommait cannes de serein – et tous deux étions des étrangers. Jean-Louis était plus petit mais plus malin que moi. Lors des passages à tabac, il gardait un sourire obscène qui finissait par troubler ses tortionnaires. Il habitait à l’autre bout du lotissement, dans une famille d’accueil.
Bernadette grandissait plus vite que moi et le collège nous sépara.
Dix ans plus tard, ma mère me donna de ses nouvelles. Elle était devenue belle comme sa mère, Jean- Louis était resté petit, comme le père de la jeune-fille. Bernadette et Jean- Louis s’étaient mariés. Il trempait dans différents trafics, voitures, drogues, on ne savait pas trop. Il avait fait de la prison. Tout le monde disait qu’il ne la méritait pas. Il l’avait maltraitée. Il l’avait fait souffrir. Bernadette était fragile mais ne manquait pas de courage. Elle avait fini par échapper au pervers narcissique qu’était devenu le petit Jean-Louis mais elle restait murée dans une dépression qui faisait craindre le pire.
J’aurais voulu l’aider. Mais je ne la connaissais pas. Je serais allé la trouver, j’aurais dit, bonjour, c’est André, ton petit voisin, nous jouions au bord du trou, tu te rappelles ? Alors elle aurait fondu en larmes en tombant dans mes bras, criant entre deux sanglots qu’elle m’avait toujours aimé, qu’enfin nous allions pouvoir vivre heureux. Non, je me voyais mal m’embarquer dans un sauvetage psychosocial, je n’avais pas les épaules, j’étais trop lâche, trop égoïste, trop misérable. Je voulais oublier ce passé lugubre et me frayer un chemin entre les racines vivaces qui s’en échappaient comme les doigts d’une main clouée vive.
Camille
Camille fut mon premier coup de foudre. Ce fut aussi le dernier, comme si l’intensité de sa déflagration avait épuisé en une seule fois tout mon potentiel émotionnel. Je venais d’entrer en sixième après un été laborieux passé à faire des dictées avec ma mère, ce qui m’avait permis de franchir le mur des cinq fautes et de réussir l’examen d’entrée. Camille était au CM2 mais nous partagions, à certains horaires, la même cour de récréation.
À l’occasion d’un charivari autour d’un garçon qui était la coqueluche des filles de l’établissement, nous nous étions retrouvés à quelques centimètres l’un de l’autre et sa sauvagerie, ses pommettes saillantes, la blancheur de ses joues, le parfum de sa longue chevelure noire m’avaient littéralement cisaillé le cœur. Un flux de chaleur m’avait parcouru de bas en haut et m’avait laissé tétanisé, sans voix, les yeux écarquillés. Elle portait ce jour-là une robe à larges carreaux bleus et blancs, un motif qui tapisserait longtemps un pan entier de ma mémoire. Hélas, j’étais encore trop jeune pour que mon taux de dopamine s’envolât et me poussât à lui adresser le moindre mot. Mon appréhension avait gardé la consistance un peu rugueuse de la peau des grands squales empaillés du Jardin des Plantes.
Pendant deux ou trois ans, sans jamais nous parler, nous avions nourri de regards furtifs, d’attentes vaines et de rêveries, un sentiment bouleversant, réciproque, passionné et sans issue. Nous n’habitions pas le même village et je n’étais pas dégourdi pour un sou. Elle était la femelle alpha d’un petit groupe de filles qui me considéraient d’un œil malicieux et distant.
Des années plus tard, j’étais en classe préparatoire, je la vis monter dans un car scolaire qu’elle ne prenait pas habituellement à cette heure-là. Durant tout le voyage, elle était restée debout à discuter avec le chauffeur. Je n’en revenais pas, Camille faisait partie de ces filles qui discutaient avec les chauffeurs de bus. Un embonpoint naissant boudinait la fillette vive de mes souvenirs. Par moment, à travers le brouhaha, sa voix nasillarde se frayait un chemin jusqu’au fond du car. Elle avait coupé sa chevelure. Je ne pouvais oublier l’émoi qui m’avait submergé sept ans plus tôt.
Danièle
Paul était mon ami en classe de 5e. Nous étions souvent installés côte à côte et passions ensemble toutes nos récréations. Vers la fin de l’année, il m’avait invité chez lui. Il habitait une ferme à une douzaine de kilomètres de chez moi. Je faisais le trajet à bicyclette.
Paul était un garçon de petite taille à tête ronde, mignon et souriant. Il échappait au harcèlement depuis la primaire grâce à une rumeur tenace qui faisait de lui un expert en ju-jitsu.
Sa mère était accueillante et d’humeur joviale, fine, le cheveu noir. Elle avait autre chose à faire que surveiller Paul et ses deux sœurs. Nous jouissions d’une liberté totale dans cette ferme dont les différents corps s’organisaient autour d’une immense cour carrée entièrement close. Le village comptait peu d’habitants. Ils étaient plusieurs céréaliers de la même famille à se partager le territoire de ce plateau du Gâtinais.
Au risque de provoquer des affaissements, nous passions des heures à fabriquer des passages secrets dans le hangar où était stockées les bottes de paille. Nous étions perchés à des hauteurs vertigineuses, à l’abri des regards indiscrets du personnel agricole.
L’après-midi, nous étions sortis nous promener dans le parc du château dont il ne restait qu’un vieux colombier et quelques ruines. Marc, un ami du village, s’était joint à nous. Je le considérais comme un imbécile heureux mais il fit preuve d’une authentique camaraderie et je fus amené à réviser le jugement que je portais sur lui.
Soudain, alors que nous suivions Paul à la queue leu-leu sur un ancien parapet, nous entendîmes celui-ci crier de sa voix en mue, on la connait ta chatte, Danièle, on la connaît. Tant la voix que le propos avaient de quoi surprendre dans la bouche de ce garçon aux traits enfantins. Danièle, qui me précédait, se retourna vers moi l’air gênée. Je la rassurai d’un sourire bienveillant. C’était une jolie brune très féminine qui participait à nos jeux avec ferveur et témérité, entrainant sa petite sœur dont elle avait la charge et qui ne la quittait pas d’une semelle, tâchant de l’imiter en tout avec une confiance aveugle.
En fin d’après-midi, nous regagnâmes notre palais de paille, chargés de victuailles que la mère de Paul nous avait préparées. Nous formions un demi-cercle devant les deux filles qui s’étaient installées un peu plus haut sur des bottes de paille. Danièle s’était fait prier un bon quart d’heure avant d’ôter son short. Sa petite sœur avait fait de même, sans comprendre la nature de l’opération. Danièle semblait rompue à ce genre d’exercice. Accroupie dans ses tennis blanches, elle continuait de manger des chips, écartant de temps en temps les genoux pour garder son équilibre sur la botte de paille. Sa position mettait en valeur ses formes rondes et moulait sa chatte charnue dans sa petite culotte. Les garçons bandaient comme des ânes.
Marc m’appela par mon prénom comme si nous étions des amis d’enfance. Son jean était largement dégrafé. Il me montra son pénis raide qu’il avait emballé dans son slip bleu marine, serrant le tissu à la base du membre dans un anneau formé par son pouce et son index. Paul exhortait sa sœur à ne pas se faire prier. À force d’insistance, Danièle finit par écarter la pièce de coton blanc pour faire apparaître sa fente glabre. Sa petite sœur fit passer sa lèvre inférieure pardessus sa lèvre supérieure en roulant des yeux et imita sa sœur. Le spectacle fut de courte durée mais nos cerveaux avaient emmagasiné suffisamment d’images pour nourrir des après-midis entières de masturbation. C’était la première fois que je voyais le sexe d’une fille. L’odeur de la paille serait pour moi définitivement associée à la fente des filles.
En rentrant chez-moi ce soir-là, je me demandais sur ma bicyclette, si ça se passait de la même façon dans les grandes cours carrées des autres fermes fortifiées de la région, si toutes les sœurs devaient montrer leur sexe à leurs frères et leurs amis, si les filles du Gâtinais éprouvaient autant de plaisir à montrer leur sexe que nous en prenions à le regarder.
Émilie
Quand j’étais jeune adolescent, comme la plupart des Français, mes parents, mon frère et moi passions nos vacances toujours dans le même camping. Le nôtre se trouvait au bord du lac d’Hourtin, sur la côte landaise. Cette année-là, j’étais arrivé avec une passion toute neuve : le jeu d’échec. Mon père avait entrepris de m’apprendre les règles du jeu des rois. Me sentant demandeur il était revenu un soir avec le Bréviaire des échecs de Tartakover. J’avais avalé le manuel et m’étais fait détester de tout le voisinage, y compris des membres de ma famille. J’étais depuis, étonné par le nombre d’hommes fascinés par ce jeu auquel d’évidence ils ne comprenaient pas grand-chose.
Alors que je faisais une partie devant la tente avec mon père dont je dissuadais chacune des tentatives, notre voisin, un jeune adulte célibataire au crin noir, un peu dégarni, s’était approché de notre table et, après quelques aimables banalités, m’avait invité à faire une partie avec lui. Il portait les mêmes affreuses espadrilles en plastique transparent que nous. Ravi de pouvoir échapper à mes humiliations, mon père m’avait joyeusement congédié avec le secret espoir que je trouvasse enfin mon maître.
Partie après partie, une sorte d’amitié complice avait fini par nous lier. Je parvenais à me faire battre de temps en temps afin d’entretenir cette relation de bon voisinage. Bien m’en pris. Passionné de voile, mon adversaire possédait un quat’vingt et nous décidâmes de faire du dériveur ensemble. Sa présence m’encourageait à aller plus au large, là où les creux pouvaient atteindre un mètre par vent fort. Ce compétiteur mettait un point d’honneur à gratter mon quat’soixante-dix pourvu d’une voilure plus généreuse. Mes sorties sur l’eau avaient pris des allures de régate qui me réjouissaient au plus haut point.
Lors d’une partie d’échec de santé, il m’informa qu’il avait rencontré son boss au bloc sanitaire. La nouvelle me mit mal à l’aise. Allait-il plier bagage pour échapper à la présence de son supérieur hiérarchique ? L’expression suffisait à me tordre les boyaux. Ce n’était vraiment pas de chance. Mais il m’apprit que son chef était sympa et, comme nous, passionné de jeu d’échec. Nous étions invités à passer à sa caravane pour une rencontre amicale.
L’homme était un jeune buveur de bière légèrement bedonnant, grand, aux épaules étroites, le cheveux noir et bouclé, la lèvre noble et le front haut. Il émanait de lui un certain charisme auquel il devait selon moi sa position hiérarchique. Ni causant, ni chaleureux, il savait néanmoins mettre à l’aise. Nous avions à peine commencé une partie (c’était un piètre joueur qui réfléchissait mal et trop longtemps) qu’une créature extraordinaire (appelons un chat un chat) sortit de la caravane. Sa chevelure blonde et opulente qui tombait sur ses épaules fut la première chose qui perturba la vision latérale du jeune joueur d’échec concentré dont j’avais, par politesse pour notre hôte, revêtu le maillot de bain seize pièces. Puis, des yeux immenses et une bouche pulpeuse (je ne trouve pas de synonyme) se matérialisèrent dans mon champ de vision. Nous étions au début de l’après-midi (cherchez le faune) mais elle était maquillée comme pour aller en boîte. L’idée d’enfanter cette nymphe me traversa l’esprit. L’incarnat léger de son rouge voltigeait dans l’air, jetant ses clartés sur les zones appesanties de ma chair enténébrée.
Son corps formait un grand huit un peu trop vertigineux pour un puceau de cinquante-cinq kilos. Elle poussa un soupir explicite auquel son mari présumé répondit par un rictus crispé qui termina de me mettre mal à l’aise. Elle avait visiblement besoin qu’on s’occupât d’elle, à cette heure où les hommes raisonnables qui ont la chance d’avoir une épouse exigeante, éperdument attirante de surcroît, font une sieste, méritée ou non.
J’étais prêt à pulvériser mon adversaire pour le libérer au plus vite afin d’écouter, au moins en rêve, à travers les parois mince de la caravane, les gémissements de cette femme incroyablement sexy (à cette époque, j’imaginais que les filles sexy gémissaient). La créature faisait du surplace, martyrisant ses tongs. L’homme n’en avait cure. Il savait se faire désirer. C’était tellement énorme que j’en vins à me demander si le couple n’avait pas monté de toute pièce ce scénario, en prélude à leurs ébats (l’imagination n’attend pas le nombre des années). L’idée me plut et, changeant de stratégie, je pris mon rôle à cœur en jouant des coups propres à prolonger la partie, comme ces parasites qui gardent les organes vitaux de leur hôte pour la bonne bouche, dans le but de prolonger sa vie et de conserver leur domicile le plus longtemps possible. Ma propre excitation participait ainsi du dispositif et mes jeunes yeux au-dessus de tout soupçon apprivoisaient à la dérobée les courbes de son corps, tandis que je serrais entre mes cuisses, ma verge dure.
L’apparition était irréelle à ce point qu’il me semblait que jamais plus je ne reverrais cette femme miraculeuse qui avait fini par s’enfermer dans la caravane. Ce fut le cas. Avais-je rêvé ? Était-elle retournée chez sa mère ? Avaient-ils décidé de faire un break, voire une semi-remorque ? La direction du camping organisait-elle des divorces à l’amiable tous les vendredis soir ? Était-elle seulement son épouse ? Était-elle de passage ? Le sujet ne fut jamais abordé mais le supérieur hiérarchique fut plus que jamais disponible pour participer à nos jeux. Je le prenais à bord de mon dériveur et en échange, il m’apprenait à faire du ski nautique. Nous étions trois célibataires. C’était le nombre de membres d’équipage requis pour exercer cette activité polluante : l’un conduisait, un autre surveillait, le dernier zigzaguait au bout du câble sur ses planches.
Quinze jours plus tard, mes amis retournèrent dans leur entreprise et ma surprise fut grande quand je vis la créature de rêve s’avancer vers notre campement. Je plaisante. Je reprends. Ma surprise fut grande quand je vis, à la place qu’avait occupée l’homme aux espadrilles transparentes, deux garçons attablés devant un jeu d’échec. L’emplacement semblait marqué du sceau du roi des jeux. N’ayant pas grand-chose à perdre, je m’approchai pour constater l’ampleur des dégâts. En embuscade, je gardais pour moi mes appréciations concernant la partie confuse qui se déroulait sous mes yeux. À la fin, gentiment provocateur, le plus grand des deux vacanciers leva vers moi un œil torpide et me lança un tu sais jouer dubitatif. Je répondis par une moue modeste, appuyée d’un haussement d’épaules. Je n’avais pas grand-chose à perdre, les vacances étaient déjà bien avancées. Il me fallut un quart d’heure pour mettre à l’insolent la raclée de sa vie.
Impressionné par une telle rage intellectuelle, le grand gars m’embaucha comme conseiller particulier. Il hésitait entre deux filles. Ça tombait bien, l’hésitation était ma spécialité. Il me présenta son copain, un garçon affectueux qui passait son temps à arrondir les propos salaces de son camarade. Après le déjeuner, deux sœurs qui logeaient à quelques tentes de là, venaient les rejoindre pour passer avec eux l’après-midi, la soirée et une grande partie de la nuit. L’une, sportive, rigolote et décidée avait les cheveux emmêlés, attachés en queue de cheval, l’autre, très féminine (selon des critères qui n’appartenaient qu’à moi) et réservée avait les cheveux longs et lisses et quelques jolies taches de rousseur. J’en tombai immédiatement amoureux. Elle était censée répondre au doux nom d’Émilie mais je ne me serais jamais permis de l’appeler, sinon pour l’empêcher de poser le pied sur un scorpion. Mais il n’y avait, que je sache, pas de scorpions au bord du lac d’Hourtin, en tous cas, je n’avais pas vu d’affichette à la réception du camping.
Mon statut de conseiller particulier me donnait accès à la tente des deux gars, à toute heure du jour et de la nuit. Je passais toutes mes soirées à les regarder galocher leurs copines. Les deux couples se faisaient et se défaisaient d’une soirée sur l’autre dans un jeu de bonneteau étourdissant. Nous discutions de la vie, philosophions sur le plaisir et l’amitié et mangions des chips. J’avais le droit de regarder les cuisses des filles. Un soir que les deux filles s’acharnaient sur mon employeur, celui-ci se défendit d’un, je ne peux tout de même pas me couper en deux. La plus sportive des deux ondines avaient rétorqué d’un, perso je prends le bas, qui me fit le reste des vacances. D’un regard complice, le garçon avait réclamé mon indulgence. Quand nous étions seuls, je n’hésitais pas à lui vanter les mérites d’Émilie, la douce naïade qui selon moi devait remporter son suffrage. Nous discutions des mérites de l’une et de l’autre. Le bréviaire de Tartakover ne m’était d’aucun secours.
Le jour de leur départ, je remis à Émilie, un poème que j’avais écrit en l’honneur de sa beauté, célébrant son corps « ruisselant de perles d’eau ». Elle avait déposé sur ma joue entre deux boutons d’acné, le baiser que j’attendais depuis des jours. Mon seigneur et maître me serra la main en me disant que j’étais un type bien. C’était le plus beau compliment qu’on m’avait fait depuis longtemps.
N’allez pas croire que j’étais un ignoble profiteur à l’affut de la considération de son prochain, un abominable écornifleur en quête de reconnaissance. J’eu l’occasion de renvoyer l’ascenseur durant la dernière semaine de ces vacances.
Tout le monde connaissait cette petite fille qui manœuvrait avec habileté son dériveur de poche dépourvu de foc. Ses cheveux lisses extrêmement fins se plaquaient contre son front, donnant l’impression qu’ils étaient mouillés en permanence. Elle allait et venait ostensiblement dans le bassin intérieur, sous le nez des campeurs qui prenaient le frais, genoux cagneux et quadriceps en berne. De retour au port, je l’observais en abaissant ma voile. Je la jugeais dégourdie pour son jeune âge. Je la soupçonnai toutefois de se la péter un peu et de vouloir épater la galerie. Je ne me trompais pas.
Lily, c’était son nom, ne m’était pas inconnue. Elle quittait chaque année la lointaine Hollande, accompagnée d’une grande dame très mince, aux traits marqués et à la tignasse drue et blanche. J’apprendrai plus tard qu’il s’agissait de sa mère et non de sa grand-mère. Ils habitaient une mini caravane. Je me demandais comment une aussi grande personne pouvait dormir dans ce jouet, autrement qu’en chien de fusil. Lily en revanche était toute petite. Tout semblait fait à sa mesure, afin de lui donner l’illusion qu’elle était une grande personne.
Toujours est-il qu’un beau matin, alors que je m’apprêtais à appareiller, la petite chienne mouillée se présenta équipée de son gilet de sauvetage et me fit comprendre avec des signes impératifs qu’elle désirait que je la prenne à mon bord. À peine avais-je fait mine d’hésiter qu’elle poussait sur l’un des flotteurs pour m’aider à mettre à l’eau l’embarcation. À trente mètres de là, coiffée de son panache blanc, son chaperon levait la main en signe d’adhésion.
C’est ainsi que, pendant cinq jours, nous communiquâmes exclusivement au moyen des sensations que procurait le dériveur et le vent. Je lui avais abandonné la barre qu’elle maniait avec un sens inné de la navigation tandis que je faisais du rappel, suspendu à mon câble comme un grand singe affectueux.
Nous atteignions des allures folles et pas une fois nous ne dessalâmes. Le mince sourire qui éclairait le visage de Lily n’entamait en rien sa concentration. Je savais que pendant son sommeil, dans sa petite caravane, elle continuait de naviguer en ma compagnie, et ça me faisait chaud au cœur.
Nous échangeâmes nos adresses, elle m’envoya les photos de ses cochons d’Inde angora ainsi que son portrait en costume de fanfariste. Elle jouait du saxophone dans la fanfare municipale de sa petite bourgade. Puis, à Pâques, ils m’invitèrent à venir passer une semaine en Hollande. C’est ainsi que je découvris, des pavillons de brique, les baies vitrées ornées de dentelles, de macramés et de plantes suspendues, que je fis connaissance avec la ménagerie de la petite et que j’assistai au défilé de la fanfare municipale. Comme les cochons d’Inde, nous communiquions par de brusques torsions du cou et des hochements de tête.
Faustine
Malgré des résultats très moyens, Faustine était la chouchoute de la quatrième B. Tous les professeurs l’aimaient, toutes les filles étaient sa copine et tous les garçons étaient amoureux d’elle. En retour, elle était amoureuse de tous les garçons. Son besoin d’amour semblait sans fond.
Un jour elle arriva en classe avec un corset en plâtre de plusieurs kilos qui lui emprisonnait le buste, du cou jusqu’au coccyx. Scoliose ? Décalcification ? N’étant pas dans ses petits papiers, je n’avais pas l’information. Ce dispositif tue-l’amour ne diminua en rien ni sa popularité ni le nombre de ses conquêtes. Elle avait les poignets et les mains fines, un petit visage de martre mangé par des lunettes aux verres épais et ses cheveux bruns tournicotaient sur ses joues pâles qui s’empourpraient facilement. Bottines, collants et minijupe sous la blouse réglementaire constituaient sa tenue de combat, en dépit du panty et de la jupe-culotte qui avaient fait leur grand retour.
Entre midi et deux, à la sortie de la cantine, nous étions nombreux à nous retrouver dans le préfabriqué des quatrièmes. Les collégiens se regroupaient en clans. J’étais plus ou moins admis dans celui de Faustine car j’étais assez proche de certains garçons de cette bande qui conspiraient dans le but de me déniaiser. Je soupçonnais Faustine d’être derrière tout ça.
Ce jour-là, j’étais assis à côté de Faustine. Un garçon la chahutait, l’obligeant à lever les bras et à découvrir ses cuisses davantage. Assise sur une table derrière-moi, sa copine à gros seins me souffla : « vas-y, mets-y la main ! Qu’est-ce que t’attends ? » Contrairement aux principes adossés à ma timidité, il était naturel pour elle de se faire ploter par les garçons. Ses gros seins étaient la cible des convoitises d’Éric et de Loïc, les deux mâles alpha de notre classe, qui la coinçaient régulièrement dans le couloir qui séparaient les deux classes jumelles, pendant que je faisais semblant de faire le guet.
Pour me débarrasser de mon image d’arriéré sentimental, j’effleurai le nylon dont la rugosité me surprit. J’étais déçu mais soulagé que la sensation procurée ne m’ait ni submergé ni fait perdre le contrôle de mes sens. C’était une formalité, en somme, pour accéder au statut de mâle confirmé.
Dès lors, les choses allèrent très vite. Faustine m’avait donné rendez-vous le weekend suivant dans le village où j’habitais. J’avais attendu le son de son vélo Solex pour la rejoindre à bicyclette, au bout de la rue. Nos lèvres s’étaient touchées furtivement. C’était la première fois que je sortais avec une fille.
Le terrain de foot était désert, des traces de terre sèche balafraient la pelouse. J’ai toujours eu du mal à admettre que la phrase suivante fût sortie de ma bouche : « Quand je vais dire à Loïc que je suis sorti avec Faustine, il ne va pas en revenir. » Le sens du ridicule n’était pas chez-moi un ressort cardinal. Loïc était un garçon de mon village avec lequel j’étais vaguement ami. C’était l’un des rares à ne pas prendre part aux opérations de harcèlement des plus faibles. Ses parents lui avaient inculqué des valeurs et son grand frère était un champion de karaté qui sortait avec une mannequin. C’est précisément le bruit viril de la moto de Loïc qui vint déchirer la torpeur de ce jour ferrier où il ne se passait rigoureusement rien. Il coupa les gaz à cinq bons mètres de nous et bloqua les deux roues de son engin pour le faire déraper. Il s’arrêta à quelques centimètres de Faustine qu’il salua en introduisant la langue dans sa bouche. Il était grand, athlétique, ses cheveux noirs et bouclés encadraient son beau visage masculin. Le bonheur ruisselait sur le petit visage de Faustine. Je pris congé avant que l’humiliation ne laissât en moi une trace indélébile.
J’avais passé une partie de l’été à imaginer le son frêle du Solex de Faustine. Mais ce n’était chaque fois que le bruit émincé par le vent, d’un deux-roues plus robuste.
Quatre ans plus tard, je rencontrai Faustine au coin d’une rue alors que je me promenais en ville avec deux amis du lycée. Nous venions de passer le bac, nous parlions haut et nos propos avaient l’arrogance de ceux qui s’imaginent qu’ils vont réussir leur vie. Faustine était restée la même. Elle ne portait plus de corset. Elle prononça mon prénom avec douceur, elle était émue et souriante. Je lui expliquai brièvement que j’étais avec des amis et n’avais pas trop le temps de discuter. Puis j’avais rattrapé mes collègues sans me retourner.
Le remord me poursuivit quelque temps, en vain. Cependant, jamais plus je n’entendrais mon prénom prononcé avec autant de tendresse. L’amour n’est-il que miettes que vent emporte ?
Géraldine (Mademoiselle)
C’était l’année où le mercredi avait remplacé le jeudi dans le cœur des écoliers. Chaque mercredi après-midi, notre professeur d’allemand, Mademoiselle Géraldine, recevait gratuitement à son domicile un élève trié sur le volet, en l’occurrence un garçon qui avait du potentiel. Mademoiselle Géraldine n’aimait pas la solitude.
Elle se plaisait à répéter avec une pédagogie bienveillante, que les filles étaient des créatures sérieuses qui n’avaient nul besoin d’un soutien méthodologique.
Mademoiselle Géraldine ne recevait à son cours particulier qu’un élève à la fois. Mademoiselle Géraldine ne forçait personne. Mademoiselle Géraldine lançait une invitation et celui qu’elle avait choisi devait s’arranger avec ses parents, comme un grand garçon, s’il avait envie de venir passer l’après-midi chez elle.
Ravie de se débarrasser de son fils l’espace d’une demi-journée, ma mère avait toujours donné son autorisation distinguée.
Mademoiselle Géraldine était une professeure sévère mais les filles autant que les garçons raffolaient de cette grande gigue aux cheveux blonds et lisses comme la pluie, équipée d’un nez busqué qui forçait le respect. Retournez à votre place ! Et inutile de lever les yeux au ciel, Mademoiselle Charpentier, ça se voit à votre popotin.
Ses interminables pantalons à pattes d’éléphant, aussi noirs que son langage était fleuri, repoussaient toujours plus haut le nirvana des garçons de la quatrième B. Elle était la seule professeure à ne pas avoir eu à essuyer les assiduités de Monsieur Cobra, le directeur du collège. Faux-cul et pas téméraire, l’homme au visage raviné s’en était tenu au regard bleu bistouri de la fonctionnaire.
Curieusement, le mercredi après-midi, il n’était jamais question d’allemand, de devoir ou de leçon. On parlait en français de tout et de rien, on confiait prudemment ses craintes et ses rêves. Mademoiselle Géraldine écoutait en souriant. On jouait aux cartes, on mangeait des gâteaux, on buvait des jus de fruits, on se promenait dans les labours environnants et on rentrait racler la boue collée sous nos semelles, sur le décrottoir scellé dans le mur, au pied de l’escalier de pierre. Avec elle, tout paraissait simple. Elle s’amusait comme une jeune-fille. On avait du mal à se rappeler la professeure sévère et crainte, derrière la demoiselle populaire du mercredi.
Bien sûr, au fil des semaines, les amis étaient devenus plus proches. Ils avaient leurs habitudes. En milieu d’après-midi, il leur arrivait de retirer leurs chaussures pour faire une petite sieste dans la chambre. Mademoiselle Géraldine gardait sa robe. Oui, elle ne mettait des robes que chez elle ; c’était un privilège de la voir ainsi vêtue, un rêve éveillé dont on ne soufflait mot.
Maintenant, on va se vider les hippocampes, déclarait Mademoiselle Géraldine avec un sourire entendu. Elle expliquait que, pendant le sommeil, les informations provisoirement stockées dans les hippocampes passaient dans le cerveau pour y être mémorisées durablement. L’argument ne souffrait pas la contradiction même si la perspective de vider un hippocampe laissait perplexe l’ignare fraîchement pubère que j’étais. Il était urgent, à tout prix et à jamais, de graver dans sa mémoire ces merveilleux instants passés en compagnie de cette femme savante.
C’était très agréable de respirer son parfum dans la pénombre. Les mains se frôlaient, une mèche de cheveux dorés glissait parfois sur la joue enflammée du garçon qui se tortillait pour dissimuler une violente érection.
Rétrospectivement, j’étais étonné que Mademoiselle Géraldine n’eût jamais, en ce qui me concerna, ébauché le moindre attouchement. Elle se satisfaisait apparemment de cette complicité bouillonnante qu’elle caramélisait avec un art consommé de la candeur.
On ne pouvait pas en dire autant des amies de ma mère quand elles s’assuraient jadis, à la sortie des toilettes, que j’avais bien rentré ma chemise dans mon pantalon et que la dernière goutte n’était pas restée prisonnière de la « petite peau » ; toujours à chatouiller mes « petites pommes » à travers mon pantalon de velours, à essuyer avec de la salive leurs traces de rouge à lèvres sur mes joues, à m’obliger à comparer leurs parfums, entre leurs seins tavelés.
Je racontais à Mademoiselle Géraldine ma vie d’enfant timide que terrorisaient les copines de ma mère. La tête inclinée, elle buvait mes paroles et disait que je racontais bien.
Peut-être qu’avec d’autres garçons plus dégourdis les choses se passaient-elles différemment. J’aimais à imaginer que, par suite du geste déplacé d’un galopin transi, la grande fée descendait les marches de son palais enchanté pour redevenir la reine sévère, prompte à recadrer comme il se doit le jeune délinquant. Pinocchio endurait alors de terribles punitions. Privé de goûter, il restait agenouillé sous la table pendant que Sa Majesté Géraldine se régalait de glace et de petits gâteaux ; il devait ensuite aider la professoresse à faire sa toilette, la déshabiller, la savonner, la coiffer sans lui tirer les cheveux sous peine d’essuyer la représaille musclée d’une fessée sur mesure à coup de triple décimètre. Un coup par cheveux récolté entre les poils de la brosse était le barème qui semblait convenir à tout le monde. Une heure de phonétique allemande attaché nu sur le fauteuil en rotin kubu constituait la punition ultime. Les cours de langue de Mademoiselle Géraldine se méritaient. Malgré ces conséquences effroyables que je brûlais de connaître et les efforts linguistiques que j’étais prêt à consentir, je n’osai jamais poser la main sur Mademoiselle Géraldine.
Hélène
Hélène était en quatrième pratique ce qui, de mon point de vue de petit réac, n’était pas compatible avec mes ambitions. Par ailleurs, Hélène avait un corps magnifique de sportive de haut niveau. Je l’imaginais patineuse ou championne de 400 mètres haies. Elle semblait jouir d’une certaine tolérance en matière vestimentaire car le directeur de l’établissement, en fin connaisseur, ne sanctionnait pas la hauteur insuffisante de ses jupes. Toutefois, son visage allongé, sujet aux dermatoses inflammatoires et pustuleuses, n’avait pas su me séduire.
Cependant, cette fille fut la première à m’exprimer ses sentiments. Un jour que nous étions en rang devant le préfabriqué de la 3e B, attendant l’arrivée d’un professeur en retard, l’une de ses copines me transmit de sa part une enveloppe carrée. Nous étions la seule classe à attendre dans la cour. Les 4e de transition ne sortaient pas en récréation en même temps que les autres classes, de peur qu’ils ne contaminassent nos carnets de note. Une solide réputation de racaille auréolait ces futures dactylographes et conducteurs d’engins. Les applaudissements ironiques de mes camarades de classe avaient salué ma promotion. Le rouge de l’humiliation m’était monté aux joues, masquant fort à propos celui de l’émotion. J’avais attendu d’être rentré chez moi pour ouvrir le pli mystérieux.
L’enveloppe contenait un carré de papier plié avec soin sur plusieurs épaisseurs, décoré çà et là de petits dessins coloriés. Son ouverture progressive dévoilait des phrases successives : ouvre-moi, ouvre mon cœur, je t’aime.
C’était la première fois qu’on me disait « je t’aime » et ces mots avaient déclenché en moi une poussée d’adrénaline qui me submergea, accélérant mon pouls de façon significative. La sensation vécut en moi plusieurs minutes, j’en garde un souvenir précis. Ça m’avait fait un bien terrible.
J’avais fantasmé une semaine ou deux mais n’avais pas donné suite.
C’était l’avant-dernière fois qu’une fille me disait « je t’aime ».
Ida
La première lettre d’Ida me remerciait d’avoir accepté de devenir son penfriend. Peut-être, les établissements scolaires s’échangeaient-ils, par-delà les mers, des listes d’adresses qu’ils distribuaient à l’insu des intéressés. Je n’avais jamais eu vent de ces dispositions mais j’avais emboîté sans barguigner le premier pas épistolaire d’Ida. Nous correspondîmes durant plusieurs mois, elle en français, moi in english, comme l’exigeaient les règles de la confrérie des penfriends. La petite anglaise aux cheveux blonds et courts, lisse sous tout rapport, dont elle avait fini par m’envoyer un Polaroïd face objectif, dissimulait une réalité plus tapageuse.
Elle m’avait aussi envoyé une cassette sur laquelle elle avait enregistré ses chansons préférées. Les courriers d’Ida recelaient toujours une petite surprise, une attention originale. J’étais gâté.
La fin de l’année scolaire approchant, elle avait proposé qu’on vienne chacun notre tour passer un mois dans la famille de l’autre. Il était question que je vienne le premier car j’étais un garçon, et que les garçons doivent faire leurs preuves, montrer qu’ils n’ont pas de mauvaises intentions, qu’ils sont propres au dedans comme au dehors.
Tout aurait été différent s’il en avait été ainsi. Mais un contretemps professionnel avait chamboulé l’emploi du temps de son père et Ida s’était retrouvée à Orly plus tôt que prévu. En arrivant, je lui avais fait visiter ma chambre. On s’était rapidement retrouvés à plat ventres sur mon lit de cent quatre-vingts pour analyser l’épreuve de math du BEPC que je venais de passer. Pour ne rien manquer de mes explications, elle s’était rapprochée de moi et avait posé un sein sur mon coude replié. C’était le premier sein avec lequel j’entrai en contact. Je n’étais pas mécontent d’être sur le ventre. Elle s’était vite aperçue que mes explications avaient perdu de leur clarté et elle avait changé de position. Pour détendre l’atmosphère et faire honneur à notre échange culturel international, elle avait proposé un jeu de cartes. La règle était simple et le score ne nécessitait aucune feuille de marque ni aucun crayon à papier, il suffisait au perdant d’ôter le vêtement de son choix.
Les parties s’enchaînaient, Ida s’était rapidement retrouvée en petite culotte. Mais elle avait refusé d’aller plus loin. Je lui en avais voulu avec ma morgue de français boutonneux sûr de son droit napoléonien. Cela envenima notre belle entente cordiale, nous partîmes d’un mauvais pied et la magnifique histoire que nous nous apprêtions à écrire tourna court. Heureusement, ma mère donna de la voix pour annoncer que le dîner était servi. Ida s’échappa pour aller se changer.
Je ne m’attendais pas à ce qu’elle descendît en robe du soir. Nous habitions un pavillon en marge d’un lotissement de campagne. Certains après-midis d’automne, un vieux cultivateur utilisait un cheval pour retourner son lopin, de l’autre côté de la rue. Il était le seul du canton et possiblement du département, à utiliser un animal de trait. Huu pour avancer, Hoo pour s’arrêter, Huhoo pour reculer. Notre terrain était ceint d’une haie de tuyas qui, avec les années, allait rétrécir substantiellement notre pelouse à chien. Mes parents avaient fait leur possible pour que la demeure familiale qu’ils avaient construite de leurs mains répondît aux standards de la classe moyenne. Alors que la famille était réunie dans la salle à manger, Ida apparu dans l’embrasure de la porte, à contrejour de la grande fenêtre du salon, dans une minijupe des années soixante-dix, à ceci près qu’elle était davantage à l’extérieur de la minijupe qu’à l’intérieur. Elle avait des jambes d’une blancheur d’imprimerie, trop longues pour la saison. Sous son t-shirt rose pâle ras du cou, ses seins tentaient une percée à la faveur d’un soutien-gorge emboîtant qui n’était pas de son âge mais qui était tendu comme des douilles à pâtisserie de la seconde guerre mondiale.
Les victuailles cuisinées à la française qui encombraient la table, allumèrent dans ses yeux des lueurs qui approfondirent le bleu de son regard. Son nez busqué lui donnait un air volontaire et conquérant qui me posait toutes sortes de problèmes.
Le mois s’écoula sans chaleur. Muré dans ma dignité, je ne savais pas ce que je voulais et j’étais incapable de reconnaître une jeune fille amoureuse.
Ce fut mon tour de traverser la Manche. C’était la première fois que je prenais l’avion. Non sans une certaine appréhension car la dernière fois que j’avais pissé au lit ne remontait qu’à quelques mois.
Ses parents étaient gros et vieux. Elle ne ressemblait ni à son père, ni à sa mère. Son père travaillait dans l’industrie automobile, au service financier. Il venait d’acheter une voiture neuve devant laquelle Ida s’extasia comme une fille unique se doit de s’extasier. Son père était content de sa surprise. Les parents affichaient une bonne humeur anglo-saxonne que je trouvais ridicule.
Nous partîmes en vacances au pays de Galle, en pleine nature. Ils avaient réservé une caravane géante dans un terrain de camping minuscule. Je n’avais jamais vu une caravane aussi longue. Je passais mon temps à jouer au criquet avec les enfants d’une famille voisine. Une après-midi, je décidai de monter jusqu’au sommet de la colline qui dominait notre trou de verdure. Au fur et à mesure que je progressais, une colline apparaissait qu’il me fallait gravir et redescendre afin d’accéder à la colline suivante. Cela semblait ne jamais devoir finir. Je rencontrai des ovins isolés à tête noire, aux longues oreilles blanches et tombantes, qui me fixaient au ras des fougères, avant de disparaître brusquement en poussant un cri bref et rauque. Il me fallut traverser une pâture où un taureau aux couilles dignes d’une horloge Saint-Nicolas veillait sur une dizaine de vaches. Je me glissai in extrémis sous le barbelé pour échapper à la vindicte de la bête qui me poursuivait au pas de gymnastique. Je ne parvins jamais au sommet ultime et renonçai prudemment quand l’obscurité commença de monter entre les arbres. La température baissait rapidement et tout le chemin du retour restait à effectuer. Ce fut un miracle de retrouver dans la nuit noire le petit rectangle jaune de la fenêtre de la caravane.
Un autre jour, je défendis face à Ida la thèse selon laquelle il fallait se brosser les dents après le petit-déjeuner et non avant. Elle s’amusa de l’énergie que je dépensais pour faire triompher mon point de vue. L’indulgence amusée de son sourire disait combien nous aurions pu nous aimer si je n’avais pas été aussi crétin. Quelque chose me dis qu’elle ne s’est pas mariée à un Français.
Le petit déjeuner à base d’œufs au plat, de pain toasté et de bacon grillé était le meilleur moment de la journée. Le déjeuner et le dîner n’étaient pas sans surprise et je restais sur mes gardes. Un jour où la maîtresse de maison avait innové et m’avait demandé ce que je pensais de son potage, un brouet clair où surnageaient trois petits poids fluorescents, j’affirmai qu’il s’agissait d’un potage au poisson. « Au poulet » avait-elle rectifié, ulcérée. J’avais mobilisé toutes mes connaissances de la langue de Charles Dickens pour suggérer perfidement que le poulet avait peut-être été nourri à la farine de poisson.
De retour en Angleterre, je fis connaissance avec les petits villages aux rues bordées de murets de pierres sèches, le fish&chips aspergé de vinaigre et la piscine municipale dont Ida, gainée dans un maillot de compétition une pièce, traversait le grand bassin d’un papillon olympique. Je restais à lire sur la pelouse, prétextant une digestion difficile. Sa copine, très moche, était venue me dire, dans un français impeccable, que mon attitude était plus moche qu’elle. Je devais être bigrement complexé pour être resté muré dans cette morgue affreuse durant deux mois d’été.
Un jour qu’elle nettoyait ma chambre, sa mère m’avait appelé pour tenter de crever l’abcès. Pendant qu’elle faisait le lit, elle m’avait expliqué qu’Ida lui racontait tout. Imaginez ma gêne. La chambre était petite et je devais tourner autour du lit au fur et à mesure que la femme progressait en m’accablant de reproches. Je décidai de me mettre en orbite géostationnaire à une altitude d’un mile marin environ quand, d’une main large et professionnelle, elle entreprit de rassembler au pied du lit les poils pubiens que j’avais perdus durant la nuit. Aucun son ne sortait de ma bouche, l’humiliation était totale. Je me disais que je n’avais pas encore touché le fond car je n’avais pas encore pissé au lit. On se console comme on peut. Je me demande encore quel était le but de cette femme. Voulait-elle venger sa fille ou simplement me sensibiliser à la perte nocturne des poils pubiens ?
Le jour de mon départ pour la France, nous passâmes l’après-midi à Londres. L’on me demanda quels monuments je voulais visiter. Ma culture étant proche de rien du tout, je m’en tins à cette information tirée d’un ouvrage sur la faune, qui plaçait le zoo de Londres à la première place mondiale en termes de modernité et de diversité des espèces hébergées. C’est ainsi, contre toute attente, que je vis mon premier gorille de montagne, mon premier raton laveur, ma première loutre, mon premier tatou et mon premier connard qui se reflétait dans la vitre sombre d’un terrarium désaffecté.
Jocelyne
Un vendredi soir, autour de la table de la salle à manger, mon père nous raconta comment il avait pris en stop deux jeunes filles qui terminaient leurs études d’infirmière. Elles avaient décidé de partir en weekend au petit bonheur la chance sans destination précise. Mon père se désola de n’avoir pu faire autrement que les déposer au bord de la nationale 7, à un endroit peu commode pour faire de l’autostop. Il espérait qu’elles rencontreraient une âme honnête et charitable pour les avancer et surtout qu’elles trouveraient un endroit où passer la nuit, ce qui selon lui serait compliqué, compte tenu de l’heure avancée.
Le récit de mon père eut l’effet escompté. Naïvement, ma mère demanda à mon père pourquoi il les avait ainsi abandonnées, pourquoi il ne leur avait pas proposé de passer la nuit chez nous. J’ai pas eu l’idée, c’était un peu compliqué, elles avaient l’air de tenir à leur aventure… Ma mère lui ordonna de retourner jusqu’à la nationale pour vérifier qu’elles n’étaient plus sur le bord de la route. Mon père lui demanda de l’accompagner pour leur inspirer confiance, le cas échéant.
C’est ainsi que Jocelyne et sa copine, qui n’était autre que la maîtresse de mon père, passèrent ce weekend chez nous, ainsi que de nombreux autres.
Les deux filles étaient bien élevées, à l’écoute, charmantes. Ma mère était ravie de cette bouffée d’oxygène dans sa vie. Mon père s’inquiéta du surcroît de travail que cela allait lui occasionner. Ma mère le rassura. Les deux filles dormiraient ensemble dans le grand lit de la chambre d’amis. J’espère que ça ne les dérange pas de dormir dans le même lit ? Avec un sourire balafré de sous-entendus, mon père répondit qu’il avait compris à demi-mots que ça ne serait pas la première fois.
J’attendais chaque weekend avec l’impatience de mes quinze ans. Mon père ne manquait pas de ramener ses deux protégées qui l’appelaient JP.
Jocelyne n’était pas du genre à rester le cul dans un fauteuil, à tenir une chandelle. Après le repas du soir, quand la nuit était tombée, je lui proposais une promenade dans la campagne. Nous partagions le goût de la marche et de la nuit. Nous empruntions les routes vicinales qui reliaient entre eux les villages du canton et prenions parfois des raccourcis à travers la forêt emplie d’odeurs, de craquements et de chuchotements.
Jocelyne était plus âgée que moi et plus grande aussi. Ses cheveux crépus et les verres épais de ses lunettes n’avaient pas déclenché dans mon cœur l’avalanche de passions que l’adolescence réclamait. Mais elle était très bonne camarade. Sa douceur avait eu raison de ma timidité. Très vite, je lui avais proposé de réchauffer sa main dans la mienne. Tant et si bien que nous allions toujours main dans la main ou bras dessus bras dessous. Le périmètre auquel j’avais accès était réduit mais la douceur de sa hanche avait conquis deux bons tiers de mon cerveau. Parfois, quand nous allions par les chemins forestiers, je la faisais marcher dans les ornières. C’est pour être plus grand que toi, lui expliquais-je. Elle riait et me regardait avec tendresse à travers ses deux blocs de verre où il me semblait distinguer nos corps enlacés comme dans la tempête d’une boule à neige.
Je n’ai jamais su à quoi mon père et son amante occupaient leur soirée en présence de ma mère. Je préférais ne pas approfondir. Je n’avais appris leur liaison que tardivement. Il régnait dans notre foyer une atmosphère irréelle. Mes repères avaient fondu comme la glace à la fraise tombée de son cornet sur le macadam brulant, aux pieds de l’enfant de la liberté.
C’est avec une honte rétrospective que je me rappelle ce jour où ma mère et l’amante étaient allé faire des courses. Je ne sais pas où mon frère était passé. Jocelyne était assise dans un fauteuil, j’étais blotti à ses pieds sur la moquette. Mon père lisait dans un autre fauteuil. Le pantalon à pattes d’éléphant largement évasées de Jocelyne me donna l’idée d’un concours. Celui qui enfoncerait son bras le plus haut à l’intérieur du pantalon de Jocelyne serait le gagnant. Affolé par mon effronterie, je n’avais pas proposé de récompense. J’escomptais que la maigreur de mon bras me donnerait l’avantage. Jocelyne écarta les genoux et mon père et moi primes positions. La grosse main de mon père fut rapidement bloquée par le tissu tandis que je progressais sans peine. Jocelyne avait formé en haut de sa cuisse un anneau de sécurité avec ses doigts. Je me rappelle la douceur de sa peau et la chair de sa cuisse qui remontait de façon inattendue entre mes doigts, comme une lave crémeuse. J’avais gagné et retirai ma main à regret.
Un soir où nous étions seuls avec mon père, son amante et moi, par un concours de circonstance dont je suis incapable de me rappeler les tenants et les aboutissants, il proposa de nous emmener voir Les Trois Mousquetaires, une opérette que l’on donnait au Chatelet. La fête repartit de plus belle. Une heure plus tard, nous étions à Paris. Il y avait des chevaux qui patinaient sur la scène glissante. Je craignais qu’un accident ne survienne, qu’un métacarpe ne se brisât. À l’entracte, je m’éloignai du couple qui s’embrassait sur la bouche. Bientôt ça serait la rupture, l’amante se marierait et un enfant naîtrait quelque mois plus tard. Jamais je ne reverrais Jocelyne.
Karen
Comme tous les ans, nous étions retournés en vacances au bord du lac d’Hourtin, sur la côte landaise. Le voyage était long et terrassant. Comme dans les gaines d’un chauffage à air pulsé, un souffle brûlant s’engouffrait dans la voiture par les fenêtres ouvertes. La Simca onze cents rouge bordeaux était chargée à bloc et devait de surcroît, cette année-là, tirer la caravane pliante améliorée qu’avaient conçue et fabriquée mes parents, un palais à roulettes de bois et de toile qui devait donner un nouveau départ à leur sexualité.
Je dormais dans une canadienne, à l’ombre de ce château suspendu, libre de mes jours et de mes nuits. Un dériveur quatre soixante-dix loué au mois et une casquette en tissus éponge jaune poussin rehaussaient mon statut social, me donnant accès aux fermetures éclairs du quartier chic. C’était l’époque paradisiaque où le chauffeur-livreur côtoyait le directeur technico-commercial – surtout sa femme.
J’avais été admis dans une de ces grandes familles dont les enfants aux cheveux blonds et bouclés étaient d’une beauté sans nom. Le grand-frère me méprisait de toute sa hauteur quand, par hasard, il posait sur moi son regard bleu. Il avait une petite amie châtaine et sportive deux fois moins grande que lui qui devait monter sur toutes sortes de promontoires pour atteindre ses lèvres parfaites qu’il entrouvrait en fermant les yeux.
La sœur, d’un an ma cadette, était une brindille d’une gentillesse craquante et d’une beauté affolante. Sa peau veloutée était uniformément recouverte d’un hâle de caramel au beurre salé. Tordus par l’air marin, ses cheveux de cuivre et d’or dégoulinaient sur ses épaules maigres. Les garçons du camping jouaient au flipper avec leurs yeux de poissons morts qu’ils faisaient rebondir sur ses lèvres et ses pommettes en espérant, sur un malentendu, remporter une partie gratuite. Elle faisait semblant de ne pas s’en apercevoir et arpentait les allées sablonneuses du camping dans son deux-pièces cuisine couleur chair qui dessinait sur ses reins un triangle isocèle dont les côtés de même longueur n’en finissaient pas de monter et de descendre. Au début, pour différer l’érection, je pensais à l’odeur de désinfectant des blocs sanitaires. Bientôt, cette odeur s’étant associée aux branlettes indispensables à mon équilibre nerveux, j’étais passé au super au potassium qui alimentait les moteurs hors-bord Evinrude des bolides qui bordaient le canal du quartier riche. Dès ma première virée en famille sur l’un de ces engins fuselés, cuisse contre cuisse avec ma dulcinée, j’adoptai l’odeur d’huile de coco qui parfumait la crème anti-UV que ma mère utilisait lors de ses leçons de natation.
Mais n’anticipons pas. Le miracle qui m’avait permis de rencontrer Karen se nommait Christelle. Christelle était la fille des gérants de la superette du camping. Cette fille du pays aux cheveux châtains et rebelles aidait aux caisses durant toute la saison. Le soir, elle se promenait sur les bancs de sable en compagnie d’un berger allemand au pelage sombre qui terrorisait les enfants. Christelle et Karen étaient amies. Christelle était discrète mais plus aventureuse que Karen. Toutefois, sa discrétion ne parvenait pas à faire oublier sa forte poitrine. Ma maturité n’était pas à la hauteur. C’était pourtant sur moi qu’elle avait jeté son dé velu. Toujours prête à rendre service, Karen s’était laissé entrainer par sa copine entichée et les deux filles avaient fini par me complimenter sur ma casquette éponge alors que j’avais les bras encombrés de vaisselle sale. J’avais habilement vanté les qualités absorbantes de l’accessoire en expliquant que je réfléchissais trop. Les filles avaient pouffé et je leur avais proposé de m’accompagner au bloc sanitaire pour me regarder faire la vaisselle. Christelle devait retourner au taf. Je suis resté avec Karen toutes les vacances. Quand elle avait un peu de temps libre, Christelle se réfugiait dans ma tente où, allongée sur ses gros seins, elle feuilletait mes livres en rêvant, laissant son chien sans surveillance. Pendant ce temps, je courrais après Karen, traquant l’opportunité, multipliant les hasards, attendant qu’elle revienne de ses activités coûteuses. C’est ainsi que je gâchai une bonne partie de mes vacances.
Karen m’écrivit une fois. Un gros cœur tout rouge était dessiné en haut de sa lettre parfumée. Je n’avais pas à l’époque l’éloquence nécessaire pour entretenir une relation épistolaire. Pourtant, le bac de français approchait.
Laure
C’est dans le même camping que j’avais rencontré Laure, un autre mois d’une autre année. Le maître-nageur de ma mère était devenu l’ami estival de la famille. C’était un barbu immense, aux yeux de velours et à la musculature inégale. Il devait être le meilleur ami de pas mal de monde ici-bas. Il organisait sous les pins qui hérissaient le bout de la jetée, des soirées arrosées qu’il animait avec des chansons de sa composition accompagnées à la guitare. Mon père le raccompagnait à sa tente lorsqu’il était complètement bourré, tandis que je prenais soin de l’instrument.
Laure était une jeune fille volontaire et charmeuse d’origine méridionale. J’aimais ses cheveux noirs coupés courts et sa peau mate qui n’avait aucun défaut. Elle semblait immunisée contre les piqures d’insectes. Je passais mes après-midis sur le terrain de volley situé non loin de sa tente. Elle venait parfois admirer nos corps de jeunes puceaux pour joindre l’ennui à l’agréable. La direction de son regard ne m’avait pas trompé. Je l’avais invitée au concert nocturne qui devait se tenir le soir même à l’extrémité du cap.
La bonne humeur permanente de sa mère dissimulait une inquiétude structurelle mais elle n’était pas intrusive pour un sou. Elles me faisaient penser à deux sœurs. J’aurais aimé avoir une mère comme la sienne. Celle-ci m’avait adopté sans réserve. Son père les avait quittées. Ce n’était pas un sujet de conversation. L’un de ses oncles maternels, un jeune homme un peu caillera qui faisait du ski nautique, venait parfois déjeuner avec nous. Il parlait violemment avec un accent de Marseille que je ne comprenais pas. Il me faisait peur. J’avais l’impression qu’à tout moment il allait sortir un couteau à cran d’arrêt. J’acquiesçais à tout ce qu’il disait et prenais garde de ne jamais lui couper la parole. Un jour, il avait attiré Laure contre sa chaise avant de faire l’éloge de sa beauté. Il avait terminé sa louange en passant son avant-bras nerveux entre les cuisses de sa nièce, faisant surgir son poing comme un burattino obscène. Laure s’était sortie de la situation au prix de contorsions humiliantes. Elle m’avait assuré plus tard que derrière ce garçon fougueux se cachait un être adorable et sensible. Mon scepticisme était resté discret.
Un soir que nous étions sous sa tente à ensemencer la jachère de notre friend zone, Laure m’avait raconté comment, dans un gymnase, un garçon lui avait montré son sexe et comment elle l’avait remis à sa place en lui disant qu’elle ne lui avait rien demandé. Même si j’avais bien compris qu’elle savait à quoi ça ressemblait, je n’étais pas prêt à lui montrer le mien. Nous ne nous sommes jamais embrassés. Je savais qu’avec Laure, il n’y avait pas de demi-mesure.
Marie
Marie était ma partenaire attitrée aux cours de danse de salon organisés tous les vendredis par Alphonse dans la salle de réception de la mairie du chef-lieu. Mes parents et moi y assistions assidûment. Cette activité était censée me déniaiser et, relancer une sexualité parentale qui n’avait jamais été florissante. Nous y apprenions les bases de la valse, du rock’n roll, du pasodoble, du tchatchatcha, du jerk, de la valse anglaise et du tango.
Certains weekends, des soirées étaient organisées avec d’autres clubs pour rencontrer d’autres danseurs. Pour ces occasions prestigieuses, Alphonse sortait la cape. Alphonse était d’un autre siècle. Il avait loupé le cabriolet de Jane Austen et s’était retrouvé au XXe siècle à la gare d’Évry-Courcouronnes. Sa haute silhouette vibrionnante traversait la foule des danseurs comme un fantôme du temps passé, virevoltant avec grâce et faisant tourner la tête des femmes. Son costume noir amincissait davantage son vieux corps gracile et un vent de folie soulevait ses rouflaquettes. Sa technique consistait à accueillir avec tous les égards un couple nouveau venu, à présenter sa vieille femme au mari et à emprunter l’épouse fébrile, l’espace d’une dance. Une fois la transaction réalisée, il était reparti pour une folle traversée, enchainant les pas sophistiqués en tournant autour de sa partenaire inexpérimentée, faisant d’elle la reine du parquet. Pendant ce temps, le mari courroucé devait rester agrippé à la vielle femme d’Alphonse, à piétiner sans joie durant un long tête à tête aux âcres saveurs, prisonnier de sa partenaire permanentée de mauve et voussurée comme une église romane.
Certes, il nous arrivait de danser avec d’autres partenaires, mais c’est avec empressement que nous nous rejoignions, Marie et moi, pressés de retrouver des bras tendres et familiers. Marie avait une grosse tête et des seins mous. Ces gros yeux globuleux avaient quelque chose d’apaisant. Elle était plus petite que moi et j’aimais respirer ses chevaux blond châtain qui rebiquaient sur ses épaules rondes. Elle était facile à guider, à la foi lente et précise. Un rock endiablé se transformait avec elle en quadrille. C’était exactement la cavalière dont j’avais besoin. À la fin d’une danse, il nous arrivait de plus en plus souvent de rester collés l’un à l’autre, en écoutant Alphonse poser de la théorie sur les pas à venir.
Elle avait quitté sa campagne natale et avait deux ans de plus que moi. J’étais en terminal mais le bac me semblait encore loin. Elle était en première année de médecine. Je lui apportais tous les vendredis soir ce qu’il fallait de fraîcheur et de trouble pour se débarrasser de la pression du concours. Elle étudiait au CHU du chef-lieu et habitait pour l’occasion chez sa tante, avec sa cousine maigre et plate. Celle-ci, bien qu’a priori beaucoup plus jeune, participait aussi aux cours de danse. Son visage pointu la faisait ressembler à un moustique de la forêt de Sénart. Je n’avais jamais dansé avec elle.
Un jour, j’étais passé les prendre chez elles pour aller au cours. Mes parents m’avaient déposé devant leur porte en espérant que je saurais me conduire en gentleman. Elles partageaient la même chambre. Ce jour-là, je m’aperçus concrètement à quoi ressemblait la cousine de Marie. Une collégienne qui ne me calculait pas, jouant de complicité avec sa cousine plus âgée. J’étais pressé que cette affaire se termine pour retrouver les bras de mon canapé dansant.
Un jour, je ne vis plus les deux cousines au cours d’Alphonse. Impossible d’en connaître la raison. Je vous parle d’un temps où internet n’existait pas. À quoi mes vendredis soir allaient-ils ressembler ?
Une quinzaine d’années plus tard, ma mère me donna le fin mot de l’histoire. La tante de Marie lui avait confié sa décision de mettre un terme à ces rencontres du vendredi soir qui empoisonnaient sa vie de famille. Sa fille, le moustique, était follement éprise de moi et cédait à des crises de jalousie effroyables. C’était devenu invivable.
Nelleke
Mon premier grand amour était une grande hollandaise qui parlait le français avec une voix suraiguë et dont le visage était couvert de poils blonds. Elle m’aimait à la folie et ses parents étaient excessivement riches. À l’époque où je l’ai connue, elle s’habillait avec goût et parlait couramment quatre langues. Je lui serais éternellement reconnaissant de m’avoir fourré la sienne dans la bouche, à l’occasion de cette soirée dansante interclub où nous perfectionnions notre connaissance des danses de salon. Une robe rouge brique aux motifs ethniques enveloppait comme une papillote son grand corps brulant qui, à toute heure du jour, semblait sortir du four.
Le vendredi soir où ma cavalière habituelle ne s’était plus présentée, elle m’avait abordé avec un large sourire et avait proposé de nous associer en toute simplicité. Au contraire de ma précédente partenaire, toute en rondeurs et en mollesse, Nelleke était vive et intrépide. Elle faisait des grands pas, ses tours étaient rapides et je devais lever les bras très haut car elle était presqu’aussi grande que moi.
Les cours se déroulaient à la mairie du chef-lieu et il arrivait que la jeunesse marquât une pause dans les jardins, entre deux danses. Un jour où je m’étais assis sur les marches de pierre, elle m’avait demandé si elle pouvait venir s’asseoir sur mes genoux. Je n’avais pas refusé. Vous connaissez la suite.
Très vite elle eut dix-huit ans et la Mini première génération assortie. Nous nous voyions tous les weekends.
La faim la rendait nerveuse, irritable, voir boudeuse. J’appréhendais toujours, quand je sortais avec elle, le moment où je devrais trouver dans l’urgence le moyen de l’alimenter, tasse de thé en Tasmanie, valse de viennoiseries, millefeuille nocturne ou pain au chocolat musical… Je connaissais mal ses pensées, je savais seulement qu’elle avait très mal vécu sa puberté. Elle avait dû suivre ses parents en France, où ils avaient décidé de prendre leur retraite. Sa scolarité avait été perturbée par l’apprentissage de sa nouvelle langue, son esprit s’était obscurci. Par ailleurs, ses parents considéraient qu’une femme n’était pas faite pour suivre des études : le mariage et l’éducation des enfants devaient constituer le plus clair de son cursus, un bac de secrétariat était amplement suffisant pour administrer un ménage. À quoi bon ces longues années d’étude sinon pour trouver le mari studieux qui prendrait les choses en mains.
Toujours est-il que, sitôt rassasiée, elle adoptait des allures de chatte consentante, son visage se figeait dans une attente souriante, son œil battait la campagne et il devenait urgent de prendre une décision. De deux choses l’une, soit nous restions cloîtrés dans la chambre, avec au ventre la peur que notre absence prolongée n’éveillât des soupçons, soit nous partions en quête d’un lieu improbable pour nous isoler du reste du monde. C’était selon l’humeur du moment et selon la semaine. Il était plus facile de prendre la poudre d’escampette quand Nelleke me rendait visite à la lisière du bois de l’Échevinat. Chez elle toutefois – elle habitait provisoirement la banlieue du chef-lieu – il y avait un long jardin au fond duquel s’étiolait une collection de faisans. Nous y descendions sans sa culotte, sous l’œil bienveillant de ses parents. Nous contemplions un moment, dans un rayon de soleil, les allés et venue de l’animal doré qui ruait dans la poussière de son étroite prison, puis nous remontions lentement vers la maison, longeant les espaliers jusqu’aux deux grands sapins entre lesquels se dressait, à l’abri des regards de la baie vitrée, une balançoire. Relevant son ample jupe, elle prenait position, les mains crispées sur les cordes en nylon qu’elle entourait de ses jambes afin de se tenir accroupie sur la planche étroite. L’arrière de sa robe frôlait la pelouse tandis que j’imprimais un lent balancement au fragile édifice. L’exercice avait rapidement raison de notre bucolisme. Il fallait alors se recomposer une prestance afin de passer la douane parentale et gagner les étages où nous baiserions frénétiquement sur The Year of the cat de Al Stewart ou Sad Lisa de Cat Steven. Avant cela, nous nous embrassions passionnément en nous serrant très fort, nous réajustions nos effets puis, main dans la main, les lèvres gonflées, les doigts poisseux, le cheveu collé, nous regagnions dans un silence contrit le pavillon de meulière où devait s’accomplir le forfait.
C’était l’année du bac, quand nous ne baisions pas, je lui lisais des poèmes de Saint John Perse dont je lui avais offert les œuvres complètes pour son anniversaire, un volume de la pléiade que j’avais chouré à Carouf. Mais je vous parle d’un temps où les moins de vingt ans ne disaient ni chourer ni Carouf… Des songes vastes comme des mers nous laissaient au soir pantelants et ivres, aux marches des palais municipaux sculptés de pampres et d’acanthes. Un vent de conquête portait déjà jusqu’à nos oreilles ultramarines le glas de nos défaites et de nos esclavages.
Durant cinq ans, les vers d’Apollinaire coulèrent sous les ponts. D’autres amours venaient obscurcir nos cœurs baveux mais notre relation tenait bon. À cette époque, des idées sur la liberté sexuelle circulaient. Ça nous arrangeait bien. La dernière fois que nous fîmes l’amour, j’avais passé la nuit chez ses parents, dans l’immense bâtisse qu’ils avaient fait construire au milieu d’un bois privé. Chaque chambre était équipée d’une salle de bain. Hélas, le bâtiment était situé sur une ancienne carrière de fours à chaux dont le sous-sol calcaire était truffé de galeries. De larges fissures usherisaient la maison qui heureusement était de plein-pied. Dans le milieu de l’après-midi, Nelleke était entrée dans ma chambre et m’avait proposé une séance de relaxation. Elle avait retiré le bas et m’avait chevauché lentement, mettant en pratique les enseignements acquis au cours d’un stage de bien-être tantrique pour adultes avertis. Ma vie n’avait pas de sens, je bandais mou, je n’étais en mesure ni de donner de l’amour, ni d’en recevoir. Elle était parvenue néanmoins à me faire éjaculer. Nous n’utilisions jamais de préservatifs.
Ornella
Ornella aimait bien les barbus. Elle était mince, fessue et légèrement prognathe. Elle avait de grands yeux pour mieux me charmer et un grand nez qui coulait dans mon cou. L’Italie tanguait dans ses veines. Elle vivait avec sa mère, une femme belle et avisée qui me regardait avec une bienveillance suspicieuse. Son oncle, un homosexuel excessivement sympathique, à la barbe noire et drue, était très présent. Il gérait un hammam dans le quartier.
Nous nous étions rencontrés sur les bancs de l’université de médecine au CHU de Bichat, dans le XVIIIe arrondissement. Le stress du concours faisait frémir davantage le spa hormonal dans lequel nous barbotions. L’urgence gouvernait nos cœurs tendres. En quelques heures nous avions édifié un château de caresses. Main dans la main nous étions monté à la Gloriette de Buffon, belvédère néoclassique bourré de symboles, où l’amour kiosquier distribuait des baisers à un sou. Je lui racontais que j’avais appris à marcher dans ces allées du Jardin des Plantes. Un moineau était venu se poser sur sa main gantée de laine pour lui confirmer que l’amour était au rendez-vous. Je déposais des baisers sur ses lèvres gercées et glissais ma main sous son manteau.
Un jour où nous avions passé le weekend chez la grand-mère d’une amie commune, moulées dans des pyjamas de laine grise, les deux filles s’étaient introduites dans ma chambre afin de réveiller le démon de onze heures du soir qui, elles en étaient persuadées, sommeillait au fond de moi. Je n’avais pas cédé à leurs provocations de chattes ronronnantes, incertain du sens à donner à leur complicité.
Ornella m’avait quitté au bout de quelques semaines au prétexte que l’amour allait la ramollir et diminuer ses chances de réussite au concours d’entrée en médecine. Je n’étais pas de taille à affronter l’expérience d’une mère que n’encombrait la présence d’aucun homme.
Pauline
Pauline était discrète avec des poussées d’exubérance imprévisibles. Nous nous étions embrassés sur la bouche dans un escalator, sur le rythme de Bad, Bad Leroy Brown de Jim Croce, mort à trente ans dans un accident d’avion. C’était la mode des baladeurs. Elle m’avait tendu l’un de ses écouteurs. Nos visages s’étaient rapprochés.
Lors d’un weekend entre potes à la campagne, organisé chez papa-maman, elle s’était retrouvée dans mon lit. J’étais fou de ses longs cheveux noirs et lisses qui me cisaillaient les lèvres quand nous nous embrassions. Au matin, ma petite amie nous avait rejoints en disant, moi aussi j’ai envie de venir dans ton lit. Et voilà André en majesté, christ pathétique crucifié par la blonde et la brune, à suivre des yeux les veines du lambris qui recouvraient le plafond.
Ce fut ma seule expérience de polyamour.
Je quittai la région peu de temps après, un peu largué, un peu naze, à la recherche d’une boîte de jazz.
Quetty
Nous avions fait ensemble une première année de médecine. Contre toute attente, sa sœur Janice avait réussi le concours d’entrée à l’école des Beaux-arts. Un ami de Janice avait été recallé malgré ses dons incontestables pour les arts graphiques et sa faculté à imiter les pianistes de jazz devant un clavier imaginaire en faisant des mimiques inspirées de certains personnages de Gotlib. Ces démonstrations recevaient l’approbation louangeuses des deux sœurs. Sa personnalité trop affirmée lui avait été préjudiciable. Son échec au concours l’avait dévasté et il s’était éloigné de Janice dont il ne pouvait admettre le succès. Je regardais tout ça d’un œil torpide et légèrement suintant. Nous étions restés en contact, Quetty et moi, malgré les déconvenues.
Quetty avait redoublé sa première année de médecine tandis que j’étais entré au service culturel d’une mairie de l’Essonne sur les recommandations de José, le directeur du conservatoire de musique. J’avais acheté un radiocassette avec mon premier salaire.
Mes parents habitaient le même lotissement que José. Sa femme, charmante et posée, était le professeur de français de mon frère. Elle donnait des cours de théâtre auxquels je m’étais inscrit. Je passais parfois lui dire bonjour dans sa maison, en bordure du bois de l’Échevinat. C’est ainsi que j’avais rencontré José. Il accompagnait au violoncelle, une jeune flûtiste qui préparait un concours, une partition moderne qui demandait de l’engagement. Il m’avait prêté des disques de Bartók, de Charlebois, de Nougaro et d’Anne Sylvestre.
Alors que nous parlions de mon avenir sans avenir, il avait déclaré, pour plaisanter, que le service culturel de la mairie où il travaillait recherchait un factotum. Je l’avais pris au mot et un mois plus tard, j’embauchai à ce poste pour lequel j’étais surqualifié malgré ma scolarité inachevée. Le seul diplôme exigé était le permis B. Mes parents sidérés n’avaient pas fait de commentaire. Sans doute étaient-ils déçus mais leur divorce mobilisait toute leur énergie. Eux aussi devaient se bricoler un avenir. Ma mère prenait des cours de comptabilité et mon père envisageait de construire une seconde maison dans le trou du cul de la diagonale du vide.
L’essentiel de mon travail consistait à coller sur les panneaux d’affichage métalliques de la ville, les affiches annonçant les événements culturels organisés par la municipalité. Je disposais d’une 4L fourgonnette (L pour Luxe) qui me servait aussi à réaliser diverses courses. Je montais parfois à la capitale, récupérer des partitions chez un éditeur qui avait pignon en bordure du Palais Royal. Je participais à l’aménagement des salles de spectacle en transportant des pupitres. Il m’arrivait de porter un dossier au service comptabilité de la mairie. J’imprimais également les stencils (l’ancêtre de la photocopieuse). Mais je préférais par-dessus tout entrer frauduleusement dans l’enceinte de Rungis, au volant de mon véhicule aux armes de la ville, pour déjeuner d’un hareng baltique en compagnie d’un complice de la compagnie de théâtre que je fréquentais. Je bénéficiais également des invitations gratuites que les troupes de théâtre envoyaient à la mairie dans l’espoir d’entrer un jour dans la programmation de la municipalité. Cela me permettait d’inviter mes copines qui avaient l’impression de sortir avec un homme de l’ombre important qui tirait les ficelles de la scène culturelle.
Je n’avais pas été long à me rendre compte que José était un coureur de jupons aux habitudes bien ancrées. Je le soupçonnais de ne pas se contenter des cotillons. Je me demandais accessoirement s’il était possible de tromper une femme aussi adorable que la sienne.
À l’occasion d’un stage de musique d’ensemble qu’il organisait, José m’avait demandé si j’avais une copine qui serait intéressée par une semaine de baby-sitting. Il devait emmener avec lui son jeune fils car sa femme suivait un stage pour devenir formatrice pour adulte. À l’époque, il s’intéressait au premier violon de la formation. Ce violon était joué par une jeune-fille que je trouvais bien sage et mal fagotée.
J’avais tout de suite pensée à Quetty. Etudiante en médecine, belle, la langue bien pendue, elle saurait rassurer l’artiste et lui tenir tête le cas échéant. Elle avait besoin d’argent et la perspective de se mettre au vert pour réviser les épreuves du concours l’excitait. Quetty avait toujours l’air très excitée. Elle riait sans retenue à tout propos. Son rire se reconnaissait entre mille. C’était sa façon de masquer sa peur de décevoir et d’être rejetée. Son père était un affreux bonhomme qui planquait son incapacité à donner ou recevoir de l’affection, derrière des exigences ubuesques et une sévérité de nazi.
Le petit garçon avait adoré sa nounou, José m’avait remercié avec des étoiles dans les yeux et Quetty m’avait raconté comment, un soir, un musicien était venu la rejoindre dans son lit sans crier gare. Eh bien José, que se passe-t-il ? Elle ne s’était pas démontée et avait accueilli l’étalon à sa façon. Quand il avait commencé à la pénétrer, elle avait eu ces paroles navrantes, José, tu es trop gros, ça me fait mal. L’honneur était sauf et ils avaient continué à se galocher secrètement durant tout le séjour. Quetty avait des lèvres ravissantes qui allaient bien avec son rire. Elle était en quette d’attention en permanence. On aurait tellement aimé qu’elle fût heureuse pour de vrai.
Ce stage de musique d’ensemble avait néanmoins eu la vertu de libérer Quetty de quelque chose, d’un poids dont je ne saurais dire exactement la nature. Du moins, c’est ce que je pensai lorsqu’elle me proposa de faire l’amour. Je n’étais pas très à l’aise, son corps blanc restait immobile sous mes caresses. Elle m’attira contre elle pour que je la pénètre. Son sexe était dure et sec comme une patte de poulet. Elle voulait vérifier quelque chose. Elle ne riait plus. Aucune jouissance ne couronnât cette sinistre cérémonie.
Elle m’avertit peut après qu’elle avait contracté une Gonorrhée. Je m’empressai de faire un dépistage des MST les plus courantes et lui communiquai les résultats négatifs de ma liste. Elle me remercia d’avoir fait la démarche sans avoir présumé qu’elle était à l’origine de l’infection.
Je ne parlai pas de l’incident à José. Cette histoire se terminait en eau de boudin. Quetty échoua une deuxième fois au concours de médecine et s’engagea dans de brillantes études d’infirmière.
Rose
Rose avait une tête de canard et ses yeux pétillaient sous ses lourdes paupières. Sa bouche large affichait des dents inclinées dont aucun appareil dentaire n’était venu diminuer l’angle nadiral, ni réduire l’espacement. Elle était bavarde, éloquente et vive, et son rire enjoué retroussait souvent ses lèvres couleur framboise. Ses cheveux étaient crépus. Elle avait peur de les perdre. Rose avait de l’humour et un esprit caustique. Nous nous appréciions car nous partagions le goût du calembour à la pistache, une spécialité qui faisait paraître moins arides les cours auxquels nous assistions sur les bancs de bois des amphithéâtres.
Je l’avais invitée à venir passer un weekend à la campagne, chez mes parents. Elle avait jugé l’idée recevable et nous avions, durant une nuit entière, chuchoté sous le drap, dans l’obscurité de nos vingt ans. Elle m’avait raconté comment un ami de son père lui avait glissé un doigt dans la chatte lors d’une réunion de famille. Je crois que j’aime les vieux, m’avait-elle confié horrifiée. Ça l’inquiétait, elle pensait qu’elle n’était pas normale. Le manque de sommeil avait rendu ma voix légèrement rauque. Sa chevelure crépue me chatouillait le nez lorsque j’approchais ma bouche de son oreille pour lui parler. Elle m’avait dit que ma voix l’excitait. Plus précisément, elle avait dit, oh ta voix… Nous nous étions assis sur le bord du lit pour voir l’aube se lever. Elle avait jeté un œil entre mes cuisses pour vérifier que je bandais. J’avais été surpris par ses nichons gros et fermes qui affichaient un profond mépris pour la physique de Newton. Elle avait fini par me dire, André, j’ai très envie de faire l’amour. Je pouvais sans la toucher sentir la chaleur de son corps. J’avais expliqué que nous risquions de réveiller ma mère qui dormait derrière la cloison, à quelques centimètres.
Le lendemain, en fin de matinée, après avoir essayé de rattraper notre nuit blanche, nous étions descendus pour le déjeuner. La nuit, ou plutôt le sommeil, m’avait soufflé ce constat : André tu es un sacré couillon. À plusieurs reprises, j’avais tenté de nouveaux rapprochements. Rose restait indécise.
Le hasard frappa ce jour-là à ma porte. Trois amis de lycée anarchistes avaient eu l’idée de me rendre visite. C’était la deuxième fois en quatre ans. Ils étaient toujours aussi moches et leurs propos de génies attardés toujours aussi provoquants. Rose avait très vite décrété qu’elle qu’elle allait prendre l’air dans le jardin.
Je faisais la navette entre mes amis et Rose, incertain sur le tour qu’allaient prendre les événements malgré ma détermination à rattraper le coup : j’avais décidé que j’étais amoureux de Rose, nous allions trouver un moment pour faire l’amour dans un coin de la maison afin de sceller notre idylle, nous marier rapidement et le premier enfant ne tarderait pas à venir. Comme dans un rêve américain, j’allais trouver un job à quatre chiffres.
Hélas, le jour avait endommagé la magie de la nuit. Nous avions, ma mère et moi, raccompagné Rose à la gare et nous ne l’avons jamais revue.
Sheyda
Sheyda était la meilleure amie de Rose. Rose était juive et Sheyda iranienne. Rose n’était pas tendre avec sa protégée qui obtenait de piètres résultats scolaires. Une solidarité orientale rassemblait les deux filles par-delà leurs différences de caractères. L’une était spirituelle, faussement détachée et rieuse, l’autre était séductrice, sincère et doucement maladroite. Sheyda, c’est une pâte, disait Rose avec malice et sans doute une pointe de jalousie. J’étais resté en contact avec Sheyda pendant qu’elle redoublait sa première année de médecine. Mon emploi de factotum au service culturel d’une mairie de l’Esonne faisait de moi un garçon sans avenir, disponible et décontracté.
Elle habitait en coloc avec deux garçons d’une beauté aristocratique, grands, intelligents, mystérieux. Je ne voyais pas quelle valeur ajoutée je pouvais apporter à la belle Sheyda. J’avais discuté avec le grand brun autour d’un maté. Il était revenu du Brésil avec calebasses et bombillas, accro à cette infusion stimulante, riche en caféine. Son univers semblait s’articuler autour de ce poison de la famille du houx qu’il laissait infuser toute la journée. Je n’avais pas eu de contact avec le blond mais je savais que Sheyda avait couché avec lui. Sheyda avait une abondante chevelure noire et j’imaginais qu’il lui avait suffi d’ôter une chaussure pour séduire le grand blond. Elle m’avait informé que les grands gars n’étaient pas toujours ceux qui avaient les plus grandes queues. Elle savait qu’elle échouerait de nouveau au concours d’entrée en médecine et elle comptait profiter de la France et des Français, avant que son père ne l’envoie en Belgique où le concours était moins élitiste – j’avais traduit, se taper tous les mecs de la Terre. La sincérité de Sheyda n’était plus à démontrer.
La simplicité de Sheyda me reposait mais ne me séduisait pas. J’avais alors le goût des sophistications à deux sous. Probablement à cause d’un complexe d’infériorité intellectuelle. Par ailleurs, son intérêt plus ou moins larvé pour les grands sexes me disqualifiait a priori. Je restais bon camarade mais espaçais nos rencontres car son ardeur me fendait le cœur.
L’avant-dernière fois où nous nous vîmes, elle m’avait invité dans un café très sélect du boulevard Saint-Germain. Elle s’était habillée chic, jupe fendue, petite culotte en satin rose, corsage blanc très échancré. Elle était belle comme une princesse orientale, ses cheveux étaient partout, ses lèvres vermillonnaient, sa peau, lisse comme la surface d’un lac de Côme dépourvu de cygnes, diffusait un parfum complexe et généreux qui bousculait mes sens et ses yeux noirs avaient jeté au fond des miens, deux ancres de titane aux barbelures effervescentes. Le service était lent, mon cerveau se laissait aller à cette indolence pendant que mon corps énervé cherchait à me dire quelque chose. J’étais fringué comme l’as de pique mais Sheyda m’enveloppait de ses regards à la fois tendres, braiseux et bienveillants. C’était un dimanche soir, je travaillais le lendemain matin, je balisais.
L’heure du dernier train s’éloigna dans le brouillard de mes hésitations. Elle m’invita à passer la nuit avec elle. L’un de ses oncles lui avait prêté les clés de son appartement qui se trouvait à deux pas. Elle avait tout organisé, son plan se déroulait sans accros. J’étais piégé. Elle allait me sortir des dessous de folie, j’allais perdre mon job, son oncle déposerait quelques francs dans mon godet quand il passerait devant moi, en bas de chez lui.
Durant toutes les années que j’ai passées à Paris, je n’ai rencontré des connaissances dans la rue que trois fois. L’apparition de ces deux collègues architectes, un dimanche soir minuit sur le boulevard Saint-Germain, sont de celles-ci. Toujours charrettes, ils travaillaient sept jours sur sept jusqu’à pas d’heure. Ils avaient eu besoin de venir se ressourcer dans la ville-lumière, le temps d’une bière ou deux.
La négociation avait pris quelques secondes. Je n’ai plus de train, vous pouvez me ramener à Bourg-en-Essonne ? Pas de problème mais on vient d’arriver, on va boire un verre quelque part, avant. Je pris congé de Sheyda. Ma honte était à la hauteur de mon soulagement. J’accompagnai les deux larrons en me faisant le plus discret possible.
Je revis Sheyda une dernière fois lors de mon anniversaire auquel j’avais invité ce qui me restait d’amis de fac de médecine. Ça se passait au milieu d’une pinède, dans l’auberge de jeunesse de mon village d’enfance, à soixante kilomètres de Paris. Ils étaient venus nombreux. Sheyda était accompagnée d’un homme que je ne connaissais pas. Elle m’avait offert une bouteille de Grand Marnier hors de prix emballée dans un grand sourire. Je lu dans ses yeux que je n’avais qu’un mot à dire.
Plusieurs petits groupes s’étaient formés dans la pinède, chacun pensant que je faisais partie de l’un d’entre eux. Je m’étais isolé, en proie à une mélancolie sans fond et n’avais pas tardé à rejoindre ma chambre, chez mes parents. J’avais envie de tourner la page d’une vie en chute libre. Je savais que jamais je ne reverrai ces amis. L’un d’eux s’était approprié la bouteille de Grand Marnier. Je ne dirai pas lequel.
Talene
Talene était norvégienne. Elle attachait ses cheveux blonds et frisés derrière la tête. Elle était grande, pas très sportive, charnue et généreuse. Elle pensait qu’elle pourrait mener de front l’apprentissage de la langue française et le concours d’entrée en médecine. Elle était ambitieuse. Elle redoublait sa première année. C’est elle qui organisait nos vacances à la neige.
La première fois où nous partîmes dans les Alpes, nous étions cinq dans sa petite voiture rouge. Nous nous relayions au volant, elle et moi. Nous avions passé la nuit à préparer notre voyage. Je conduisais dans un état second tandis qu’elle somnolait à la place du mort. Derrière moi, la petite fille d’un maréchal de France fixait le paysage d’un œil vitreux, l’esprit englué dans un demi-sommeil paradoxal.
Talene avait enregistré des chansons et des morceaux de musique sur une mini cassette. Elle me demanda si elle pouvait dormir un peu. Dis-moi que tu m’aimes, même si c’est un mensonge, chantait Lio. Talene tolérait le mensonge. Elle avait envie que je lui dise que je l’aimais, mais je ne savais mentir qu’à moi-même. La Petite Musique de Nuit de Mozart prit le relai. J’étais convaincu que cette musique était tellement parfaite, ou pour le moins incarnait tellement la perfection, que les Romantiques qui écoutaient cette sérénade posthume au XIXe siècle n’avait d’autre perspective que la décadence. Je me disais aussi que cette berceuse représentait pour nous un danger véritable car son titre n’était pas usurpé. C’est la dernière pensée dont je me souviens. J’eus la sensation étrange que mon cerveau quittait ma boîte crânienne pour se positionner juste au-dessus. Derrière moi, la petite fille du maréchal fixait la barrière de sécurité en se faisant la réflexion qu’à force de s’en rapprocher, nous allions la percuter. Curieusement, aucun son ne sortait de sa gorge engluée de fatigue.
Un grand bruit résonna dans ma tête. Mon cerveau regagna lentement sa boîte crânienne et je revins à moi. La voiture allait bon train sur la file de droite de l’autoroute du soleil. Ma première conviction fut que nous avions perdu un ski. Je jetai un œil dans le rétroviseur. Il n’y avait plus de rétroviseur. Je me garai sur la bande d’arrêt d’urgence. Nous constatâmes les dégâts. Une bande grisâtre d’une hauteur de vingt centimètres courrait d’un bout à l’autre du véhicule. Les portières étaient toujours fonctionnelles. Nous nous embrassâmes et continuâmes notre route, impatients d’affronter les pistes enneigées. Talene avait repris le volant. Amoureux imaginaires, après tout qu’importe que nos vies aient l’air d’un film parfait. Heureusement, nous n’étions pas encore concernés par les choses de la vie.
Le soir, avant de nous souhaiter bonne nuit, Talene et moi avions discuté un moment. Elle me disait qu’elle était contente que nous soyons arrivés les premiers, que les autres arriveraient probablement le lendemain. Ses gros seins bougeaient sous sa nuisette. Elle serrait ses doigts entrelacés en tordant ses bras nus hyperlaxes.
Talene et la petite fille du maréchal avaient choisi la meilleure chambre, tout en haut sous le toit où il y avait juste la place pour un petit lit double. Le matin elles nous avaient invités, un garçon et moi, à les rejoindre dans leur lit. Talene me tournait le dos. Elle tenait des propos exubérants en désarticulant son corps sous le drap. Lorsqu’elle se cabra, ses fesses vinrent au contact de mon sexe dur.
Talene finit par se rapprocher d’un garçon taciturne et doux. Il était plus âgé que nous et portait la moustache. Il faisait des études d’histoire et passait son temps dans les bibliothèques, à reconstituer les arbres généalogiques de familles aux passés obscures.
Avant de retourner en Norvège, après avoir échoué une seconde fois au concours d’entrée en médecine, Talene me dit qu’elle était triste. Je la revis une dernière fois à Oslo, l’été suivant, lorsqu’elle passa nous dire bonjours chez Vicky, la copine qui m’avait invité. Talene voulait se lancer en politique. Elle nous avait raconté que sa mère avait fait disparaître ses cheveux blancs en mangeant du blé cru.
Unnveig et Vicky
À une époque, je passais une partie de mes soirées à la Maison de Norvège, dans la Cité internationale, 17 boulevard Jourdan. Talene, une amie de l’université, m’y avait invité. J’avais fait, là-bas, la connaissance d’Unnveig et de Vicky, deux amies aux cursus pas très clairs.
Unnveig avait un visage de star et le corps de madame tout-le-monde. Ses cheveux naturellement blonds platine lui descendaient jusqu’aux coudes. Dès l’âge de seize ans, elle avait appris à vivre seule dans l’appartement que son père, un homme d’affaire Norvégien, avait mis à sa disposition. Elle s’habillait simplement, ne sachant pas si son merveilleux visage était un atout ou un inconvénient. Nos incertitudes dans l’avenir nous avaient rapprochés. Nous avions échangé des confidences et des baisers.
Notre idylle avait les hauts et les bas de son humeur, tantôt enthousiaste, tantôt déprimée. Au fil des semaines, je perdais espoir. J’avais l’impression qu’elle était vierge et qu’elle voulait le rester. Un soir où je m’étais arrangé pour oublier l’heure du dernier métro, elle m’accueilli dans son lit. Elle me tournait le dos. Sa peau n’était pas douce. Elle était nerveuse et insensible à mes caresses. Soudain l’amante esquiveuse saisit ma queue et tenta sans préambule de l’introduire dans son anus. Le sentiment de la violer me fit débander. Notre sommeil fut lourd et au matin, nous nous quittâmes comme si rien ne s’était passé.
J’attendais beaucoup du dépaysement qu’allait nous procurer une semaine de sports d’hiver en Haute-Savoie. Il y aurait Talene, Unnveig, Wicky, un déserteur Norvégien féru de nouvelle philosophie et skieur hors pair, la petite fille d’un maréchal de France, mon frère et un bonapartiste homosexuel Corse, cuisinier au chômage, heureux au jeu et ancien séparatiste… Nous serions douze au total à partager le même chalet.
Unnveig fut rapidement prise d’angoisse devant les plats couteux et sophistiqués que nous préparait notre cuisinier corse. Son budget ne lui permettait pas de mener un tel train de vie. Elle refusa de manger. Le jour suivant, le Corse descendit au PMU du village. Il ne gagnait que lorsqu’il était dans le besoin. Il revint, le coffre de sa DS verte rempli de victuailles et la fête put continuer.
Unnveig avait proposé à un ami Allemand de passer nous voir au chalet le temps d’un weekend. Il était grand et sportif, il sentait bon la moulure et la hauteur sous plafond, sa tête mobile faisait danser ses cheveux bouclés autour de son visage au menton volontaire. Il faisait des études en aéronautique. Unnveig flirtait avec lui en allemand sur le canapé, je ne l’avais jamais entendu rire aussi fort. Ses sourires la rendaient encore plus belle. L’Allemand parlait et riait haut, lui aussi. Il avait pris possession de ma copine au visage de star sans se poser de question. Son enthousiasme faisait plaisir à voir. Mes amis n’osaient pas me regarder dans les yeux. Curieusement, je n’éprouvais aucune honte, tout au plus un sentiment où se mêlaient fatalité et perplexité. À tout le moins apparemment.
Dans la soirée, alors que j’étais prostré sur mon pouf, à deux mètres du canapé où l’Allemagne et la Norvège se galochaient, Vicky – rappelez-vous, la meilleure amie d’Unnveig – à laquelle je n’avais pour ainsi dire jamais adressé la parole, essaya de dédramatiser la situation en prenant des poses de comédienne shakespearienne, se frappant le front et la poitrine en hurlant « Ah ! André ! ».
Levant les bras au ciel, j’entrai dans son jeu en criant « Ah ! Vicky ! ».
La jeune comédienne s’engouffra dans le malentendu et me tomba dans les bras, fourrant d’autorité dans ma bouche, une langue musclée comme une palourde. La soirée fut torride. Nos deux couples improbables s’éclataient sous les yeux incrédules de l’aimable société témoin de ce formidable rebondissement digne du festival international du film fantastique d’Avoriaz.
Unnveig me glissa en aparté qu’elle était fière de moi. Je ne compris pas le sens de ces paroles. Peut-être avait-elle le goût du panache, de l’excès, de la luxure. Etais-je passé à côté de tout cela sans rien pressentir de sa véritable nature ?
Si la soirée fut torride, la nuit le fut davantage. Le poids plume de Vicky convenait parfaitement au lit superposé une place que j’occupais. Nous avions passé la nuit à jouir discrètement, contraints à l’emboîtement par la proximité du matelas du dessus.
Le lundi matin, l’Allemand pris congé et les ennuis commencèrent. Unnveig expliqua à sa meilleure amie qu’elle devait mettre un terme à notre relation. Elle la remerciait d’avoir correctement géré l’alternance mais elle devait maintenant reprendre la place de dame de compagnie qui était la sienne, retourner à l’effacement et au silence. Les meilleures amitiés ont une fin. Elles échangèrent des propos acerbes en norvégien vernaculaire et chacune resta sur sa position.
Le fait est que dans les semaines qui suivirent, Vicky la victorieuse fit grâce à moi des progrès considérables en français. Je me mis à apprendre le norvégien, langue à la grammaire aimable et à la prononciation chantante. Je savais demander où se trouvaient les toilettes lorsque j’entrepris de rejoindre Vicky à Oslo, où celle-ci m’attendait.
Je fis le voyage en autostop. Je gagnai assez rapidement la Belgique. Un poids lourd me fit traverser nuitamment une partie de l’Allemagne. Plus je remontais vers le nord de l’Europe, plus il était aisé de faire de l’autostop. J’attendais rarement plus d’un quart d’heure. Nous échangions dans cet anglais européen rudimentaire et compréhensible qui n’a rien à voir avec la langue de William Blake. Une journée me fut encore nécessaire avant de poser le pied sur le sol suédois, après avoir pris le bac à Copenhague.
Je n’avais presque pas dormi et avais perdu une partie de mon discernement. La nuit n’avait pas l’air décidée à tomber et il n’y avait pas d’endroit où déplier mon bivouac. Je décidai de continuer. Leurs lignes arrondies donnaient aux voitures Volvo un côté rétro. La lettre S imprimée à l’arrière de nombreux véhicules m’interpela. Comment expliquer la présence de tous ces Suisses qui parcouraient le pays ? Il me faudrait plusieurs heures avant de réaliser que ce S signifiait Suède et non pas Suisse (dont le code sur plaque minéralogique, comme chacun sait, est CH pour Confédération Helvétique). C’est peu dire l’état de fatigue dans lequel je me trouvais.
L’une de ces voitures aux courbes cubaines stoppa sur le bas-côté à une trentaine de mètres devant moi. Une jeune femme en descendit en short pour mettre quelque chose dans le coffre. La porte du coffre ne fermant plus, elle dû la maintenir au moyen d’une corde ou d’un sandow. Je continuais à tendre le pouce en l’observant. Les trente mètres qui nous séparaient étaient insuffisants pour que je ne m’aperçusse pas que c’était bien une Suédoise malgré le S de sa plaque minéralogique. Pas le genre de nana qui s’arrête pour prendre en stop un pouilleux comme moi. Puis elle se retourna et fit de grands signes dans ma direction. Peut-être avait-elle besoin d’un coup de main pour sécuriser la fermeture de son coffre ?
Elle avait débarrassé le siège avant pour faire de la place à mon cul de Français et à mon sac à dos à armatures. Je n’en revenais pas, j’osais à peine poser les yeux sur sa beauté septentrionale. À l’arrière, un bébé était allongé dans un siège auto dépourvu de sangles, flanqué de trois chiens dont un grand setter roux qui semblait être le chef de meute. Les fauteuils de la voiture étaient plus confortables que ceux du salon de mes parents.
La fille rejoignait la maison où elle avait grandi, du côté de Karlstat. Notre anglais était fluide et nous partagions a priori les mêmes valeurs de liberté optimiste. Je n’osais pas aborder le sujet mais j’imaginais une séparation, le départ du père du nourrisson pour un pays lointain et moi, l’homme providentiel aux charmes duquel la jeune fille merveilleuse avait succombé. L’amour s’était installé dans notre couple comme un chat sur une couette au pied d’un lit. J’avais repris des études pour devenir le brillant ingénieur des eaux et forêt que la Suède attendait (je n’avais eu aucun mal à apprendre le Suédois). Mais ne brulons pas les étapes. Nous avions devant nous six cents bons kilomètres de résineux pour nous découvrir.
Nous faisions régulièrement des pauses. En voyant la jeune-femme se dégourdir en levant les bras et pliant les genoux, je repensais à ces reportages sur l’hygiénisme et la gymnastique suédoise. Ce n’était donc pas un mythe. En soi ce n’étais pas un problème, à défaut de gagner en taille, je saurais devenir l’athlète que j’avais toujours rêvé être.
Très vite elle me proposa de prendre le volant pour pouvoir se reposer. En cette saison, la nuit tardait à venir et ne remplaçait pas tout à fait le jour. J’avais l’impression de vivre un jour sans fin. Nous parvînmes à une vingtaine de kilomètres de notre destination. Mais dans destination il y a destin et parfois le destin se mêle de ce qui ne le regarde pas. Je m’apprêtai à annoncer que j’allais pouvoir tenir le coup sous réserve qu’elle restât éveillée, quand elle ouvrit la bouche pour me demander si elle pouvait dormir un peu.
À l’étroit dans sa côte de mailles toute neuve, le benêt chevalier répondit, no problem, have a rest ! Dans la vie, il faut savoir dire non (dans la mort il faut savoir dire oui). Mais je n’avais pas la carrure. Ainsi prit fin notre belle, notre merveilleuse idylle. Mais sans doute souhaitez-vous avoir plus de détails. Rassurez-vous, je ne vais pas vous abandonner à un moment si dramatique.
J’essayais d’atténuer l’effet des virages qui secouaient la voiture et ses occupants. Ma conduite souple y parvenait sans effort tandis que je me faisais la réflexion que ces virages étaient les bienvenus car ils avaient pour effet d’augmenter mon attention et d’éloigner le sommeil. Je me disais aussi qu’il fallait prendre garde au ruban gris qui, à la sortie du dernier virage, montait à travers la futaie comme une épée de Damoclès. À ma connaissance, les lignes droites favorisaient la prise de vitesse et l’endormissement. C’était la dernière pensée pertinente dont je pus me souvenir lorsque je m’éveillai dans un sous-bois digne du conte de la Belle au bois dormant. Une brume surnaturelle montait entre les branches dans la lumière dorée des phares. C’était donc vrai, j’allais retrouver ma belle endormie ?
Un seul tour fut nécessaire à mon sang pour rendre à mon cerveau sa dignité de sapiens. Je me retournai, récupérai le bébé sous les pattes des chiens. Je croisai le regard un peu fou du grand setter encore sous le choc. Il était le seul témoin de l’accident. L’aile droite avait frôlé un premier poteau télégraphique, nous avions sectionné net un arbuste de belle taille en franchissant le talus, l’aile gauche avait frôlé le poteau télégraphique suivant, puis des arbrisseaux avaient freiné le véhicule dans sa course avant qu’il ne s’immobilise, une cinquantaine de mètres à l’intérieur de l’étendue tourbeuse. Si nous avions quitté la route cent mètres plus loin, nous nous serions fracassés sur une barrière rocheuse.
Très vite, nous regagnâmes la route avec le bébé que nous installâmes dans une poussette, laissant les chiens dans la Volvo. Très vite une voiture s’arrêta et repartit avec pour mission d’appeler des secours. Il n’y avait a priori pas de place pour nous charger. L’attente commença, interminable. Nous nous employions à chasser les dizaines de moustiques qui avaient pris le bébé pour cible. Les cuisses de ma fiancée rougissaient à vue d’œil sous l’assaut des diptères hématophages. Je protégeais mon visage comme je pouvais.
Nous fûmes enfin rapatriés. Je fus conduit à une chambre. L’on m’ordonna de m’endormir le plus rapidement possible. À mon réveil, il était midi. Je retrouvai la fleur de ma vie autour d’une table chargée de victuailles. Ses parents ne se lassaient pas de nous regarder manger. Par la fenêtre, je vis les douces courbes de la Volvo qui stationnait, le bec sous son aile repliée. Devinant ma pensée, le père me dit, dans un anglais approximatif, que je ne devais pas m’inquiéter pour la voiture, que le principal était que nous fussions en vie. Un faible sourire éclaira le visage boursouflé de sa fille.
Le repas terminé, je pris congé sans promesse d’aurevoir et me dirigeai vers la sortie de la ville. J’attendis un quart d’heure pour laisser le temps à ma promise de me rejoindre en criant, je t’en prie ne part pas (en anglais je suppose, please don’t leave). Le quart d’heure s’écoula sans qu’aucun véhicule ne s’arrêtât. Le cœur n’y était plus, je décidai de gagner Oslo en train.
Vicky habitait un pavillon de banlieue. Elle était enfant unique. Sa mère faisait des gâteaux à la cannelle et son père était ravi d’accueillir un garçon pour partager avec lui le plaisir dominical de nettoyer la berline familiale. Pour sa défense, il ne savait pas que je venais de contracter une amaxophobie sévère. Les parents de Vicky me considéraient déjà comme leur gendre et faisaient tout pour m’être agréable.
Oslo était une capitale triste. Au hasard de mes errements, j’assistai à un concours d’échec international, fréquentai un sauna ou le seul homme qui ne portait pas de serviette autour des reins avait un énorme pénis cramoisi qui ressemblait à un concombre Palomar, refusai d’assister des mineurs dans leur quête d’alcool fort, achetai Den lille prinsen et conseillai Madame Bovari à une jeune Norvégienne francophone à la recherche de bons romans. Je trouvai à Vicky toutes sortes de défauts, réels ou imaginaire et quittai le cocon familial au bout de cinq jours qui furent les plus longs de ma vie.
Je pris la direction du cercle polaire. Je me nourrissais de pain noir, de chou vert et de fromage brun – du Tine Brunost enrichi en fer sur décret de la couronne de Norvège. Les automobilistes ne s’arrêtaient jamais, mais ils acceptaient toujours de vous prendre en stop si vous leur demandiez gentiment. J’allais donc de stations-service en files d’attente de ferry, là où toutes sortes de véhicules faisaient la queue pour faire le plein ou traverser les fiords.
C’est dans l’une de ces queues que j’avais rencontré Alvheid. La femme avait la vitre de sa portière baissée. Je lui avais souri, elle m’avait souri. Il y avait du soleil. Après avoir hésité elle avait accepté que je monte à son bord. Elle allait à Bergen. Elle m’avait raconté qu’elle était en cure de désintoxication. Elle prenait ainsi régulièrement congé de son mari pour se ressourcer. Ça faisait plus ou moins partie de leurs accords. Elle venait souvent à Bergen où elle logeait dans la maison de son enfance que son frère habitait à temps plein. Celui-ci m’avait accueilli avec un regard soupçonneux et avait échangé avec sa sœur des propos où l’on pouvait déceler des accents de reproche. Mon frère est vieux jeu. Je lui ai dit que tu étais un autostoppeur qui visitait la Norvège, rien de plus, mais il ne m’a pas cru. Elle m’expliqua qu’elle avait longtemps eu un amant plus jeune qu’elle, un marin dont elle gardait sur elle une photographie. Il était mince et chauve. Il avait fini par se marier.
Elle m’avait laissé sa chambre et avait dormi dans le salon. Le lendemain matin, je l’avais trouvée le sourire jusqu’aux oreilles, couchée sur le côté, la tête sur son coude replié, dans une guêpière noire qui faisait la promotion de ses gros seins blancs. Craignant pour l’honneur de la famille, son frère n’avait pas tardé à rappliquer. Après un petit déjeuner copieux, je quittai la ville aux maisons de bois.
Je n’allai pas bien loin. Je fus pris d’un violent accès de fièvre. Je m’arrêtai en haut d’une falaise où nichaient des centaines d’oiseaux criards. Ne pouvant plus faire un pas, je me couchai dans mon bivouac au milieu des mouettes furieuses, attendant pour dormir, les quelques heures de vraie nuit où la chute des températures fermait provisoirement le bec des volatiles. Je restai ainsi trois jours à ruminer l’impasse existentielle dans laquelle j’avais choisi de m’aventurer. Je n’atteindrais jamais le cercle polaire. Ma décision était prise. Il me fallut vingt-quatre secondes pour abandonner mes ambitions boréales et autant d’heures pour regagner la Seine-et-Marne en autostop. À mon arrivée, je dormis dix-sept heures d’affilée. Je n’ai jamais fait mieux depuis.
Withney
Je ne me souviens plus comment j’avais rencontré Withney. Une amie d’une amie, probablement. Elle m’avait invité à passer la voir sur son île blanche. Elle habitait avec sa sœur chez ses parents, dans un pavillon situé au fond d’un terrain tout en longueur. Ses parents possédaient également le pavillon qui se trouvait sur la rue, à l’entrée du terrain. Ses deux frères logeaient dans ce premier pavillon qui accueillait une faune consommatrice de substances lénifiantes, dont un épagneul noir, fumeur passif qui avait failli m’arracher un ongle lorsque j’avais tendu vers lui ma main pleine de caresses.
Mon statut d’ami de Withney me donnait libre accès à ce monde étrange où la parole était brouillonne et le propos en décalage permanent. Je trouvais là des oreilles attentives que ma propension à l’amphigouri n’ennuyait pas. Il flottait dans l’air des parfums orientaux de transgression et d’aventure.
J’étais proche de l’un des deux frères qui confondait facilement aventure et délinquance. C’était donc à l’autre que j’avais proposé de partager mon poste de factotum. Il m’avait d’abord remplacé pendant mes vacances. Il avait fait une forte impression sur le service qui l’encensa à mon retour de congé. Fort de ce premier succès, je proposai au responsable du service, un breton athlétique qui écrivait des chansons et apprenait le japonais, que l’encensé et moi partageâmes le poste à raison d’une semaine sur deux. La proposition fut acceptée malgré la jalousie de certains fonctionnaires. Nous travaillions cinq jours et reprenions le collier neuf jours plus tard. À ce rythme, nous avions l’impression de vivre sans travailler. Un an plus tard, le frère de Withney prendrait le poste à temps complet. Je me souviens qu’il m’avait invité chez lui, à cette occasion. Il y avait une télé au pied d’un grand lit sur lequel se prélassait sa petite amie, une jeune fille qui avait tendance à abuser des bonnes choses et qu’il surveillait comme le lait sur le feu. Cette appétence pour le conformisme et la stabilité m’avait à la fois ému et déçu. Mais c’est une autre histoire.
J’avais proposé à Withney de participer à la location d’un chalet pendant une semaine de sports d’hiver. Il y aurait mon frère, quelques amis ainsi que des gens que je ne connaissais pas, un kinésithérapeute, une étudiante en médecine coréenne et deux institutrices australiennes. Withney accepta. Nous arrivâmes les premiers. Nous avions une après-midi à partager sur une île déserte. De fous rires en agaceries, nos bouches avaient fini par se rencontrer. Nous avions ri de nos nez trop longs qui faisaient obstacle à nos baisers. Comme la banquette était étroite, nous nous étions installés tête-bêche. Seul nos visages se recouvraient. Pour parfaire notre union, chacun enfonçait son nez dans la bouche de l’autre. C’était salé et curieusement érogène. Nous passâmes une bonne demi-heure à nous sucer l’appendice. Cette découverte majeure avait amorti notre séjour.
L’arrivée des autres occupants mit fin à nos nasalités. L’on nous fit remarquer que nos émonctoires étaient rouges comme des culs de babouins. J’expliquai que nous étions sortis nous promener sans cache-nez et que le froid nous avait saisis.
Xena
Mon emploi de factotum au service culturel me mettait en contact avec toutes sortes de gens. Monsieur Berger était un conseiller juridique au chômage de petite taille. Sa grosse tête rouge trahissait sa nature prompte à l’emportement et laissait penser à tort qu’il consommait trop d’alcool. L’apoplexie semblait guetter chacun de ses mouvements. Il effectuait tous ses déplacements en Mercedes, même les plus courts. Il tenait bénévolement une permanence d’assistance juridique dans l’un de nos locaux. Il passait souvent nous voir car sa prestation avait peu de succès et il était avide de contacts. Il portait une cravate tous les jours de la semaine.
Mon humour accessible et mon sourire bienveillant l’avaient mis en confiance, les fausses garces de l’accueil étant à son endroit, à la fois plus moqueuses et plus méfiantes. Pourtant, il n’y avait pas homme plus inoffensif. Toutes ses préoccupations tournaient autour de sa femme que j’avais un peu de mal à imaginer. Elle était avocate. Un soir, il allait l’attendre à la sortie de la gare avec la Mercedes et un bouquet de fleurs. Un autre soir, il l’emmenait à un concert de musique de chambre, Salle Gaveau. Il connaissait ses goûts sur le bout des ongles et s’employait à les satisfaire à n’importe quel prix. Il la vénérait et la gâtait, il vivait hache vingt-quatre avec la peur de la perdre. Il me confiait ses craintes et ses espoirs. Tu crois que ça va lui faire plaisir ? Je lui répondais qu’elle avait de la chance d’être aimée de la sorte. Je n’avais pas son expérience et je préférais m’en tenir à des banalités rassurantes en regardant tournoyer dans ses yeux humides et bleus, toutes les grandes choses qu’il n’avait pas encore réalisées.
Me trouvant décidément bien sympathique, il m’invita à déjeuner chez lui, un dimanche.
Je ne savais pas comment m’habiller. Heureusement, je n’avais guère le choix. J’arrivai en jean, sans bouteille ni fleurs. Je ne voulais pas marcher sur les plates-bandes de mon hôte. Une excuse qui en valait une autre, mais laquelle ?
Le couple et ses deux petits garçons habitaient un joli pavillon à flanc de coteau, non loin du parc de la Mairie.
Une jeune fille au nez retroussé et aux longs cheveux jaune paille, vint m’ouvrir le portail qui grinça avec un accent allemand très chic. Elle me confirma que j’étais bien chez Monsieur Berger, en tordant son menton pour confirmer qu’une fille aussi jeune et aussi belle qu’elle ne saurait être la femme de Monsieur Berger, sauf le respect qu’elle devait à Madame.
Monsieur Berger était vêtu d’un tablier de cuisine qui le boudinait affreusement. C’était lui qui avait mis le rôti au four, fait revenir les petits légumes, commandé le gâteau, fatigué la salade, dressé la table.
Il m’accueillit avec une jovialité excessive et me présenta à sa femme comme un ancien collègue. Pour l’occasion, il avait tombé la cravate et je commençai à trouver que le maître du logis n’avait plus le visage aussi rouge (et que c’était un fort honnête homme).
Madame Berger était fine, élancée, aristocratique. Son tailleur à carreaux Thierry Mugler et ses chaussures plates avec un gros nœud posé sur le dessus ne venaient pas à bout de sa haute silhouette d’oiseau échassier. Elle avait une façon bien à elle de tourner brusquement la tête pour s’assurer qu’on n’était pas en train de se payer sa fiole. Cheveux noirs, visage osseux, nez busqué, rouge à lèvre éclatant sur un sourire qui allait s’élargissant à la limite de la peine de mort. Au bout de ses longs doigts, ses ongles étaient coupés courts et simplement recouverts d’une couche de vernis transparent. Elle dépassait son mari de plus d’une tête.
Vous l’avez compris, toute la magistrature se demandait pourquoi Maître Berger avait épousé ce conseillé juridique arrondi, voire rondouillard, qui venait la chercher avec une Mercédès beige dont le modèle n’était plus coté qu’en Afrique subsaharienne. Question que personne au demeurant n’avait jamais posée à cette chasseresse du barreau.
Maître Berger était de bonne compagnie mais pouvait faire peur aux enfants de ses amies. Sa lèvre supérieure était ornée d’une fine moustache qui ne manquait pas de caractère. Le débit rapide de cette hyperthyroïdienne laissait souvent sur place son mari qui avait tendance à choisir ses mots. La perspective de se faire couper la chique rendait nerveuse cette professionnelle de la parole. Pour la tranquilliser, monsieur Berger lui demandait son avis sur tout et n’importe quoi. Quand elle n’y connaissait rien, elle avait l’art d’établir promptement des correspondances avec les sujets qu’elle maîtrisait, afin de ramener la discussion dans ses cordes. Monsieur Berger devait préparer ses phrases avec soin car sa femme avait tendance à répondre avant que sa question ne fût entièrement formulée, parfois même avant que celle-ci ne fût clairement conçue dans son esprit. Madame Berger parlait pour ne rien dire, monsieur Berger écoutait pour ne rien ouïr.
Xena, la fille au pair qui m’avait ouvert la porte, hochait poliment la tête. Parfois, dans un accès de bonté transculturelle, madame Berger lui demandait ce qu’elle en pensait, afin qu’elle pratiquât la langue de Jean-Baptiste Poquelin. Xena était venue passer un an en France à la Sorbonne pour pouvoir inscrire sur son CV le nom de la prestigieuse université. Elle était nourrie, logée, blanchie, on lui payait sa carte orange et ses heures sup, plus un peu d’argent de poche pour faire bon poids. Elle ne se plaignait pas. En échange, elle faisait faire leurs devoirs aux deux garçons, allait les conduire et les chercher à l’école quand les horaires de ses cours le lui permettaient et les gardait le soir quand Monsieur sortait Madame.
Le lendemain, monsieur Berger me demanda ce que j’avais pensé de Xena. L’espace d’un instant, j’imaginai qu’il trompait sa femme avec sa fille au pair. Je me voyais mal lui répondre qu’elle avait de la chance d’être aimée par un homme comme lui. Il m’expliqua que Xena jouait du hautbois, qu’elle ne connaissait personne en France, et patati et patata. En réalité, cet homme qui était d’une prévenance extrême avec sa femme, craignait que celle-ci ne s’imaginât que les loisirs que lui offrait le chômage ne pussent l’entraîner sur la pente savonneuse de l’adultère. Xena était bien trop belle. Il fallait qu’elle entame une relation le plus rapidement possible. C’était une question de vie ou de mort. Il comptait sur moi. Il était prêt à m’arranger le coup.
Un après-midi, Monsieur Berger m’invita à passer chez lui pour un prétexte futile et me laissa en plan avec la fille au pair. Elle était en train de jouer du Jean-Sébastien Bach. Je lui dis que je connaissais ce morceau, qu’il en existait une version pour deux flutes et qu’elle n’aurait aucune difficulté à en déchiffrer une partie si toutefois elle voulait bien me suivre dans mon humble demeure où se trouvait mon instrument, à deux pas de là.
C’est ainsi que Xena commença d’occuper mes pensées. Elle fut de toutes mes fêtes et devint opportunément ma muse – je préparais un concours de poésie organisé par une ville voisine et dont la dernière lauréate était l’une des femmes de l’accueil avec laquelle je travaillais. Nous nous voyions dès que nous le pouvions pour massacrer Jean-Sébastien que nous avions tendance à confondre avec le saint. C’était aussi pour elle, l’occasion de fortifier son français et de détourner pudiquement la tête quand nos regards s’échangeaient trop longtemps.
J’avais remarqué que Xena, comme beaucoup d’Allemandes, ne s’épilait pas les mollets. Je me demandais comment il était possible d’avoir des cheveux aussi pales et lisses et des poils aussi noirs et frisés. Je n’ai toujours pas la réponse.
Xena était une jeune fille sérieuse qui réfléchissait avant de sourire. Il n’était pas question de se laisser aller. Elle se contentait de notre amitié plus plus. Après tout, je n’étais qu’un clodo du tertiaire, un va-nu-tête sans projet et sans avenir et elle allait regagner son pays natal à la fin de l’année scolaire. Elle ne passerait même pas l’été en France. C’était un peu juste pour construire un futur, même immédiat. Nous nous contentions d’un présent que nous embellissions avec les moyens du bord.
Quand le moment de son départ fut venu, je respirai une dernière fois le parfum de ses cheveux et lui fit cadeau d’un recueil des meilleurs poèmes que j’avais écrits au fil de ma courte vie.
Je remportai le premier prix au concours de poésie de la ville voisine mais l’étrange Xena, jamais ne m’écrivit.
Yvette
Mon emploi de factotum me conduisait parfois jusqu’au parc de la mairie pour remettre des factures au service comptabilité. C’était pour moi l’occasion de voir de nouvelles têtes. Je me garais comme je pouvais devant la mairie, sur le petit parking réservé aux employés municipaux, et gravissais plein d’entrain les quelques marches du large escalier de cet ancien hôtel particulier. L’hôtesse de l’accueil me racontait avec l’accent du midi les frasques de sa fille. Je descendais ensuite saluer mes collègues imprimeurs, des trotskistes qui se la coulaient douce entre deux massicots. Puis je montais au service comptabilité, ce pour quoi j’étais missionné, ne le perdez pas de vue.
C’est là-haut que j’avais rencontré Yvette, une petite comptable consciencieuse à lunettes dont une incisive latérale supérieure surnuméraire, située en dehors de l’arcade, rendait le sourire espiègle. Elle avait l’intelligence taquine et l’ironie sévère. Elle n’était pas insensible à ma désinvolture.
Quelques jours plus tard, j’accrochai ma déclaration d’impôt sur les sentiments, à un essuie-glace de son parebrise.
Elle aimait se promener en ville ou en forêt. Nous discutions, main dans la main, des heures entières. Je lui avais raconté la terreur que j’avais éprouvée à quatre ans, lorsque ma mère, qui possédait à l’époque un manteau en ocelot, était revenue des commissions avec un masque de Nounours sur le nez (nous n’avions pas la télévision). Elle m’avait couru après, autour de la table, en criant, c’est moi ta maman, tandis que j’hurlais comme un damné. Dès que ma mère ôtait son masque, je me calmais instantanément et venais me réfugier contre les poils de son manteau. Dès qu’elle remettait le masque, je m’enfuyais en hurlant.
Yvette m’avait raconté qu’elle et sa sœur dormaient dans le même lit, quand elles étaient petites. Elle m’avait raconté comment son père venait les rejoindre pour faire des câlins. Sa petite sœur, plus maligne, s’arrangeait toujours pour qu’Yvette soit entre elle et lui. Elle m’avait aussi raconté le silence de sa mère.
Sur les quais de Seine, un jour de novembre qu’elle était assise sur le parapet entre deux boîtes vert wagon cadenassées, je pressai mon ventre contre ses genoux en serrant entre mes doigts ses mains gantées de laine et je lui dis que je l’aimais. Elle avait déposé un baisé de fortune sur mes lèvres glacées et m’avait répondu, tu sais, il va falloir être patient avec moi.
Nous avions une relation en dents de scie. Que deviens-tu ? J’ai déménagé près de Grenoble, viens me voir une semaine. Ça se passait ainsi. Nous ne faisions jamais vraiment l’amour. Elle embrassait, la bouche fermée. Son sexe était sec comme une écaille de tortue et elle riait quand j’essayais de la pénétrer. Je savais que pour elle se serait un travail de toute une vie qui peut-être n’aboutirait jamais. Elle avait écrit une lettre à son père, expliquant qu’à cause de lui elle ne pouvait pas avoir de relations normales avec un homme. Elle poursuivait les cafards qui courraient en tous sens sur sa cuisinière, au moyen de feuilles arrachées au catalogue de la redoute qu’elle enflammait, et sortait souvent avec des hommes mariés. On se disait qu’un jour, peut-être, ça marcherait entre nous. Je cessai de prendre de ses nouvelles lorsque ma fille vint au monde.
Zoé
Je ne me rappelle pas comment ma relation amoureuse avec Zoé avait commencé. Elle faisait des études d’infirmière. Elle avait le cheveu fin, la peau douce, l’œil brillant, le rire éclatant, la bouche grande, les lèvres charnues. Elle disait qu’elle avait le mollet rond. Tout en elle était rond. L’encolure de sa robe bleu océan plongeait entre ses seins qui tanguaient. Sa ceinture marquait sa taille fine et mettait en valeur son cul magique. J’en étais dingue.
Elle avait des problèmes avec l’idée de faire entrer quelque chose à l’intérieur de son corps. À cette époque elle se nourrissait exclusivement de miel. La surcharge hépatique expliquait son teint blafard tirant sur le vert. Elle embrassait passionnément et aimait qu’on la caresse mais elle refusait la pénétration. En soit, ce n’était pas un problème, mais elle refusait de mettre la main à la pâte. Sur la fin de notre relation, elle ne restait dormir que lorsqu’elle était accompagnée de sa meilleure amie. Ma pièce à vivre se transformait alors en dortoir. Elle me rendait fou.
Elle aimait la compagnie et faisait preuve d’une empathie pathologique. Elle avait un ami homosexuel qui avait l’anus abimé à force de se faire défoncer. C’était le genre de truc qu’elle me racontait. Elle était tellement désolée pour lui. Je lui avais suggéré d’enduire de miel l’anus de son ami, pour le soulager. Elle n’avait pas goûté ma pointe d’humour. Elle avait marmonné qu’un jour elle se ferait sodomiser pour savoir quel effet ça faisait. Je ne lui avais pas proposé mes services, j’avais des doutes sur ses motivations.
Je l’ai quittée un dimanche. À moins que ce ne fut elle qui me quittât. Notre relation s’égarait depuis plusieurs semaines dans la mangrove d’une friend zone fétide. Elle avait invité la meilleure amie à nous suivre afin de contenir mes ardeurs – à moins qu’elle ne projetât de me caser avec celle-ci. Des babacools avaient organisé un sit-in devant la Fontaine Saint-Michel où, sous l’œil nazi de deux chimères aux dents gâtées, le héros éponyme piétinait un démon au visage d’aviateur qui considérait son genou fienté d’un air dégoûté, en se demandant comment il allait bien pouvoir réparer cette panne en plein Quartier latin.
L’un de ces poètes du pavé avait harangué ma Zoé. Elle s’était agenouillée près de lui, il lui avait récité deux ou trois vers et ils s’étaient galochés dans l’odeur de Javel que diffusaient les gros bouillons de la fontaine. Les yeux clos de l’archange se souvenaient d’un plaisir archaïque. Le glaive levé du milicien céleste était guidé par un dieu indécis. Je m’étais dit, c’est le moment de ne plus chercher à comprendre. La meilleure amie m’avait rattrapé dans la station de métro en criant, revient, elle ne sait pas ce qu’elle fait. J’avais grave les abeilles. Je lui avais dit ciao et ne les avais jamais revues, zaï zaï zaï zaï. Je n’avais pas les galons pour apprivoiser une hypersensible comme Zoé.
Angèle
Zoé m’avait présenté à ses amis d’enfance grenoblois. Nous avions créé des liens et il m’arrivait de faire un saut sur les bords de l’Isère. Un jour où j’avais été invité à un double anniversaire, l’une des deux reines de la fête était venue s’allonger à côté de moi sur la pelouse et avait décrété haut et fort que j’étais son type, en général et en particulier. Avec une détermination qui frisait la désinvolture, elle m’avait expliqué qu’elle n’avait pas l’habitude de rester les deux pieds dans le même sabot. L’époque était à l’émancipation, j’étais arrivé sans cadeau, je n’avais pas fait la fine bouche.
Angèle ressemblait à un lion. Ses cheveux roux et crépus lui faisaient une crinière qui descendait au milieu de son dos et son corps trapu de montagnarde était couvert de taches de rousseur. Elle s’imposait naturellement et personne ne contestait son statut de meneuse. Au cas où quelqu’un aurait eu un doute, un chien de montagne des Pyrénées d’une soixantaine de kilos qui ressemblait à un ours polaire l’accompagnait partout où elle allait.
C’était le début des grandes vacances et la jeunesse préférait ne pas penser à l’année qui allait venir. Il fallait profiter du présent en dilatant les minutes au maximum. Angèle avait prévu de partir pour une semaine de randonnée avec sa copine Julie, dès le lendemain matin.
Julie allait entrer en deuxième année de prépa HEC. Elle avait ce qu’on appelle un corps parfait et un visage bizarre. La gentillesse naïve de son sourire, qu’elle affichait en permanence, me paraissait artificielle. Elle semblait s’excuser. Elle était la seule à avoir mis du rouge à lèvres. Les deux amies m’avaient invité à les accompagner en randonnée, il y avait suffisamment de place sous leur tente pour tenir à trois. Je suis probablement passé à côté d’une expérience inoubliable. J’avais expliqué que j’avais un rendez-vous professionnel le lundi matin. Ce qui était vrai.
Angèle avait commencé par me rouler une pelle pour marquer son territoire, puis nous avions passé l’après-midi et la soirée à nous taquiner. Je regardais la nuit tomber avec une certaine appréhension. Je me voyais mal évoquer une migraine. Je restai à discuter, tard dans la soirée, avec un jeune éphèbe qui ne savait pas dans quel instrument il allait se spécialiser l’année suivante, la flûte traversière ou le piano. Sa mère et lui n’avaient pas le même avis.
Quand je suis entré dans la chambre, Angèle était déjà sous le drap, entièrement nue. Je la rejoignis. Nous fîmes l’amour pour sauver la face du monde. Elle poussa quelques gémissements de circonstance. Le rapport dura quelques minutes et nous nous endormîmes. Lorsque je me réveillai, le lendemain matin, elle était déjà partie. Commençait pour moi un long dimanche de cafardaille. Je rentrai à Paris en autostop, avec un sentiment de solitude rarement atteint.
Barbara
Nous n’étions plus en couple Zoé et moi. J’étais descendu sur Grenoble pour donner suite à une invitation envoyée par la meilleure amie de Zoé qui me pressait de revenir les voir. Comme promis, j’étais toujours le bienvenu. Nous logions en altitude, dans une sorte d’estive appartenant à la famille. Il y avait là quelques amis. L’air était vif et la nuit était noire. Je proposai d’aller faire un tour dans les environs pour profiter du ciel étoilé – nous n’avions rien de semblable à Paris.
Contre toute attente, une fille qui était restée discrète toute la soirée s’était levée, bondissant comme un écureuil. Les autres personnes présentes avaient fait la sourde oreille à ma proposition. J’imaginai que tout cela était arrangé. Quelqu’un dit, essaie de ne pas lui sauter dessus, Barbara. Nous nous éclipsâmes en promettant de revenir bientôt sans ramener plus de deux enfants. Barbara était petite, mince, élégante, vive et rieuse quoique peu causante, en définitive difficile à cerner. Elle écoutait, attentive ou distraite, et souriait de temps en temps pour des raisons connues d’elle seule. Ses lèvres s’entrouvraient parfois, semblant appeler un baiser. Quand on la regardait trop longtemps, on avait envie de la prendre dans ses bras.
Mais ne brulons pas les étapes. Pour le moment nous gravissions une colline du contrefort de la Chartreuse. L’étroitesse du sentier nous obligeait à marcher l’un derrière l’autre et je ne perdais pas de vue son joli cul recouvert d’un tissu de coton à armure de serge avec un petit motif oblique caractéristique. Arrivé au sommet, nous nous assîmes en tailleur face à l’abime. De très loin en contrebas, montait une rumeur. Scintillant dans la nuit comme une fête foraine, un complexe industriel tapissait le fond de la vallée, nous rappelant, tel un fourmilion aux mâchoires d’acier, que notre séjour était provisoire, illusoire notre liberté.
Je fis la connaissance de son frère et du meilleur ami de son frère, vaguement musiciens, vaguement alpinistes. Je les accompagnais dans leurs randonnées. Je m’étais équipé de chaussures de montagne et d’un matériel de survie onéreux. Une semaine sur deux je descendais dans le Dauphiné. Je dormais sur un matelas dans la chambre du frère. J’avais deux ou trois ans de plus qu’eux. Leur mère était ravie d’avoir un homme à la maison.
Leur père avait installé sa femme et sa progéniture dans cet appartement, tandis qu’il auscultait le sous-sol africain à la recherche des nappes onctueuses dont raffolent les sociétés industrielles. Deux fois l’an, il passait accrocher aux murs les aquarelles qu’il avait réalisées au cours de ses pérégrinations subtropicales. Les cloisons étaient couvertes de longues pirogues voguant sur des fleuves comme des mers, de négresses aux seins ultralibéraux, de larges culs drapés dans l’étoffe chatoyante des jours sans pain, d’enfants à la nudité ocreuse, de villes s’effritant en bordure de désert, de cucurbitacées aux plastiques incongrues, de dentures éclatantes ourlées de lèvres turgescentes, de masques inquiétants à la laideur mystique. Je me disais qu’un homme qui avait vu tant de merveilles ne pouvait être foncièrement mauvais.
Un soir que nous dînions au restaurant, je me décidai à suivre Barbara aux toilettes. Je l’attrapai par le bras, la retournai vers moi et l’embrassai sans retenue. Tu es fou, me disait-elle entre deux baisers en regardant mes lèvres. Ce soir-là, je pris congé de son frère pour rejoindre Barbara. Bien que large, son lit une place nous obligeait à dormir encastrés l’un dans l’autres. C’est sans doute l’un des plus beaux souvenirs que je garde de cette liaison. Je plongeai le nez dans les torsades brillantes de ses cheveux noirs, agrippais ses petits seins et pressais son corps contre le mien, attendant qu’elle retourne brusquement vers moi son petit visage pâle aux joues empourprées et colle aux miennes ses lèvres gercées dont les aspérités me rendaient fou.
La rentrée sonna le glas de notre nonchalance. Barbara suivait des cours dans une école d’art plastique. Je ne la savais pas spécialement douée pour le dessein. Je ne savais jamais ce qu’elle faisait pendant que j’errais dans Grenoble, de chocolat chaud en chocolat chaud. Je connaissais tous les bistros mais jamais je ne l’avais croisée malgré l’haleine alcoolisée de ses baisés quand nous nous retrouvions le soir.
Un jour où nous étions allés en boîte de nuit, elle avait retrouvé celui avec lequel elle avait eu une liaison longue durée. Il l’avait invitée à danser et elle avait bondi comme la gazelle mâle du mal-aimé. Ils s’entendaient à merveille. C’était beau de les voir danser. À la fin de la dance, ils s’étaient embrassés. Elle était toujours amoureuse. Je ne connaissais pas leur histoire, à part qu’ils avaient rompu plusieurs fois. Elle ne racontait pas grand-chose et son frère prenait garde à ne pas poser le pied sur les gentianes que mon amour pour sa sœur avaient fait éclore un peu partout.
Un beau jour, j’en eu assez de faire le flic une semaine sur deux, de lui reprocher son alcoolisme et son manque d’assiduité à ses cours. Par ailleurs, mon parcours ne faisait pas de moi un exemple convaincant. Je vivais à mi-temps, gagnais un demi-SMIC, n’avais aucune ambition et regardais le temps passer depuis les terrasses des cafés. Je n’avais aucune légitimité. Nous ne faisions plus l’amour. Il faisait de plus en plus froid, dans Grenoble et dans mon cœur. Nous cessâmes de nous voir.
À quelques temps de là, un ou deux mois peut-être, je reçu une lettre anonyme disant combien je leur manquais, que j’étais toujours le bienvenu, qu’on pensait très fort à moi. Qui avait bien pu écrire cette lettre ? L’écriture était féminine, j’éliminai donc le frère de Barbara. C’était bien rédigé et sensible, je pensai dans un premier temps à la meilleure amie de Zoé. Mais avait-elle écrit cette lettre pour elle ou à la demande de Barbara ? Rien n’était moins clair. De toutes façons, non, ce n’étais pas l’écriture de la lettre qu’elle m’avait envoyée au début de cette aventure. Enfin, je pensai à la mère de Barbara. J’imaginai son angoisse et son impuissance face à la dérive de sa fille. Ça me rendait fou. Je me pris à haïr ces hommes qui font des enfants qu’ils abandonnent de près ou de loin. J’aurais pu envoyer des lettres pour prendre des nouvelles des uns et des autres, enquêter… Mais le cœur n’y était plus, il n’y avait plus les matériaux nécessaires pour construire une cabane au fond du jardin.
Charlotte
C’était l’été. Il faisait chaud. Très chaud. On entendait, sur les talus, craquer des milliers de brindilles. Il aurait suffi d’un mégot pour que la pinède s’embrasât. Nous achetions des pains de glace que nous mettions dans nos glacières. Dans ma poitrine aussi, un bloc de glace bleue se craquelait. Je n’avais pour le passé aucune tendresse et l’avenir ne m’intéressait pas.
Cette année-là, mon père avait mis au point une animation itinérante que nous présentions sur la côte landaise, de camps de vacances en terrains de camping. Il s’agissait d’une projection photographique stéréoscopique animalière. Tous les soirs – il fallait attendre que l’obscurité se fit – nous montions un écran de toile cirée, nous délimitions un périmètre payant au moyen d’une bande fluo et nous attendions que le parc à moutons se remplît. Les gens étaient priés de venir avec leurs chaises pliantes – ce qui posait parfois des problèmes dans les centres de vacances où un mobilier plus cossu était fourni aux estivants. Le divertissement était annoncé par quelques affiches recyclables et une virée en mégaphone dans les allées poussiéreuses du camp. Je m’amusais à parodier les annonces de spectacles dont je m’étais moqué enfant, au terrain de camping d’Hourtin où nous passions en famille tous nos étés : « ce soir à 21 heures, grand spectacle stéréoscopique en technicolor, venez contempler les animaux en relief comme si vous les touchiez. Un spectacle qui émerveillera les petits et surprendra les grands. Ce soir sur la place des fêtes de votre terrain de camping, à 21 heures. N’oubliez pas d’apporter votre chaise pliante. Ce soir à 21 heures précises. Une promenade exceptionnelle au milieu des animaux sauvages des réserves Africaines, comme si vous y étiez, ce soir sur la place des fêtes de votre terrain de camping, à 21 heures. Dix francs les grands, huit francs les petits. » Mon père avait obtenu du comte de La Panouse, l’autorisation de photographier ses animaux dans les réserves animalières de Thoiry, Peaugres et Sigean. Un professeur de saxophone du conservatoire de la commune où je travaillais et son ami pianiste avaient composé une musique originale. Je me rappelle notamment ce passage évoquant la savane où il se contentait de faire claquer les clapets du saxophone sans souffler dans son instrument.
Les gens avaient du mal à comprendre qu’il s’agissait de photos en relief, c’était une bonne surprise pour ceux qui payaient et du dépit qui se muait rapidement en mépris ou en indignation pour les resquilleurs massés hors périmètre, auxquels on n’avait pas distribué de lunettes polarisantes. Ils trouvaient la photo floue et ne comprenaient pas qu’une technologie sournoise s’était infiltrée dans leur cité de toile. Mon père s’approchait alors d’un enfant qui se demandait ce qu’il faisait là et accrochait une paire de lunettes sur son micro-pif. Le résultat n’était jamais décevant : le gamin poussait un hurlement d’étonnement et se transformait en boule de nerfs. Les parents constataient à leur tour la magie de l’effet. Mon père profitait de la stupéfaction de la gueusaille pour arracher les lunettes. Souvent les pauvres et les radins essayaient de négocier une paire pour toute la famille mais mon père était intransigeant : une paire par personne et les lunettes ne sortent pas de l’enceinte. Parfois, des parents cédaient et faisaient entrer un enfant. D’autres s’éloignaient, d’autres encore restaient là malgré tout à me fendre le cœur, les enfants s’amusaient à deviner le nom de l’animal enveloppé de brume qui se dématérialisait sur l’écran de vinyle.
C’est ainsi que nous passâmes un été riche en rebondissements, portés par le roulis de la DS verte de mon père, la même que dans Les Valseuses, trainant par les forêts de pins sous un soleil de plomb, notre petite caravane blanche aménagée en cabine de projection.
Nous finîmes par établir un campement semi-provisoire sur l’airial d’une hacienda qu’une famille aisée bordelaise avait louée pour les vacances. La mère et un beau-père très en retrait attendaient en compagnie des deux filles, l’arrivée du mari de l’aînée, un concepteur de chaussures à l’emploi du temps très chargé. J’avais rencontré la cadette dans une sardinade. Sa grande sœur l’avait quasiment jetée dans mes bras à la faveur de l’obscurité enfumée par les huiles de poisson. Elle s’était rétractée en hurlant qu’elle ne savait pas danser et j’étais resté accroché à ses rondeurs comme à une bouée de sauvetage. Je lui avais certifié que c’était un jeu d’enfant, j’étais prêt à lui donner gratuitement des cours particuliers, elle serait la reine de la piste d’ici la fin de la soirée pour peu quelle consentît à rester dans mes bras. Elle était lourde et raide comme une toile de tente mouillée. Nous quittâmes bientôt le cercle des danseurs pour gagner des horizons moins contraignants. Elle avait mal aux pieds et ôté ses chaussures qui s’agitaient avec impatience au bout de son bras rond, le sables faisait des petits volcans entre ses orteils. Nous nous dirigeâmes vers un feu de camp autour duquel s’animaient quelques pêcheurs aoûtiens qui faisaient griller leurs prises. Elle avait froid. Elle avait ramassé une serviette de bain oubliée par un baigneur et l’avait posée sur ses épaules. Je maintenais le tout d’un bras coopérant, si bien que nous arrivâmes aux pieds des flammes, quasiment mariés : c’est en amoureux qu’on nous invita à partager la chaleur du foyer. Je ne me souviens plus à quel moment je l’avais embrassée mais nous nous promîmes de nous revoir. Je l’invitai au spectacle que nous devions donner le lendemain soir.
Toute la famille était venue. Je voulais les faire entrer gratuitement mais il n’en fut pas question. Maman mettait un point d’honneur à verser son obole à la culture. C’est ainsi que nous fûmes invités à établir chez eux notre camp de base. La mère, une très belle femme qui ressemblait à Brigitte Bardot, et l’ainée, demi-sœur trentenaire à la personnalité froide et distante qui dominait le groupe, avaient pris les choses en main. La petite dormirait avec moi dans ma canadienne deux places : l’air pur lui ferait du bien. Je n’étais pas follement épris de la petite mais je croyais au miracle de l’amour.
Je m’adaptai rapidement à notre nouveau rythme. Nous prenions nos repas en famille, mon père complimentait la mère et draguait l’aînée. Celle-ci attendait son mari sans impatience. Mon père lui faisait des compliments qu’elle écoutait les yeux fermés, étendue presque nue sur son transat.
Pendant que ces deux mythos s’évertuaient à savoir lequel n’aurait pas le dernier mot tout en sachant pertinemment que les choses n’iraient pas plus loin que le bout de leurs nez, je passais mes nuits à essayer de dérider la cadette. Elle avait la bouche des Enfants terribles de Jean Cocteau et ses cuisses refusaient de coopérer. Elle souffrait d’un déficit d’égo monumental, avait de petits pieds et avait échoué à l’épreuve du baccalauréat. Elle n’envisageait pas d’avenir professionnel précis. Sa chair étonnamment brûlante était assoiffée de caresses. Elle avait besoin de s’attacher à un être humain et fumait sans avaler la fumée.
Je passais mes journées en d’interminables parties de tennis de table avec son providentiel beau-père, un gosse grisonnant qui ne pensait qu’à profiter d’une retraite militaire non méritée. Appuyée sur le muret, ma promise nous regardait d’un œil cerclé de noir en me haïssant poliment, tandis que sa sœur prenait le soleil sur sa chilienne en fumant des cigarettes interminables. Dans la fraîcheur de l’immense bâtisse landaise, leur mère travaillait à sa beauté de femme de plus de cinquante ans. Pendant ce temps, mon père prospectait. Le soir venu il se débrouillait maintenant sans moi pour les spectacles. Nous l’attendions parfois pour le dîner.
Nous vivions ce déséquilibre précaire avec une nonchalance coupable, dans l’odeur des pins et la proximité de la mer.
Je ne me rappelle pas son nom. Peut-être que ça va me revenir, comme me reviennent imprécis les souvenirs de sa crème solaire, la rondeur silencieuse de ses cuisses brunes adossées au chant assourdissant des cigales. Charlotte, je crois qu’elle s’appelait Charlotte : derrière la barrière boudeuse des boudoirs, la fragilité crémeuse du mascarpone.
Nous nous rapprochâmes lorsqu’elle dû prendre soin de moi. J’étais resté estropié pendant deux jours, les reins en compote, après avoir fait le malin dans une arène où batifolaient des vachettes landaises. J’avais bravé l’animal avec une inconscience sidérante. Le jeune bovin m’avait fait traverser l’arène au bout de ses cornes, me scotchant à la palissade où j’étais resté accroché pantelant, les hanches démises et le corps couvert d’ecchymoses. Charlotte se délectait de mon infirmité. Elle avait rapidement tiré avantage de la situation. Faire l’amour dans ses conditions relevait de la pantomime et nous riions sans bruit comme deux handicapés. En quelque sorte, nous étions à égalité.
Enfin, le mari de la sœur fit son entrée. Un homme sans doute jeune, encore plein d’avenir, ouvert d’esprit, d’une décontraction déconcertante. Il était parvenu à caser huit jours de congé dans son emploi du temps. J’appréhendais un peu cette arrivée qui risquait de perturber ce monde féminin où l’intrigue avait du mal à démarrer. Mais il était exclu de ce matriarcat. De toute évidence, sa femme ne l’aimait pas, ce qui, en définitive, acheva de me mettre mal à l’aise. Il portait un modèle de sandales écœurant qu’il avait lui-même conçu. Nous quittâmes la société quelques jours plus tard, en fin de matinée, un brin soulagés.
Nous roulâmes en silence, la DS fendait l’air irrespirable de midi, je n’avais pas de commentaire à faire sur mes relations superficielles dont curieusement je me souviens aujourd’hui sans effort, et non sans tendresse. C’était un avant-goût de la fin du film des valseuses que je verrais plusieurs années plus tard. Charlotte m’avait fait cadeau de la serviette de bain oubliée qu’elle avait ramassée sur la plage. Après deux ans de mariage je m’essuyais encore avec.
Il nous restait encore un site landais à prospecter avant de rendre la clé des champs. Un village-vacances de nudistes. Le directeur était un petit homme rondouillard qui avait besoin de justifier le moindre de ses propos. Il portait pour tout appareil un slip de bain étroit qui moulait ses petites burnes. Ce n’était pas un adepte du nudisme et il tenait, comme à une cravate, à cet étroit morceau de tissu. Il avait pris la direction du centre pour la saison et nous demandait presque d’excuser la tenue de ses clients. Il nous accueillit cependant. Nous nous installerions à l’entrée du camp un peu avant la tombée de la nuit. Nous pourrions rester vêtus compte tenu de la baisse des températures en cette fin de saison. Il devait prendre toutes sortes de précautions pour que l’étiquette soit respectée à la lettre. Le premier couple de nudistes que je rencontrai était quasi habillé. C’était le soir, le mec se trainait pépère au chaud dans son survête, la femme avait passé un pull à col boule qui laissait voir le bas de ses fesses d’un côté et des poils de l’autre. Une main dans la poche, je tâchais de dissimuler l’érection dont je n’arrivais pas à me débarrasser, tout en continuant à accueillir les clients de mon mieux.
Nous remontâmes en direction de Paris. Le bilan de la saison n’était pas fameux, l’essence avait dilué le chiffre d’affaires.
Curieusement, j’eus des nouvelles de la bonne étoile de Charlotte la saison suivante. J’avais repris mon mi-temps de factotum à la mairie essonnienne où je travaillais. C’est pour toi André. Pour moi ? Je ne donnais à personne le numéro de téléphone de mon employeur. J’avais tendance à dire que je travaillais dans la com et l’industrie du spectacle. Je n’avais pas envie qu’un admirateur de ma vie de patachon vienne en vérifier les tenants et les aboutissants. Bonjour Madame… Ne m’appelle pas madame, c’est la maman de Charlotte, je veux que tu me répondes franchement, elle a rien dans la tête ma fille ? Bah non, pourquoi vous dites ça ? Elle est tombée amoureuse d’un marin ! J’avais oublié que les marins existaient, c’était un coup de téléphone d’un autre âge, d’un autre monde, le monde lointain de Charlotte que j’étais ému d’avoir traversé tant bien que mal. Je consolai avec maladresse cette mère déçue en évitant de lui rappeler qu’elle partageait sa vie avec un militaire à la retraite. Elle avait trouvé le numéro de la mairie dans les pages jaunes.
Daphné
C’était la fin de l’hiver. Gagner la ferme de Jean-Claude et Sylvie restait une affaire de spécialiste. Passés les genêtières entêtantes, les massifs des buis à feuilles rondes et les rives inégales des estives, le chemin basculait au nord et nous fûmes brusquement enveloppés par le brouillard givrant. Une épaisse couche de neige recouvrait la montagne. Le silence bourdonnait à nos oreilles parisiennes comme un millier d’ailes immobiles. Sous le poids de nos sacs trop chargés, nos pieds s’enfonçaient profondément dans la poudreuse qui effaçait le chemin. Une légère angoisse nous rinçait les boyaux. Dans vingt minutes il ferait nuit : il était tout simplement hors de question et non sans appréhension. Une sorte d’étourneau antipersonnel, partit comme une fusée au ras de nos poils gelés. Il fallait rester groupés !
Mon frère était et est toujours un chic type. L’année précédente, il avait fait les foins chez Jean-Claude et Sylvie. Sens de la communauté, espièglerie juvénile et cœur sur la main : il était vraiment bien ce gars-là ! L’été tombait droit comme un i sur les Alpes de Haute Provence, il fouillait la France à bord de sa camionnette à plateau. Il avait rencontré Jean-Claude chez le garagiste de la vallée. Il fut l’homme d’une situation dont je serais bien en peine de préciser les tenants et les aboutissants, dans la mesure où, tel le tinamou à queue courte des pampas d’Amérique du Sud où on le chasse, je suis fort dépourvu en matière d’information relatives à cette période heureuse de sa vie. Il était question de la découverte d’un paradis de taille moyenne dans cette région désaffectée de l’Alpe, 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer : ce n’était pas tous les jours Byzance (le tinamou dit le Pérou, dimanche dit le poulpe). Il est certain que les garages étaient particulièrement propices aux alliances masculines. En ces temps rudes dont je vous parle, les femmes fréquentaient peu ce genre d’établissements, sinon avec la volonté objective de faire tomber des salopettes. Il se dégageait de ces lieux de terre battue une atmosphère délétère d’huile saturée et de goudron qui apaisait les sens et murait la réflexion. Quelque chose de Tennessee qui n’était pas sans rappeler la lapinière de mon oncle où j’aimais enfant aller contempler les bêtes anxieuses sur leur litière d’excrément, pour laisser descendre en moi jusqu’à l’engourdissement, cette stupeur azotée dont seule pouvait me délivrer l’issue de l’irrépressible envie de déféquer qui ne tardait jamais à venir (Marcel Prout, À l’abri des jeunes figues en pleurs).
Monte nous voir, ce n’est pas la place qui manque !
C’est ainsi que, de fil en aiguille, huit mois plus tard, je me pointai accompagné de ma mère à la porte de Jean-Claude et Sylvie. Ma mère était restée avec nous quelques jours avant de retourner à ses comptes de résultats.
Jean-Claude était peintre, Sylvie était amoureuse. Il confectionnait ses couleurs lui-même et vendait ses estampes en Suisses où il pratiquait le porte-à-porte. Les tâches étaient peu nombreuses et la nourriture était rare. Je passais le plus clair de mon temps à empêcher un berger allemand agressif nommé Zorba, de bouffer les six chèvres qui assuraient la subsistance de notre trio. Son beau-frère avait confié le chien à Jean-Claude en raison du danger qu’il représentait pour les enfants.
Sylvie assurait la confection et la vente des fromages. Jean-Claude assurait l’intendance et de long monologues pétris de savoir-faire et d’érudition, que nous écoutions Sylvie et moi avec des sentiments mélangés. Accessoirement Jean-Claude s’occupait des fesses de Sylvie sur lesquelles il veillait ostensiblement. Sylvie avait une petite moustache anticonceptionnelle qu’elle décolorait à l’eau oxygénée.
Il m’arrivait de porter leur pâtée aux poules. Je redoutais cette corvée, le coq de la basse-cour m’avait pris en grippe. Je n’étais pas autorisé à me faire accompagner du chien dont l’agressivité compromettait les pontes. Je m’armais d’un grand râteau à faner pour repousser le volatile qui ne savait même pas chanter – quatre-vingts centimètres de suffisance des ergots à la crête. Il avait agressé des enfants l’été précédent mais Jean-Claude et Sylvie n’avaient pu se résoudre à l’abattre car sa chair était immangeable.
Heureusement, j’avais réussi à le conditionner. Un jour où, depuis le bas d’un escarpement, le coq fonçait sur moi comme un dément, je l’attendis en position de force sur le haut du talus, armé de mon large râteau de bois. Lorsqu’il arriva à ma portée, je le repoussai violemment tout en simulant avec la bouche le sifflement du serpent courroucé. Par trois fois Chanteglauque chargea, par trois fois, tel Tristan le preux, d’un grand coup de mon fidèle Duratel dans le bréchet, je projetai sans ménagement l’animal au bas de l’abrupte pente. Hardis mes bons : à l’issue du troisième assaut le gallinacé battit précipitamment en retraite. Quoiqu’inattendue, la victoire était totale et mon égo en fut considérablement renforcé.
Le plus surprenant de cette histoire fut que depuis cet incident, il me suffisait d’imiter le sifflement du serpent courroucé pour mettre le coq en fuite ! J’ai toujours pensé qu’il fallait attribuer l’agressivité de cette grande bringue de coq au fait qu’il ne savait pas chanter.
Il y avait aussi une mule que l’altitude étourdissait. Il fallut bientôt la vendre.
J’avais établi mes quartiers en contrebas de la ferme, dans une bâtisse légèrement délabrée, au-dessus de l’écurie où était enfermé le bouc. De temps en temps, Jean-Claude mettait l’animal au piquet afin qu’il se repût d’herbe fraîche. Il est doux le bouc, il est doux, ne se lassait pas de répéter Jean-Claude sans jamais quitter des yeux les cornes torsadées du fauve.
J’avais passé à la chaux les murs de mon chalet et rangé quelques livres de botanique sur une étagère de fortune (le bois est un matériau précieux à cette altitude).
Parfois j’aidais Sylvie à ramasser des épinards sauvages et des pissenlits… La vie était douce comme la France qui s’étalait sous nos pieds, à perte de vue.
Je commençai à me demander furieusement ce que j’étais venu faire dans ce paradis perdu lorsqu’un jour en fin de matinée, rayonnante et un brin mutine, Sylvie entra dans la pièce commune où je rinçais à l’eau glacée une poignée de pissenlit : nous avons rapporté deux boudins du marché, ils sont frais de ce matin, on a pensé que ça te ferait plaisir !
J’avais connu Daphné et Louise au cours de danse moderne du célèbre Ki, un coréen qui enseignait indifféremment le shiatsu, l’aïkido, la dance, la diététique, le sabre, l’art du thé et le yoga.
Son corps était parfait mais son nez en forme de boule et ses cheveux raides faisaient ressembler Louise à un clown. Elle travaillait chez Elf et gagnait beaucoup d’argent. L’air vivifiant de l’Alpe allait peaufiner son look de sportive en quelques jours et faire peler son nez.
Daphné, Daphné la sombre, Daphné la romantique, Daphné la gothique était bâtie comme une cathédrale : un grand coffre et des petits seins. C’était de loin la danseuse la plus brillante du cours. Elle créait des chorégraphies dont elle concevait également les costumes. Elle s’était fait une spécialité de saris flamboyants sous lesquels tournoyaient les proéminences de son grand cul musclé. De jolies boucles sombres encadraient son minois de lait où deux éclairs noirs brillaient, séparés par un nez long, long, long.
On imaginait volontiers la tête de Daphné sur le corps de Louise. Moins l’inverse. Elles restèrent quelques jours, le temps pour leurs jambes de se couvrir de poils.
Daphné la dionysiaque me dragua avec intelligence et fermeté : nous finîmes par nous masturber mutuellement après une nuit passée dans l’obscurité à ne pas décider de faire l’amour. Ses cuisses étaient d’une douceur exceptionnelle. Je ne garde pas le souvenir précis de sa vulve que je n’avais pas léchée. Je l’avais imaginée revêtue de nacre et de carmin, comme ses lèvres qui embrassaient si bien. Le lendemain matin, c’était une autre Daphné que j’avais sous les yeux. Même le sourire de Louise me semblait beau à cette altitude où la lumière glissait comme un pardon sur nos âmes infectées.
Les deux vacancières reprirent le chemin de Paris et Jean-Claude commença à parler de pénurie d’eau. Les stations de ski installées aux alentours pompaient les nappes phréatiques, asphyxiant les petites exploitations qui tentaient de survivre. Jean-Claude ne voulait plus investir ni affectivement ni matériellement dans un lieu sans avenir. Plus question de faire dans le bucolisme primaire, il allait liquider l’affaire, trouver un repreneur pour le troupeau et se remettre à la peinture.
Je fus un peu pris de court par la décision et ne savais trop comment procéder. Je ne me voyais pas redescendre sur Paris, trois mois après avoir tout plaqué. La solution pris corps lorsque Jean-Claude nous fit le récit de la visite qu’il avait rendue aux membres d’une petite exploitation collectiviste, au lieu-dit La Traverse, du côté de Sisteron. Ça puait le mal-être, les animaux étaient mal soignés, il aurait fallu mettre de l’ordre dans tout ça. Il avait déjà donné, pas question d’aller se fourrer dans la merde, au sens propre comme au sens figuré, Sylvie n’y survivrait pas ! Il avait trouvé l’adresse dans un magazine agricole. L’idée qu’il pût exister de tels magazines ne m’avait jamais effleuré. Je notai l’adresse et le jour où Patrick nous informa que le troupeau était vendu, j’annonçai mon départ. Mais tu sais où aller ? Je vais passer à la communauté dont tu nous a parlé, si ça ne me convient pas je trouverai bien quelque chose. Remarque, c’est bientôt l’été, c’est la bonne saison…
Je m’étais facilement intégré à La Traverse. J’étais en charge des fromages et du troupeau. On me faisait entièrement confiance. Certains anciens qui passaient prendre des nouvelles croyaient que j’avais fait une école d’agriculture.
J’avais fait mon trou depuis plusieurs semaines quand, au milieu de l’été, je vis se pointer Louise et Daphné qui avaient retrouvé ma trace je ne sais comment. Elles furent effarées par mes nouvelles conditions de vie. J’étais vêtu d’un simple slip que j’avais passé à la hâte en apprenant leur arrivée. J’avais le cul appuyé contre la calandre du vieux tracteur couvert de rouille tandis que mes pieds nus s’enfonçaient dans les ornières de l’allée, du purin jusqu’aux chevilles. Elles étaient sidérées, elles parlaient tout bas comme si elles étaient venues me délivrer des griffes carcérales d’un pays totalitaire. Nous n’étions pas très loin de Midnight Express et je m’attendais que d’un moment à l’autre elles me montrassent leurs seins. Elles me proposèrent de m’emmener avec elle en vacances. Je n’aurais rien à payer. J’expliquai que les moissons allaient bientôt arriver, qu’il n’y avait personne d’autre pour s’occuper des chèvres et des fromages, que je ne pouvais pas faire ça à ces gens qui m’avaient accueilli et accordé leur confiance. Je n’allai pas jusqu’à mentionner la présence d’Élodie dont j’étais furieusement amoureux.
Elles partirent sans se retourner en essayant de ne pas salir leurs chaussures et ne cherchèrent plus jamais à retrouver ma trace, ni dans leurs cœurs, ni ailleurs.
Élodie
J’arrivais à la ferme de La Traverse en plein après-midi. Un chemin poussiéreux serpentait à travers le paysage, quelques coquetteries vivrières çà et là ourlaient une campagne à l’abandon. Il faisait chaud. Mes chaussures de montagne étaient blanches.
Je rencontrai Bruno dans un abri qui servait de garage à une 4L dont il changeait les cardans. Un long torse bronzé, des cheveux mi-long, des mains immenses. Il s’essuya le front du revers de son poignet et arbora un petit sourire mi amusé mi ironique lorsqu’en quelques mots je lui expliquai que j’avais vu une annonce et que j’étais venu pour bosser. Il avait un visage de mauvais garçon. C’était un grand gars sauvage et impressionnant. C’était l’été.
Il m’accompagna jusqu’à l’entrée du logis, une bâtisse de briques nues. J’avais de la chance : une chambre s’était libérée. La pièce principale était meublée d’une table longue, d’un réfrigérateur et d’un buffet qui faisait aussi office de garde-manger. Au fond, une paillasse équipée d’un évier disparaissait sous une vaisselle de trois semaines. Il ne devait plus rester lourd de couverts dans les tiroirs. Je sautai sur l’occasion qui m’était offerte de me rendre utile en commençant à gravir le dépotoir par la face nord. Il y avait notamment un tas de faisselles en plastiques incrustées de caillé séché qui promettaient de me donner du fil à retordre. Short noir, dos bronzé, c’était parti pour une longue après-midi de fille de salle.
C’est l’action chevillée à la culotte qu’Élodie me découvrit à l’occasion d’une visite de courtoisie quelle poussait en ces lieux. Elle fixa sur moi l’attention qu’on porte naturellement à une nouvelle espèce d’escargot. Pas le moins du monde encline à me filer un coup de main, elle eut l’extrême bonté de me faire la conversation de sa voix grave, tout en se roulant un clope.
Tu viens d’arriver et tu es déjà au boulot ! Tu viens d’où ? Est-ce que t’es PD ? T’as quel âge ? Et autres banalités d’usage. Elle n’était clairement pas mon genre mais elle avait une façon d’écarter les cuisses sous sa jupe à fleurs d’aventurière qui ne laissait pas indifférent, une jupe de babacool qui lui descendait jusqu’aux chevilles et mettait un peu de lumière dans ce monde de crasse. Très vite elle fut rejointe par Femke, une grande hollandaise au nez en trompette, à la fois plus mature et plus raffinée, un joli minois aux lèvres gourmandes et à l’air mutin. Bruno s’était pointé assez rapidement, par la chair alléché. Imperturbable face au mur, je continuais à laver la vaisselle pendant qu’ils mataient mon cul. Le clope d’Élodie commençait à prendre forme, un clope mérité, réfléchi, médité. Tu fumes ? Non. C’est bien. Tu nous as toujours pas dit si t’étais PD. Ne répond pas, s’en mêla Bruno qui commençait à flairer l’aubaine, ça ne les regarde pas. Sous-entendu, moi j’ai compris et moi je le suis. Genre, ce n’est pas celui qui ne le dit pas qui ne l’est pas. L’entretien d’embauche prenait un tour inattendu, on m’adoptait avec une facilité déconcertante et j’avisai qu’il était urgent de m’affirmer sexuellement. Mais je n’avais pas répondu, ne me demandez pas pourquoi.
Je finis par venir à bout de la montagne de faisselles, l’édifice restait instable et il fallait faire gaffe où l’on mettait les pieds. Willy, le fils de la hollandaise se réveilla. Élodie me proposa de faire le tour du propriétaire. En l’occurrence il n’y avait pas de propriétaire. Il s’agissait d’un jeu de société géant où les pions se déplaçaient selon leur logique propre. Un certain nombre de tâches demeuraient nécessaires à la survie de la communauté, sortir et traire les chèvres, faire les fromages et les vendre, rentrer du foin pour l’hiver, entretenir le potager, nourrir les poules, garder les enfants… Les terres alentour étaient maigres et mal entretenues, il se dégageait de ce paradis agraire une petite musique de nuit à coucher dehors. Trois chiens semblaient tirer leur épingle du jeu, un vieux rouquin au regard bleu presque humain qui suivait sagement à distance, sa sœur à poil blanc pas très causante, et un taré poivre et sel, des poils plein les yeux, quémandeur, incontrôlable et bourré d’initiatives.
La passion d’Élodie, c’était le troupeau. Quarante chèvres de tous poils, des petites fébriles, des grandes salopes, des vieilles aux cornes rabougries, des mal foutues, des pimbêches, des affectueuses, des cornues, des mottes, des sèches, des juteuses, des collantes, avec ou sans pampilles… Camélia, la prétendante sans personnalité, fille de La Noiraude, Régalade sa sœur au poil clair et à l’œil matois, Kératine la frotteuse, et La Noiraude, la reine, une grande chèvre aux pis roses et noirs qui allait sans haine par les collines, indifférente aux complots sans fins qui se tramaient derrière son long dos soyeux. Sans faille, elle conduisait le troupeau vers les pentes les plus savoureuses et, chaque jour, rapportait de ses excursions deux bons litres d’un lait onctueux et parfumé. C’était toujours un honneur de la traire. Élodie en parlait comme d’un être hors du commun, une puissance de la nature quasi mythologique. Les deux grandes cornes du bouc venaient couronner ce monde capricieux et mobile.
La Traverse avait besoin d’un berger. Conscient de ma propension à la rêverie et au farniente, c’était la seule activité, avec la garde des enfants, pour laquelle je pensais avoir quelque aptitude. Je n’avais de l’agriculture que des connaissances théoriques ou folkloriques et mes compétences en mécanique se limitaient à réparer une roue de vélo crevée ou changer une roue de voiture, avec cependant un vieux doute concernant le positionnement du cric.
Le troupeau de La Traverse était un monde complexe. Je passai mon premier mois à faire de la politique. La Noiraude avait des soucis. Des forces souterraines parcouraient la harde qui ne produisait pas la quantité de lait attendue. En tant qu’expert chevrier on m’avait chargé de remettre de l’ordre dans le monde capricieux du sabot fourchu. Je ne fus pas long à découvrir que les filles de La Noiraude complotaient pour renverser leur mère. Mais dans un premier temps il me fallut apprendre à manœuvrer ce grand corps protéiforme à la tête déficiente. Sous les quarante paires de cornes, des rêves de potager profané se mêlaient à des phantasmes insensés de gloire et de domination. L’expérience acquise auprès d’un coq surnommé Chanteglauque et d’un berger allemand nommé Zorba m’avait appris que le danger n’était jamais là où on l’attendait et qu’il fallait se méfier de ses alliés. Ici les chiens ne m’étaient d’aucun secours. Les deux vétérans ne faisaient que semer le désordre quand on les sollicitait. Quant au poilu, ne voulant pas décevoir et plein de bonne volonté, il n’attendait qu’un signe pour se mobiliser à deux cents pour cent, laissant libre cours à son imagination et improvisant totalement. Mes tentatives de dressage ne donnaient pas de résultat appréciable et les chèvres ne le prenaient pas au sérieux. Je n’avais pas osé jeter un œil sur son CV.
Longer le potager était un exercice angoissant. Un champ magnétique figeait les bêtes qui semblaient toutes habitées de la même chimère. Impuissants face à cette entité nouvelle qui prenait corps, les chiens restaient à une distance prudente. Il me fallait batailler seul le long de la palissade en poussant des cris de gorille, tout en prenant garde que le troupeau n’opérât pas un demi-tour.
Très vite il fallut organiser des tournois de cornes pour que La Noiraude puisse affronter chaque prétendante à la loyale. Je distribuais des volées cinglantes aux contrevenantes qui se regroupaient pour assaillir traitreusement la tenante du titre en la chargeant au flanc. Il fallait aussi se méfier des plus vieilles qui, mues par des pulsions kamikazes, chargeaient sans sommation sur la reine des chèvres. Ces comportements indignes et pathétiques me firent entrevoir la misère psychologique du règne animal. Néanmoins, combat après combat, jour après jour, La Noiraude retrouva sa place de leadeuse incontestée.
Il me fallut aussi affronter personnellement le bouc qui me testait traitreusement de ses cornes lorsque je passais à sa portée. Mes coups de bâton restaient sans effet sur son corps pourtant osseux. J’allai jusqu’à empoigner sa ramure et lui tordre le cou en le clouant au sol plusieurs secondes pour lui montrer qui était le maître. Ce fût a priori efficace dans la mesure où nous ne nous adressâmes plus la parole durant la courte année que dura mon séjour. Ce rapport me convenait parfaitement, je n’avais pas beaucoup d’estime pour ce drôle de zèbre qui se gargarisait avec l’urine des chèvres.
Une fois encore cependant, je dû affronter la bête fumante. Ce jour-là, j’avais fait entrer le troupeau dans la bergerie alors qu’on avait oublié d’enfermer dans le réduit les jeunes chèvres en pleine croissance pour éviter que papa bouc ne les engrossasse. Electrisé par l’aubaine, le fauve avait doublé de volume, une crinière lui était poussée en quelques secondes et l’or de ses yeux était entré en fusion. Les chèvres s’écartaient de sa course assoiffée d’inceste et de virginité. Je pus sans trop de mal soustraire à la vivacité de la bête les deux premières demoiselles : lorsque, me protégeant de son corps, j’entrainais par les cornes celle qu’il entreprenait, il se jetait sur une autre en écumant. Ça devint plus compliqué lorsqu’il ne resta plus qu’une seule chevrette. La raison revint soudainement au satyre, qui s’employa à me barrer le chemin du réduit où j’avais mis les jeunes chèvres en sureté. J’eu raison de cette stratégie en ménageant des poses pendant lesquelles je laissais entrevoir à l’animal obsédé qu’il allait pouvoir assouvir l’acte reproducteur. Je manœuvrais ainsi sournoisement, soustrayant toujours au dernier moment ma protégée à l’assiduité aveugle du bestiau. Je parvins finalement à m’enfermer avec les trois chevrettes dans le réduit. Mais il n’était pas question de sortir. Les cornes immenses du bouc montaient la garde, terriblement revanchardes. Pire, faisant preuve d’une détermination farouche, l’animal courroucé entrepris de défoncer la porte à grands coups d’étui corné. Pour éviter que la porte ne fût détruite, je la déverrouillai et amortissais les coups de boutoir avec mes bras, du mieux que je pouvais. La bête ne s’aperçut pas de la feinte et finit par chercher une autre issue. Je suivais son manège à travers les planches disjointes quand je réalisai que l’animal bourré de testostérone s’était immobilisé. Ce comportement inattendu m’intrigua. L’espace d’un éclair, je compris qu’un miracle avait lieu sous mes yeux. Le large port du bouc s’était coincé entre le mur de la bergerie et un pilier de l’enclos où je m’étais réfugié. Je sortis précipitamment du réduit, le verrouilla, et courus de toutes mes forces vers la sortie. À peine avais-je refermé la porte qu’un choc formidable l’ébranla. Je tirai la langue à l’animal dont la colère était brusquement retombée, et remontai narrer mon aventure à la compagnie.
Très vite, je tombai amoureux d’Élodie. Elle avait deux enfants ravissants et un mari, herboriste à ses heures, très porté sur les substances hallucinogènes, introverti et d’une douceur qui n’en finissait pas de me culpabiliser. Il m’avait à la bonne, mon tempérament non violent lui plaisait et il m’avait invité à venir cueillir avec lui des herbes aromatiques, alors que j’avais déjà embrassé sa femme sur la bouche. Il était grand, mince, et beau malgré une calvitie galopante. Son crâne bronzé sous ses cheveux fins et longs lui donnait des airs de guerrier masaï.
Élodie me confiait parfois ses enfants. Je me rappelle les avoir emmenés un jour à une fête artisanale locale. Des murmures s’élevaient sur notre passage. Les gens se retournaient avec des larmes dans les yeux sur l’apparition quasi christique du père s’occupant de ses enfants. Certains nous lançaient des branches de persil, des morceaux de pain d’épice ou des petits animaux de bassecours à plumer. Élodie n’était pas particulièrement belle. Mon frère disait qu’elle ressemblait à une vieille chèvre complètement folle. Les abus de toutes sortes l’avaient abimée, certes. Mais elle avait une estime d’elle-même indéfectible, une indifférence à la médiocrité environnante qui la rendait belle à mes yeux. Elle savait que malgré les apparences et les regards biaisés, elle était pure. Il y avait dans sa façon de se mouvoir, cette sauvagerie qu’on apprécie dans la dance contemporaine. Elle était fière malgré l’hostilité des inquisiteurs et de leurs chiens qui ne l’épargnaient guère. Il n’y avait aucun jugement dans le regard que je posais sur elle. Elle avait pris ses distances avec son mari qui se repliait sur son univers dépressif. Elle en avait soupé de ses délires mystiques et de ses drogues. Elle faisait l’amour violemment, comme un bélier, en poussant des cris rauques et en fermant les yeux. Les hommes s’imaginaient qu’elle était une fille facile mais elle avait un faible pour les poètes, les artistes et les rêveurs. Elle s’était laissée prendre aux pièges de la vie mais ne regrettait rien.
Élodie s’était lassée de moi car j’avais du mal à suivre ses méandres. Elle trouvait ma folie trop abstraite, mon cœur trop timoré, mon corps trop absent. Le jour arriva où elle ne me vît plus, j’étais devenu transparent, elle m’avait effacé. Il me restait le souvenir de cette fin de matinée où nous nous baignions nus dans un ruisseau glacé. Nous luttions en riant contre le froid pour parvenir à unir nos sexes. Nos rires avaient attiré nos amis. Nous nous étions séchés au soleil.
Fabienne
Élodie m’avait déjà quitté lorsque Thierry et Fabienne arrivèrent à la ferme de La Traverse avec leur nourrisson. Thierry était cool, le cannabis qu’il consommait régulièrement ourlait de rouge ses yeux d’un violet intense. Ses épaules légèrement voutées, façon boxeur, pouvait laisser accroire que c’était un garçon actif et volontaire. Rien n’était moins sûr. Tous les habitants de la ferme étaient de fameux loosers, y compris moi. Chacun à sa manière cultivait avec soin l’art de rater sa vie.
Fabienne était une Française d’origine coréenne. En surface, elle était calme et gentille mais au fond, elle était angoissée par son couple qui battait de l’aile. Selon Thierry, ils faisaient un break. La présence du bébé expliquait sans doute pourquoi ils étaient encore ensemble. L’exemple de Bruno et Femke confortait Thierry dans ses théories communautaires, où le plaisir et la sexualité n’avaient rien à voir avec la reproduction. L’éducation des enfants était la seule dimension absente de ses théories. Il pensait confusément que la communauté y pourvoirait.
Bruno et Femke étaient déjà en couple quand j’étais arrivé à La Traverse. Frank et Femke avaient échoués ici par hasard avec leur petit garçon de quatre ans. Ils étaient montés jusqu’à La Traverse pour acheter des fromages fermiers et avaient été séduits par ce petit paradis en forme de cul-de-sac. Bruno leur avait proposé d’y garer quelques temps leur camping-car. Puis l’amour avait fait le reste. Frank m’avait raconté que Bruno était le type d’homme qui faisait fantasmer Femke. Beau, grand, les traits juvéniles, charismatique, animal, tout le contraire de lui, intello, maigre, de taille moyenne, avec un visage de Hobbit. Frank et Femke s’étaient rencontrés à un cours de théâtre que donnait Frank à l’université où étudiait Femke. Frank était un théoricien du spectacle. Il avait pour ambition de devenir clown mais il était un piètre jongleur, ses grimaces ne faisaient rire personne, il avait du mal à tenir en équilibre sur une planche à bascule, sa voix ne portait pas. Pour autant, c’était un ami délicieux avec lequel je pouvais discuter pendant des heures. Il savait raconter les histoires. Frank était aussi un théoricien de l’amour. Il laissait sa compagne s’éclater avec Bruno pendant qu’il veillait au bien-être de son fils.
Femke et moi nous entendions bien car nous avions la même sorte de poil dans le creux de la main. Nous nous partagions les taches pour lesquelles les autres membres de la communauté n’avaient aucune appétence : la garde du troupeau et la garde des enfants. Ça arrangeait tout le monde. Pour autant, jamais nous n’eûmes de véritable échange, jamais nous ne développâmes une complicité d’aucune sorte. Comme Franz, elle parlait pourtant très bien Français. Nous nous croisions pour échanger nos gardes, voilà tout.
J’avais l’impression que Thierry et Élodie se rapprochaient. J’en eu la confirmation un soir, quand j’entendis les ahanements de Thierry imitant timidement ceux d’Élodie. Fabienne était au plus mal. Elle reprochait à Thierry de ne pas s’occuper suffisamment de leur gamin. Pendant ce temps, je coulais des jours heureux dans la fenière, en compagnie de Nelleke, mon premier grand amour qui était venu partager mon délire agraire pendant une courte semaine. J’avais très tôt abandonné la chambre qu’on m’avait allouée, pour me réfugier dans la fenière avec les chiens. C’était le seul endroit de la ferme où les puces n’entraient pas, probablement repoussées par le concentré de parfums stocké au creux des tiges. Malgré cela, et à son grand désespoir, le grand corps blanc de Nelleke était marqué çà et là par des morsures de siphonaptères, insectes sans ailes qui siphonnaient sans vergogne le sang de ma première fois.
Malgré ses vêtements élégants et ses allures de citadine, Nelleke s’était adaptée avec succès au petit monde de La Traverse. Bruno n’était pas insensible à son charme et c’était réciproque. Bruno avait décidément un faible pour les hollandaises. Heureusement, Femke montait la garde. Les deux compatriotes échangeaient dans leur langue natale des propos que personne ne comprenait. Ça les avait immédiatement rapprochées et cela semblait leur faire le plus grand bien.
Pendant ce temps, Fabienne nous regardait avec envie. Tout le monde était en couple sauf elle et Franz. Mais Fabienne ne cherchait pas un homme marié. Quoi qu’il en fût, Franz n’était pas son genre. Franz n’était pas non plus le genre d’Élodie. Celle-ci m’avait raconté qu’il avait essayé de l’approcher et qu’elle avait refusé tout net. Non vraiment, elle ne pouvait pas. Elle le trouvait trop prétentieux et, physiquement, ça n’était pas possible. Elle ne comprenait pas comment Femke, selon elle très avenante, avait pu tomber amoureuse de lui. Je lui avais dit que c’était son prof. Elle m’avait répondu qu’elle n’aimait pas les profs.
Nelleke ne pouvait pas rester plus longtemps. Le soir du jour où elle nous quitta, Fabienne se présenta à l’entrée de la fenière. Elle était appuyée contre le montant de pierre de l’ouverture, enveloppée de ses longs cheveux noirs qu’elle avait détachés. Nous avions discuté un moment. Elle m’avait expliqué que ça l’avait excitée de me voir avec Nelleke. Je lui avais répondu pour plaisanter, que René Girard avait une théorie là-dessus. Je n’avais pas développé et l’avait invitée à entrer dans mon royaume où les puces n’avaient pas droit de cité. C’est ainsi que notre liaison avait commencé.
Fabienne me raconta que Thierry avait été son premier et seul amour. J’étais le premier homme avec lequel elle trompait son mari. Elle me faisait miroiter un avenir dans lequel j’avais un peu de mal à me projeter. Il était question de descendre sur Marseille où son oncle tenait un restaurant chinois où nous pourrions travailler au noir. Mais avant cela, il fallait que je parvienne à la faire jouir. Heureusement, cela n’arriva pas. Ce n’était pourtant pas faute d’avoir essayé.
Notre relation arrangeait tout le monde. Fabienne avait retrouvé sa bonne humeur naturelle et Thierry pouvait profiter d’Élodie sans culpabiliser. Mais bientôt, les rapports de Fabienne et Thierry s’envenimèrent. Elle était à fleur de peau. Elle décida d’aller habiter chez sa grande sœur, à une trentaine de kilomètres de là. Cette décision soulageait tout le monde et on me sut gré de bien vouloir veiller au transfert. L’on me confia les clés du camping-car immatriculé en Hollande et je transportai Fabienne avec bagages et couvée, vers leur nouvelle demeure. Tu vas voir, ma sœur est géniale.
La sœur de Fabienne était en effet charmante et accueillante. Cette fan de jazz était employée de mairie et travaillait bénévolement dans une radio libre. C’est là qu’elle avait rencontré son amoureux, un tromboniste qui consommait celle qui élève dès potron-minet (Marie-Johanna). Ses yeux injectés de sang et son optimisme faisaient peine à voir. Il vivait au crochet de sa belle coréenne, tirant sur son shilom entre chaque tentative de faire avouer son instrument à coulisse. Au moment de nous quitter, Fabienne m’avait embrassé sur la bouche et avait dit, dommage. Je ne la revis jamais.
À peine rentré, je rencontrai Gerda, une amie de La Traverse qui était de passage. Elle m’avait trouvé rigolo et m’avait donné son adresse, au cas où j’aurais la bonne idée de venir la voir. J’avais surpris une discussion où Bruno confiait à Femke qu’il ne pouvait pas coucher avec toutes les filles comme je le faisais. Au fond de moi, je préférais cela à construire sur du sable une relation qui s’écroulerait dans le premier virage.
Ça sentait bon l’automne et la fin des amants. Femke et Bruno n’arrivaient plus à faire l’amour. Un jour, en fin d’après-midi, je vis Franz descendre l’escalier qui donnait accès aux chambres de l’étage, tenant son sexe dans ses mains comme une portée de lapereaux. Il était tout fier d’exhiber sa verge rouge et gonflée. En la rinçant dans l’évier où trempaient les faisselles, il me dit, putain, ça faisait bientôt cinq mois que je n’avais pas fait l’amour – ce qui, à La Traverse, constituait un record. Femke assurait ses arrières. Je supputai que nos Don Quichottes de l’amour, allaient bientôt repartir au pays des moulins.
Je ne revis jamais les Hollandais. En remontant vers leur pays, ils avaient eu la gentillesse de passer chez mes parents pour y déposer une male contenant des affaires qui m’encombraient. C’était une famille épatante, unie et débordant de joie de vivre que mes parents avaient invitée à passer la nuit. Ils m’avaient encouragé à les prendre comme exemple.
La dernière fois que je revis Bruno, il se faisait engueuler par son boss, sur un chantier de construction, dans un village proche de La Traverse.
La dernière fois que je revis Thierry, il attendait un bus à la gare routière de Nice. Il avait une grosseur à un doigt et probablement pas d’argent pour payer le médecin. Il allait voir son fils. Fabienne vivait à Marseille, chez son oncle.
Quelques années plus tard, je revins à La Traverse pour voir ce qu’il en était advenu. Les trois chiens n’étaient plus là. Un grand chien-loup au poil foncé m’accueillit avec une haine peu commune. Le troupeau avait été renouvelé. Aidé d’un couple parasite, un jeune gars sympathique et enthousiaste galérait pour maintenir l’exploitation à flot. Sa grande sœur, Nathalie, était venue passer une semaine de vacances agrestes, accompagnée de son mari et de sa fille. Le mari de Nathalie était professeur d’histoire. Il mettait un point d’honneur à participer aux taches fourragères. Il était fourbu, en surpoids et mal bâti pour ce genre de travaux. Nathalie était la fille du directeur du Lycée dans lequel j’avais passé mon baccalauréat. Je ne la fréquentais pas à l’époque. Elle me connaissait car elle était en classe de lettres avec un ami commun. Je l’avais croisée dans Paris deux ans plus tard. Nous avions passé l’après-midi ensemble et ce fut tout. Elle était la dernière personne que je m’attendais à rencontrer à La Traverse. Sa fille de cinq ans, très éveillée, avait le propos acide. Elle avait du mal à accrocher avec le petit garçon aux joues rouges du couple parasite. Il m’a l’air complètement débile, cet oiseau-là. Nathalie la réprimandait mollement. Heureusement, le petit garçon, sensiblement du même âge, n’était pas susceptible et avait une grande expérience des petites filles. Il lui demanda si elle avait un zizi. Non, moi j’ai une zézette. La glace était rompue. Ils passèrent la soirée à jouer à se jeter sur une pile de matelas en s’esclaffant.
Dieu sait qui je retrouverais s’il me venait l’idée, là, maintenant, de passer une tête à La Traverse !
Gerda
J’étais venu voir Gerda avec la ferme intention de ne pas passer l’hiver à La Traverse. J’avais expliqué que voilà et j’avais pris mes cliques et mes claques. J’étais descendu au village, les chiens qui se doutaient de quelque chose m’avaient suivi. Je me retrouvai à faire du stop avec trois clébards. En partageant mes nuits avec eux dans la fenière, ils avaient fini par me considérer comme leur chef de meute et ils n’envisageaient plus vivre sans moi. Je fus réduit à les chasser à coup de pierres en essayant de ne pas les blesser.
Gerda vivait simplement. Elle roulait ses clops et buvait du rouge qui tache. Elle avait les cheveux roux, coupés courts. Elle travaillait au noir comme aide-cantonnière. C’était une fausse maigre réconfortante. Elle faisait l’amour en plein jour, sans fermer les volets, en me regardant de ses grands yeux émerveillés en souriant jusqu’aux oreilles. Ça avait le don de me déstabiliser.
Elle était tombée malade. Une fièvre du mercredi soir, rien d’extraordinaire. Pendant plusieurs jours, j’avais été son garde malade. Je lui lisais L’exorciste de William Peter Blatty. Elle était émue. Jamais on ne s’était occupé d’elle de la sorte. Je m’étais enthousiasmé pour l’habileté de l’auteur qui entrelaçait les points de vue de la famille, de l’ethnologue, du prêtre, du psychanalyste et du policier. Pour éviter les contagions, nous faisions l’amour sans nous embrasser. Ce qui lui permettait de me regarder à loisir. Je commençais à m’y habituer.
Elle défendait la théorie selon laquelle les méchants des contes étaient les boucs émissaires des histoires réelles dont ces contes étaient inspirés. Elle m’avait traduit plusieurs chapitres d’un livre qui démontrait cela pour plusieurs contes bien connus. Dans Hansel et Gretel, l’affreuse sorcière qui termine cramée dans son propre four était en vérité une concurrente de Hansel, fournisseur officiel en pain d’épice de sa majesté l’Empereur. Hansel avait torturé sa concurrente pour lui arracher sa recette. J’avais été séduit par l’idée de faire émerger le bouc émissaire derrière les traits du méchant. Mais j’avais considéré avec prudence la référence à un fait divers précis, tant les faits divers pouvant illustrer un conte me semblaient nombreux. D’autant que l’origine des contes se perdait dans la nuit des temps. Nous nous étions amusés à réécrire Le Petit Chaperon Rouge en partant de ce principe.
Gerda m’avait donné l’adresse d’une ferme restaurant tenue par deux vieilles sorcières susceptibles de m’employer. Nous nous quittâmes bons amis, la joie de vivre chevillée au corps.
Hermine
La soirée était bien avancée. Les automobiles se faisaient rares. Je n’étais pas certain de pouvoir atteindre la ferme de La Traverse avant la nuit. Un Jean-Jacques s’arrêta. Il pouvait m’avancer. Nous nous racontâmes nos vies, surtout la mienne. Nous nous racontâmes nos projets, surtout les siens. Je lui demandai s’il était psychologue. Il me posait en effet des questions assez intimes, comme s’il avait voulu savoir à qui il avait vraiment affaire. Je trouvais ça amusant mais un peu excessif pour les quelques kilomètres que nous avions à parcourir ensemble à l’intersection de nos deux misérables vies. C’est alors qu’il m’informa qu’il devait passer voir une amie. Si j’étais d’accord, je pouvais l’accompagner. Peut-être même me proposerait-elle de m’héberger pour la nuit. J’acceptai cette offre inespérée et commençais à comprendre le sens de l’interrogatoire que je venais de subir.
Hermine était une jeune femme avenante quoiqu’un peu maigre. Très bonne camarade, elle me mit tout de suite à l’aise. Elle avait semble-t-il une confiance totale en son ami. Nous dînâmes sur le pouce. La pensée que Jean-Jacques n’avait pas prévu de passer voir Hermine ce soir-là m’effleura. En tout cas, elle n’en avait pas été avertie. Par politesse, je ne laissai rien paraître. Nous avions pris le même train et nous étions réunis dans le même compartiment non-tueur.
Entre la poire et le fromage, Jean-Jacques m’informa qu’il pouvait me déposer je ne sais où. Je lui demandai à combien de kilomètres de Sisteron ça se trouvait. Il me répondit, six. C’est bon, je finirai à pied, il me restera en tout dix kilomètres, c’est l’affaire de deux heures de marche. C’était un peu gros mais, bon. Vous vous foutez de moi, là les gars. C’est quoi votre petit numéro ? C’est évident qu’il va dormir ici, non ? J’étais confus et à la fois content qu’elle nous ait démasqués aussi facilement. Non seulement Hermine était très avenante mais elle n’était pas tombée de la dernière pluie. Je répondis un truc du genre, je brulais d’envie de te le demander mais je craignais que tu te sentes obligée d’accepter. Ça m’aurait fait mal pour toi et ça m’aurait mis mal à l’aise. Je ne pouvais pas courir un risque pareil, même si en définitive tu aurais pu refuser, mais ça t’aurait fait mal pour moi et ça t’aurait mis mal à l’aise. Je n’étais pas sûr d’avoir marqué des points. Bon, je vous laisse, avait pris congé Jean-Jacques.
Nous avions continué à discuter jusque tard dans la nuit qui décidément tombait de plus en plus tôt et durait de plus en plus longtemps. Elle m’avait montré les photos de son book. Je rêvai un instant qu’elle eût un jour pour moi ce regard qu’elle offrait au photographe, où se mêlait à l’envie de plaire, une sincérité presque fragile. L’hôpital qui se fout de la charité avait quand même supputé un déficit d’égo. Jamais je n’aurais osé montrer des photos de moi pour séduire une fille. Essayait-elle seulement de me séduire ? Peut-être que les mannequins considéraient leur corps comme un simple outil de travail et qu’ils partageaient leur book comme un conducteur d’engins vous montrerait avec fierté un album des machines qu’il a pilotées. Mais à cette heure avancée de la nuit, le choc des photos l’emporta largement sur mes analyses à deux balles – on était un samedi soir et la fièvre guettait nos cœurs.
Elle me raconta l’histoire de Jean-Jacques. Il était une fois, deux copines dont les deux copains étaient nés à quelques jours d’intervalle. L’une d’elle proposa de leur offrir un cadeau original. Elles échangeraient leurs partenaire, l’espace d’une nuit. La seconde copine n’était pas très emballée par cette idée mais elle se laissa convaincre. Celle qui avait eu l’idée en resta là après cette expérience d’un soir, mais la réticente vécut avec Jean-Jacques une nuit inoubliable. Un nouveau couple se format, au grand dam de ceux qui étaient restés sur la touche.
Il fallut dormir, enfin. Mon matelas était tout à fait convenable. Nous continuions à discuter dans l’obscurité. Ça va ? Oui. Tu es bien installé ? Oui, merci. Puis au bout de quelques minutes d’échanges informels destinés à retarder le sommeil, tu peux venir dans mon lit, si tu veux. Tu crois ? Oui. Je me jetai littéralement sur elle. Ça la fit rire. Je n’avais pas compris qu’elle m’invitait juste à dormir dans son lit. Tu ne manques pas d’air. Nous verrons demain matin. Il faut dormir maintenant. Je l’enlaçais tendrement façon Guy Degrenne et nous nous endormîmes l’un contre l’autre pendant que le feu s’éteignait dans la cuisinière.
Le lendemain matin et quelques caresses plus tard, elle se mit à califourchon sur mon sexe et en avant Guingamp. Elle se bricola un orgasme aux petits oignons et me dit qu’elle était en mesure d’atteindre l’orgasme avec n’importe qui. Je ne savais pas comment je devais prendre cette information mais j’acceptai ce cadeau de la providence sans faire d’histoire. Puis elle se leva pour rallumer le feu dans la cuisinière. Habillée, elle était mince, nue, elle était maigre. Mangeait-elle seulement à sa faim ?
J’appris que sa précédente relation s’était terminée quelques mois auparavant. Même si elle ne laissait rien paraître, elle avait du mal à encaisser. Ils avaient prévu de construire une maison et de faire un enfant. Elle avait trente-deux ans et tout restait à reconstruire. Je mettais sur le compte de son mal-être les crises de spasmophilie dont elle était parfois victime. Elle devait respirer dans un sac en plastique pour compenser l’hyperventilation. Les crises pouvaient survenir à l’occasion d’une émotion intense, d’une angoisse, que sais-je. Elle m’avait prévenu. Dans ces cas-là, je peux être odieuse, ne m’en veux pas. Le cas s’était présenté alors que nous dînions chez Hubert et Kathleen, les seuls amis qu’elle possédait dans ce hameau désolé. Elle semblait prise de démence, m’appelait, mon p’tit trou duc (j’avais dix ans de moins qu’elle), ricanait sans raison apparente, comme si elle était possédée. La présence du couple qui jouait au papa et à la maman avec leur nourrisson y était peut-être pour quelque chose. À moins que le fait de ne plus être l’unique centre de mon intérêt ne réveillât en elle la crainte d’être abandonnée. Ou encore ma facilité à créer des liens avec des étrangers, ou cette façon que j’avais, en groupe, de mettre notre relation entre parenthèse et de communiquer à égalité avec chacun… On nous avait raccompagnés et elle s’était apaisée une fois rentrée.
Pourtant, ses amis ne faisaient pas rêver. Non seulement Hubert était immature, mais il était également paresseux et velléitaire. Il n’avait aucune connaissance monnayable et se trouvait en fin de droits. Il avait jeté toutes ses économies dans une ruine située au cœur du village – de là à dire que son cœur était en ruine, il n’y avait qu’une barrière de sécurité à franchir. L’endroit était libre d’accès et des pans entiers menaçaient de s’écrouler. La seule solution aurait été de tout raser pour reconstruire. Un chantier aussi dangereux que pharaonique qui ne pouvait être réalisé que par des professionnels. Je n’osais lui dire le fond de ma pensée, me contentant d’un éternel, il y a du potentiel mais le chantier est énorme. C’était bien l’avis de Kathleen que ça rendait folle. Dieu seul sait ce qu’il lui avait fait miroiter. J’imaginais qu’à court terme, elle allait devoir trouver un travail pendant qu’il s’occuperait du bébé, même si elle craignait pour la sécurité de l’enfant tant son mari était distrait. Kathleen pétait régulièrement les plombs et débarquait chez Hermine avec son fils pour décompresser.
Tout cela ne nous empêchait pas de couler des jours heureux. Nous récoltions des pommes pour faire de la compote. Passé une certaine date, l’accès aux cultures de goldens était autorisé. Les fruits étaient petits mais savoureux et non traités. Ça sentait bon l’automne. Nous étions même allés voir un concert de Fontaine et Areski. Nous avions emmené avec nous la fille d’Élodie qui avait besoin d’une nounou, ce soir-là. Brigitte était nerveuse car Areski l’emmerdait avec des problèmes de régie. Elle lui avait expliqué avec fermeté qu’elle avait besoin de se concentrer et de s’isoler pendant une heure ou deux avant d’entrer en scène. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours mariés.
Hermine adorait m’habiller avec ses vêtements. Je passais le plus clair de mon temps à poil dans sa salopette rose, improvisant maladroitement à la flûte traversière sur Higelin’ 82. Il faisait de plus en plus froid. La maison d’Hermine était minuscule et très difficile à chauffer. Un jour où nous rentrions d’une virée aux alentours des grandes chambres froides en bétons où était stockée la récolte de pommes de l’année, nous n’avions pas pris la peine de rallumer la cuisinière, nous avions ôté nos pantalons et fait l’amour en doudounes sur le canapé. Cet accoutrement nous avait excités tandis que le froid nous incitait à nous remuer le cul. Les bas de nos corps semblaient autonomes, indépendants de nos volontés. Nos sensations étaient décuplées. C’était extraordinaire. À la fin, elle avait dit, ça faisait longtemps que je n’avais pas joui en dessous. J’étais à deux doigts de la demander en mariage.
Mais il en alla autrement. Hermine allait bientôt faire un stage d’apiculture auquel elle était inscrite depuis longtemps. Que lui était-il passé par la tête ? Elle s’était brusquement transformée en abeille au dard barbelé, un de ces dards qui tue aussi bien celui qui en reçoit le venin que celui qui l’abandonne dans la chair de son ennemi. Mon immaturité cumulée à notre différence d’âge avaient-elles déclenché une alarme biologique, quelque part dans le système limbique d’Hermine ? Je ne saurais dire. Je voulu croire à une nouvelle crise de spasmophilie mais je dus me rendre à l’évidence, un quart d’heure plus tard, j’étais sur le bord de la route avec mon balluchon. Ses paroles tournaient en boucle dans ma boîte crânienne sans pouvoir s’imprimer, notre relation est vouée à l’échec, je n’ai plus envie de souffrir. Me mettait-elle à l’épreuve ? Devais-je supplier ? Devais-je aller faire un tour et revenir comme si rien ne s’était passé ? La route était devenue comme une seconde nature. Ce fut sur un coup de cœur qu’elle m’avait jeté dans les bras d’Hermine, ce fut sur un coup de tête qu’elle me reprit. Je ne résistai pas, anesthésié par le vent froid qui parcourait sans trêve cette vallée de folie où des soldats mourraient par milliers. Le hasard fit en sorte qu’une voiture s’arrêta au bout de quelques minutes d’attente à cet endroit où il ne passait jamais personne, m’emportant vers jamais.
Quelques semaines plus tard, je reçu un colis à la ferme restaurant où j’avais été accepté comme garçon à tout faire. Un sweat-shirt blanc, deux paires de chaussettes en laine et une lettre. Hermine espérait que j’allais bien et que nous allions bientôt nous revoir. Je lui répondis que j’étais très pris par mon nouveau boulot et que j’étais en couple avec une autre fille. Tout cela était vrai mais ma tristesse était infinie, une tristesse qui allait durer plusieurs années. Quelques jours plus tard, quelqu’un avait dérobé mon colis. J’étais presque soulagé. Je ne sais toujours pas comment elle s’était procuré mon adresse.
Iolanda
Je me pointai un matin à la ferme restaurant dont Gerda, une spécialiste des petits boulots précaires, m’avait gentiment fourni l’adresse. L’établissement était tenu par deux sœurs âgées qui avaient chacune leur chien, un setter en surpoids à l’arrière-train pelé et un basset Hound qui exhibait tristement la face intérieure hypervascularisée de ses paupières inférieures. Menu unique à cent francs par personne tous les samedis et dimanches midi. Beignets de fleur de courgette, raviolis frais à la bourrache, gigot d’agneau fermier, tuerie aux pommes et jus de la treille. Les clients montaient de Nice pour venir s’éclater le rumen et respirer le bon air de l’arrière-pays. Je serais logé, nourri, blanchi en échange de divers services, nourrir les moutons, ouvrir aux poules, ramasser les œufs, nourrir et tuer les lapins, ramasser la bourrache, nettoyer la salle du restaurant et aider à différents menus travaux. Je n’avais jamais tué de lapin mais j’acceptai sans faire le malin.
L’établissement hébergeait plusieurs personnes dont au moins deux hommes en pension complète. Un tout maigre qui avait choisi de profiter de sa retraite en ce lieu providentiel et un ouvrier du bâtiment italien rondouillard dont je solliciterais le tempérament sanguin le jour où l’on me demanderait de rapporter un lapin. Un jeune Breton trentenaire avait, au rez-de-chaussée, une chambre donnant sur l’extérieur. L’anachorète vivait incrusté dans ce réduit comme un anatife, complètement marginalisé. Il avait fait des études d’histoire. Les deux sœurs l’aimaient bien, elles lui gardaient toujours une part de tarte. Il avait des théories sur pas mal de choses mais restait de bonne compagnie. Il ne fumait ni ne buvait.
Une très vieille tante complétait le tableau. Sa vieillesse et son obésité l’empêchait de descendre au rez-de-chaussée. Elle était monstrueuse et méchante. Elle ressemblait à la sorcière de La Petite Sirène de Walt Disney. Soi-disant, elle faisait exprès de se pisser dessus pour culpabiliser ses deux nièces qui prenaient soin d’elle. On l’entendait parfois tomber de son lit comme un sac de grain. Les deux vieilles femmes la laissaient s’imbiber d’urine et finissaient par monter la remettre en place au prix d’efforts surhumains.
Côté restaurant, deux filles se relayaient au service, dont l’une habitait sur place. L’autre faisait des remplacements et venait en appoint le weekend. Elle se nommait Iolanda et habitait un village voisin. Elle s’était fait refaire le nez et se déplaçait en fiat Panda. Ses parents italiens avaient émigré de la lointaine Tunisie. Elle était ambitieuse, sensuelle, active et colérique. Elle avait été l’assistante d’un avocat qu’une blessure au genou avait empêché de devenir joueur de foot professionnel. À cette époque, elle faisait l’amour avec lui pendant les horaires de bureau. Avant de me connaître, elle sortait d’une relation avec un artiste peintre plus âgé qu’elle, qui habitait le même village. Il était courtois, manipulateur, musclé, bronzé, souriant, talentueux. Il avait une calvitie bien entretenue, une paire de moustaches gauloises, des yeux pétillants et fendus comme ceux des renards. Il était architecte de formation. Sa mère habitait le même village. Il avait de l’entregent. Il peignait une toile tous les matins. Il avait paraît-il un très beau sexe et l’orgasme décomplexé. Pendant l’amour, il se concentrait exclusivement sur son plaisir qui faisait plaisir à voir.
Ce village était rapidement devenu le mien. Tu viens de la part de Gerda, c’est ça ? Oui. C’est incroyable, je ne sais pas comment elle fait pour être toujours avec des beaux mecs. C’était flatteur pour moi mais pas pour Gerda. Je viens de quitter le mien et j’en ai marre de dormir toute seule, t’as pas envie de passer la nuit avec moi ? Le lendemain, Iolanda avait choppé la crève. Elle m’avait passé les clés de sa Panda pour que j’aille bosser. Je m’étais occupé d’elle en repensant à la crève de Gerda. Peut-être que étais-je un porteur sain.
Iolanda avait contracté une pneumopathie. L’infirmière m’avait appris comment et où enfoncer chaque jour l’aiguille de la seringue pour éviter le nerf sciatique. Je m’étais fait la main sur les chèvres osseuses de La Traverse, le râble de Iolanda ne présenta aucune difficulté. L’aiguille s’enfonçait comme dans du beurre et je prenais soin de masser longuement le point de perforation afin que la pénicilline diffusât rapidement et qu’aucun bleu ne se formât. Iolanda se remit doucement et je pus faire connaissance avec ses seins parfaits, son sexe parfait, ses chevilles parfaites, sa taille parfaite, son ventre parfait. Son cul, je le connaissais déjà. Elle faisait partie de ces nanas que tout le monde regarde sur la plage. Mais elle n’en avait cure et restait modeste. Son nez était là pour lui rappeler que la perfection n’était pas de ce monde. Iolanda lisait très peu, ce n’était pas une intellectuelle. Elle préférait faire ses nuits, faire la cuisine, faire l’amour, faire de la marche à pied, se faire des amis, se faire une toile, à peu près dans cet ordre. Aussi, étions-nous toujours par monts et par vaux, sillonnant l’arrière-pays niçois qu’elle connaissait sur le bout du cœur.
Nous fréquentions quelques habitants permanents du village. Il y avait l’ex de Iolanda, le peintre, qui aimait recevoir et pousser la chansonnette avec son copain d’enfance. Il y avait ce couple d’Afrikaners qui avait dû quitter la pointe de l’Afrique. La femme, très belle et raffinée, parlait avec un accent cultivé de l’opulence passée. Ils avaient deux enfants magnifiques et une très jolie maison accrochée au flanc de la montagne. Son mari était souvent absent. C’était un ancien danseur étoile qui cherchait à se reconvertir dans la mise en scène. Quand il était présent, il traînait en slibard dans une robe de chambre écarlate à la texture invraisemblable, écoutant des opéras de Mozart, un verre de Casoni Rosso à la main. Il aimait dévoiler ses jambes musclées. Témoin de cette décadence XXL, sa femme devenait lentement folle et essayait de passer son permis de conduire.
Il y avait aussi le jeune couple qui avait repris l’épicerie. Avec ça il vous faut autre chose, ma p’tite dame ? Un garçon athlétique avec une grosse tête d’ange, des boucles blondes et les lèvres de Cupidon. Sa compagne, une sorcière à cheveux noirs au caractère bien infusé lui tenait tête. Ils étaient fusionnels et à couteaux tirés. Elle avait fait des études de commerce et avait effectué un stage de sept mois aux Etats-Unis, dans la boîte de son petit ami de l’époque. Puis elle avait roulé sa bosse au Canada, en compagnie de Tête d’ange. Ils gagnaient leur vie en produisant un spectacle érotique. Les deux Français avaient là-bas leur petit succès.
Dois-je encore parler de cette femme aux amours oscillant entre deux régimes amaigrissants, qui tenait un salon de thé pendant la belle saison ? Et de ce jeune garçon un peu autiste, un peu pyromane qui connaissait par cœur les horaires des vols de l’aéroport de Nice ? Restons-en là, sinon, je vais devoir évoquer l’arrogance de ces chats qui hantaient par centaines les bâtiments abandonnées de ce village.
La plus âgée des deux sœurs qui m’employaient avait un fils unique dont elle était très fière. Il était ingénieur CNAM et travaillait à la mairie de Nice où il mettait en place des programmes de réinsertion. Me sentant un peu à la dérive, elle me conseilla de suive la voie du CNAM. Le hasard lui donnerait raison quelques années plus tard. Elle nous avait pistonnés, Iolanda et moi, pour que nous bénéficiions d’un stage de six mois d’initiation à l’informatique. C’est ainsi que je fis mes premiers pas dans le monde virtuel.
Iolanda avait trouvé un appartement bon marché en bordure du vieux Nice. On sous-louait à un photographe pour lequel elle avait travaillé. Cette ville qui attendait la fin du monde sur ce littoral azurescent était pour moi une découverte, avec ses relents d’Italie, sa promenade des Anglais, son Negresco, son marché aux fleurs, sa population du troisième âge, ses duchesses archisèches mais fausses, et sa kyrielle d’extravagances maraichères et culinaires : olives, mesclun, cébettes, tapenade, pissaladière, socca, tarte aux blettes, pan bagnat, citrons, kakis, et les incontournables escargoulettes, ces petits escargots terrestres à coquille poreuse des talus méditerranéens.
Il y avait la lumière de novembre et la mer céruléenne sous le ciel bâché d’azur. La côte se balançait dans son hamac argenté et les mouettes rieuses jouaient à pile ou face dans le casino des airs. Des quinconces de grues à tour se dissolvaient dans les camaïeux lointains, attestant le dynamisme immobilier de la cité mouroir. Sur les collines, des palais jaune citron abandonnés cherchaient leur clé, agenouillés dans les agaves. L’odeur de l’urine chantait dans les ruelles de la vieille ville où les boutiquiers vendaient des souvenirs et de la chair d’oiseau à emporter. Chez les marchands de journaux, il restait encore quelques exemplaires du roman policier de l’été. Avec les jours, le monde apetissait. Vêtus de chemisettes hors saison, des hommes aux poitrails lanugineux gobelotaient des anis devant des établissements aux enseignes effacées, mi-débits mi-dépôts, mi-épiceries mi-domiciles. Parfois, un chapelet de nonnes traversait la réalité en pointillés. Sur la promenade des Anglais, les vieux regardaient, avec des réminiscences prostatiques, passer de vieilles otaries aux paupières douloureuses, remorquées par des carlins soucieux qui tiraient sur leur laisse avec des engouements de lemmings suicidaires.
Le matin, on ramassait des mouches mortes sous les fenêtres. On avait soif de boissons pétillantes. On s’exprimait en phrases courtes. On avait la nostalgie des fresques murales. Le soir, le ciel descendait comme un grand animal inoffensif, lécher les doigts des basiliques en sucre d’orge, et la mer, qui ne s’éloignait jamais trop des villages, lâchait ses palombes sur nos rêves d’infini.
Je ne savais plus trop si j’étais amoureux de Nice ou de Iolanda. Souvent, Joseph, le meilleur ami de Iolanda et de pas mal de monde dans cette ville, passait la soirée avec nous, à jouer au whist.
Un jour, une amie de Iolanda qui vivait assez loin dans l’arrière-pays nous avait prêté son appartement pour quelques jours. Une industrie du miel prospérait dans ce patelin de basse montagne où Iolanda avait travaillé jadis. Nous avions fait l’amour dans le noir et ça s’était plutôt bien passé. Dépaysement ? Voyage ? Altitude ? Obscurité ? Allez savoir. Iolanda décidât qu’il faudrait renouveler ce type de séjour.
A la fin de la deuxième année, j’allais périodiquement rejoindre mon père dans le Limousin pour l’aider à construire sa nouvelle demeure. Il avait laissé la maison familiale à ma mère, lorsqu’ils avaient divorcé, en échange de mensualités qui l’aidaient à rembourser son emprunt. Elle avait repris des études de comptabilité et s’en sortait plutôt bien. Elle avait un emploi de chef comptable dans une entreprise de transport, à quelques kilomètres de chez elle. Je me pointais chez mon père lorsqu’il atteignait un nouveau plancher. Une fois le plancher construit, je retournais à Nice. Parfois, Iolanda m’accompagnait ou me rejoignait dans ce pays lugubre. Je me rappelle très bien la dernière fois où elle m’avait rejoint, juste avant que nous nous séparions. Nous avions fait l’amour dans la lande déserte, elle allait nue sur le chemin, seulement vêtue de grandes chaussettes de laine rose qui l’habillaient jusqu’à mi-cuisse et de chaussures de ville qui n’en menaient pas large dans les ornières laissées par les véhicules à débarder le chablis. Sa silhouette sexy sous le ciel sombre avait quelque chose d’irréel.
Après avoir décidé de mettre fin à notre liaison, nous avions laissé tomber l’appartement mais avions continué à squatter en couple, à droite à gauche. Accessoirement, nous continuions à avoir des rapports sexuels. Un jour où nous dormions chez des amis, elle m’avait procuré une sensation inédite en fourrant sa langue dans mon anus. Elle faisait l’amour comme si plus rien ne comptait, comme si tout était possible. Une autre fois, nous étions dans notre tente, sur le terrain d’un ami druze qui avait organisé une fête pour les fiançailles de son ex. Iolanda m’avait dit, viens, tu peux y aller. D’un rapide calcul j’avais conclu qu’il n’était pas prudent de me lâcher en elle présentement. Je te dis que c’est bon. Ce fut la dernière fois que nous fîmes l’amour, l’éjaculat de la dernière chance. Elle tomba enceinte et se fit avorter.
Je remontai sur Paris. Ma mère m’avait trouvé un boulot de manutention dans l’industrie du verre, chez un client de l’entreprise de transport où elle travaillait. J’y resterais sept mois. C’était le maximum autorisé avant le CDI. Pendant ce temps, Iolanda s’était rapprochée d’un ami du couple d’épiciers de l’arrière-pays, qui, après un séjour initiatique en Inde, venait s’installer à Nice pour faire carrière dans l’immobilier avec un ami. Pendant que je travaillais à la chaîne en deux-huit, quelque part en Seine-et-Marne, elle se fit de nouveau avorter, par deux fois.
Une fille naîtrait la fois suivante. L’agence serait un succès, le couple s’installerait dans une résidence ultrasécurisée et Joseph continuerait de passer certains soirs pour jouer au whist. Malgré des cours d’aïkido hebdomadaires, l’agent immobilier grossirait en même temps que son chiffre d’affaires.
C’est chez une amie commune, en Île-de-France, que je rencontrai Iolanda pour la dernière fois. Elle avait repris des études et était devenue assistante sociale. À ce propos, je remarquai qu’il lui arrivait de parler comme une assistante sociale. L’agence avait fait banqueroute, l’associé et néanmoins ami était parti avec la caisse. Il avait fallu liquider la résidence ultrasécurisée. Le couple n’avait pas résisté à la crise économique et avait divorcé. Elle avait la garde de sa fille.
Julia
Certains jours, Julia empruntait, le temps d’un court trajet, l’autocar qui me déposait au collège. Son excitation devait être due au fait qu’elle avait loupé son bus ce jour-là. Chaque fois, c’était comme si un ange avait transformé le car scolaire en autocar céleste. Isabelle Adjani n’occupait pas encore le devant de la scène mais c’est à elle qu’elle ressemblait, Isabelle quand elle souriait. En moins lunaire, en plus solaire, et peut-être aussi avec des traits plus doux. Son sourire crevait l’écran. Onze ans plus tôt, Nougaro n’avait pas écrit Le cinéma en pensant à elle car elle n’avait que deux ans. Sa mère était italienne et son père allemand. Les ondulations de ses cheveux noirs coupés courts encadraient ses joues d’un blanc arboricole. Je savais que son visage emplirait mon cerveau de bulles jusqu’au soir. Ses yeux sombres étaient pleins de lumière. Lorsque nos regards se croisaient, elle marquait le point puis reprenait rapidement sa place dans l’équipe, me laissant à mon effervescence. Son grand-frère et moi étions dans la même classe et portions le même prénom. Il avait un an de retard, nous avions donc deux ans d’écart. Il trainait toujours avec les mêmes personnes et se mêlait rarement aux élèves de la classe. Il écrivait de la poésie et fabriquait des explosifs à base d’engrais. Leur père écoutait de la musique militaire.
Des années plus tard, Julia avait pris mon frère en stop et il lui avait proposé de passer chez nous. À cette époque, j’étais revenu en Île-de-France pour faire de la manutention durant sept mois, dans une usine de l’industrie du verre qui fabriquait des écrans de télévision. Ma mère m’avait pistonné auprès du directeur de l’usine qui était un client et ami du directeur de l’entreprise de transport où elle était chef-comptable. Une entreprise familiale où travaillaient la maîtresse du patron, leur fille et son demi-frère issu de l’union légitime. La femme du patron était, paraît-il, une femme très distinguée. Trop peut-être, si l’on en juge par les mœurs moins conventionnelles de sa rivale qui avait plus de botte et plus de chien.
Julia et moi prîmes l’habitude de nous retrouver le soir, chez son frère dont elle gardait la maison. Il était en vacances avec sa future épouse, du côté de Bordeau. Il travaillait dans les hydrocarbures et gagnait pas mal d’argent. Je garais ma bicyclette à l’intérieur de la maison. Je ne garde pas un souvenir ébouriffé de nos ébats mais ce fut, durant ma vie intranquille, le seul rêve de gosse que je réalisai. Je me souviens que nous riions beaucoup et que ses lèvres étaient douces. J’aurais pu rester des heures, la main entre ses cuisses. Une nuit, le couple de propriétaires débarqua fortuitement. Julia était horriblement gênée. Il fallut évacuer le lit conjugal et déguerpir avec la bicyclette.
Je revis Julia des années plus tard. Je construisais, à l’époque, une maison, à cent mètres de celle qu’avait construite mon père après son divorce. Il était remarié à une femme de la région qui avait deux enfants. Julia n’avait pas le moral et je l’avais invitée à venir faire le vide dans ma diagonale.
Julia vivait en Allemagne où elle avait repassé son baccalauréat. Il me semble qu’elle avait repris des études. Elle vivait avec un Allemand que nous appellerons Markus, au cas où nous devrions faire appel à lui – mais c’est peu probable. Elle portait des Birkenstock à côté desquelles elle marchait. Elle ne savait plus où elle en était sentimentalement et comptait sur moi pour lui remettre les idées en place. Ses hanches s’étaient élargies et des crins blancs piquaient sa chevelure. Le lit était étroit. J’avais posé une main sur son ventre arrondi et lui avais dit, j’espère que tu vas bien dormir. Elle avait répondu en riant, je ne sais pas si je vais dormir si tu commences comme ça. Ma main avait glissé vers son sexe et je l’avais aidée à retirer sa petite culotte.
Au matin, nous partîmes visiter le Limousin avec une toile de tente. Une jolie parenthèse dans la campagne française. Il faisait chaud. Je la prenais en photo. Je n’étais pas l’homme de sa vie. Elle avait gardé pour elle ses problèmes de couple. Elle voulait oublier, rêver, exister autrement. Les derniers jours, elle était devenue distante et elle s’en excusait. Je la rassurais de mon mieux sans feindre la tristesse. Puis elle décida de rentrer en Allemagne. Elle avait tiré de l’argent pour acheter son billet de train. Nous avions passé l’après-midi au bord d’un lac de barrage. J’avais garé la GS dans un chemin et nous étions descendu vers la rive, en quête de fraîcheur. Nous avions croisé une bande de jeunes, vautrés sur le sentier. L’un d’eux s’était excusé avec une componction hors de propos qui ne m’avait pas mis la puce à l’oreille. Lorsque nous étions remontés à la voiture, on avait ôté le joint de la lunette qui avait glissé sur la banquette arrière. Les papiers et l’argent de Julia avaient disparu. Pourquoi avait-elle laissé son sac à l’intérieur ? Elle n’interpréta pas cet événement comme un augure qui aurait dû la décourager de retourner en Allemagne. Au contraire, elle se dit que cela ne serait jamais arrivé, là-bas. Chacun voit l’oracle à sa porte. Surtout quand on est une descendante d’Aphrodite qui ne laisse personne décider de sa vie. Je l’accompagnai comme prévu à la gare et n’eus plus jamais de ses nouvelles. Vive la République et vive la France. Continue ton chemin, petit soldat.
Katie
Katie m’avait pris en stop sur la nationale vingt. Ça changeait des voyageurs de commerce aux alcoolémies incertaines. Sa voiture était pleine comme un œuf. Elle déménageait. Elle venait de rompre. Elle avait eu du mal à se défaire d’une relation toxique avec un loueur de motoculteurs. Il fallait qu’elle s’éloigne le plus possible. Quand je lui dis que j’allais à Nice, elle avait répondu, parfait. Je me disais que la planète avait encore de beaux restes puisque, malgré le motoculteur qui avait retourné son âme, Katie s’était arrêtée pour me faire monter à son bord.
Katie était pure et belle comme le jour qui se lève. Ses lèvres rose bonbon se dessinaient avec douceur sur sa peau couleur de caramel au lait. Elle avait des mirabelles écrasées dans les cheveux et des coccinelles au fond des yeux. Ses petits seins jouaient à pile ou face sous sa chemisette à fleurs. Elle était fine et vive comme une anguille électrique du bassin de l’Orénoque.
Katie faisait dans l’animation, colonies de vacances et tutti quanti. Elle estimait qu’avec son BAFÀ en poche, l’été lui appartenait. Les beaux jours étaient déjà là, elle n’avait peur de rien. Je lui racontai ma vie de patachon. Elle me dit que j’avais de la chance. Je lui exposai ma théorie selon laquelle il fallait prendre sa retraite avant de travailler. Après il est trop tard. Ça la fit rire.
Chemin faisant, nous avions donné forme à une jeune et belle amitié. Tant et si bien qu’arrivés sur la côte, je lui proposai de partager mon plan qui consisterait à squatter pour la nuit des amis qui habitaient dans le vieux Nice. Après, nous aviserions. Mon hôtesse présumée était professeur de philosophie, lui était plus installateur de cuisines au noir que photographe. Ils avaient deux enfants, un garçon et une fille. Le plan lui parut sans danger, elle accepta, ravie de ne pas avoir à dépenser sa maigre fortune dans une chambre d’hôtel.
Nous galérâmes un peu avant de trouver la bonne porte qui donnait sur un corridor enroulé autour d’un immense patio collectif. Je proposai que Katie dormît sur le canapé du salon et moi sur le sol, à ses pieds, dans mon sac de couchage. Nous décamperions au réveil. Le matin fût un premier matin du monde. Nous prîmes le petit déjeuner sur la terrasse. Les toits orange du vieux Nice déclinaient leurs tuiles canal jusqu’à la mer bleue comme les blés. Nous évitions de nous projeter à plus de dix minutes. Nous devions claquer la porte en partant.
J’avais connu ce couple lors d’un précédent séjour à Nice. La prof de philo tenait bénévolement une permanence à la caisse d’une librairie qui faisait restaurant. J’y étais toujours fourré. Elle bouquinait ou corrigeait des copies. Nous n’avions pas été long à échanger nos points de vue sur les grands et les petits auteurs. L’endroit était aussi le QG d’un club de go. C’est ici que j’avais découvert ce jeu auquel j’avais consacré un nombre d’heures incalculable. Le mari de la prof de philo jouait aussi au go. Nous avions sympathisé. Il m’avait invité chez lui. C’est avec étonnement qu’elle et moi nous retrouvâmes nez à nez dans son salon. Ceux qui les connaissaient mal pensaient que le prof de philo, c’était lui. Il n’avait pas le baccalauréat mais sa curiosité tous azimuts était adossée à une mémoire phénoménale qui lui permettait d’émailler ses propos de références et de citations tant littéraires que cinématographiques. Ça énervait sa femme qui avait fini par s’en amuser. Elle l’aimait à en crever. C’était aussi un épicurien du cul, invétéré et sans vergogne. Dans la journée, il nous avait mis, Katie et moi, en relation avec une collocation susceptible d’accueillir des clodos de notre espèce. Une place allait se libérer, il fallait patienter une semaine. En attendant, nous pourrions dormir dans la chambre d’un locataire qui s’était absenté.
Les autres locataires nous adoptèrent rapidement. Notamment Lívia, une Brésilienne fraîchement débarquée en France. Tout le monde pensait que nous formions un couple, Katie et moi. Afin de ne pas les décevoir, nous avions tenté de nous rapprocher. Son corps était brûlant comme les galets de la baie des Anges. Mais il y avait quelque chose en elle de cassé qu’elle mettrait beaucoup de temps à réparer. Nous avions fait du bruit cette nuit-là pour que chacun pensât que nous étions normaux. Mais après avoir fait semblant de nous émouvoir, elle s’était assise, le drap sur les cuisses et m’avait dit, c’est horrible, il m’a complètement bloquée.
Nous avions, durant la semaine, continué à nous donner la main dans la rue lorsque nous sortions avec nos amis. Je me rappelle ce trottoir en travaux qui se rétrécissait. J’avais pensé, avant de lâcher sa main, que c’était peut-être la dernière fois que je la tenais. Mon présentiment s’était révélé exact. Nous étions soulagés d’avoir mis fin à ce jeu cruel.
C’est dans un restaurant parisien où Lívia travaillait comme serveuse que j’eus, pour la dernière fois, des nouvelles de Katie. Elle était partie aux Etats-Unis pour suivre une formation de pilote d’avion avec promesse d’embauche. Mettre le plus de distance possible entre elle et lui, avais-je pensé. L’intrépide Katie poursuivait son destin, à moins que ce ne fût l’inverse.
Leïla
J’avais été invité au dernier moment à une fête à laquelle ni elle ni moi n’aurions dû nous trouver. J’avais hésité à m’y rendre. Je ne connaîtrais pas grand monde. Mais il était urgent que je fisse de nouvelles rencontres. Alors fissa, je bouclai mes attaches et agrafai mon porte-chance.
Il y avait cette grande fille brune, frisée comme la pluie, qui observait les gens avec un sourire mi-fugue, mi-raison. Elle buvait l’eau des nuits, je buvais l’eau des jours. Je m’approchai. Ceux qui s’apprêtaient à nous présenter n’eurent pas à le faire. Personne ne serait responsable de notre banqueroute.
Elle était violente, dans ses propos et dans ses gestes. Ce n’était pas une écorchée vive mais elle cherchait la confrontation. Sa façon de vous remettre en question sans vous connaître, pouvait expliquer le vide sur lequel se découpait sa haute silhouette. L’amour est un sport de combat, a écrit quelqu’un quelque part. Comme ne le disaient pas encore les émissions de téléréalité, nous prîmes le temps de nous connaître, avant de nous connaître (ça, en revanche, on ne le dit plus).
Pendant l’amour, elle semblait préoccupée, sérieuse, comme si elle en profitait pour penser à des choses désagréables comme les factures d’électricité, les règles en retard ou la gentrification des centres-villes. Elle avait la voix forte, légèrement rauque, mais jamais je ne l’ai entendu émettre le moindre gémissement. Elle n’était pas du genre à flatter votre égo ou à s’encombrer de formules de politesse. Elle se limitait à des effusions de bienvenue exagérées quand elle rencontrait une connaissance, comme s’il s’agissait d’un.e cousin.e qu’elle avait perdu.e de vue, ou comme pour convaincre que la joie occupait son cœur résigné. Puis le soufflet retombait. Elle n’était pas dans la séduction.
Sa crainte du gaspillage (on ne parlait pas encore de bilan carbone) pouvait, lorsque le froid arrivait, la faire passer pour une clocharde. Ça ne la dérangeait pas de porter un jogging sous une robe. Cela n’était pas incompatible avec une hygiène alimentaire qui se traduisait les jours maigres par des diètes. Elle croyait en la possibilité d’un bonheur, surtout chez les autres.
Un matin, je lui avais écrit un poème (cf. Le poème à la fin du récit). Elle l’avait lu, l’avais soigneusement rangé dans une poche. Elle avait dit, c’est beau. À partir de ce moment, c’était comme si j’avais signé avec mon liquide céphalo-rachidien (l’encre invisible de mon âme) le contrat de notre engagement. Elle ne savait pas que la poésie était le seul amour des poètes, qu’entre le parolier et le musicien, il faut toujours choisir le musicien, que seuls les mots triomphent.
Leila avait l’art d’étouffer son prochain. Je n’arrivais pas à m’en défaire. Elle me suivait, me sollicitait, m’asticotait. Elle faisait de mes petites amies ses amies et de ses amies mes petites amies. Je craignais de la rencontrer à tous les coins de rues. Elle avait sympathisé avec mon frère qui était de passage, pour s’introduire chez ma nouvelle amie. Elle m’aimait d’un amour inconditionnel et définitif. Elle fut la seule personne que je giflai durant ma courte vie. C’était un matin, je venais de me réveiller. Elle avait frappé à la porte. Je lavais une chemise rouge dans une bassine pour donner du sens à ma vie. Elle ne voulait pas entendre que je ne l’aimais plus. Elle me faisait toutes sortes de chantages. Elle ne voulait pas sortir de chez moi. Je louais à l’époque l’appartement rudimentaire d’un ami qui avait emménagé avec sa copine pour une période d’essai de six mois. Au mur, il y avait la photo d’un tableau de Félicien Rops représentant une femme nue guidée par un cochon tenu en laisse, gants du soir et bas vintages, grand ruban noir sous thoracique et yeux bandés. L’eau était froide. Excédé, ma main mouillée était partie. Le poème de mes cinq doigts s’était imprimé sur sa joue gauche. Le tribunal en déduira que je suis droitier. Elle n’avait pas réagi, comme si c’était normal. Je compris immédiatement mon erreur. Mon geste était un aveu d’impuissance. Je lisais avec effroi dans ses yeux, une satisfaction démoniaque, voire une forme ultime de plaisir. Mon geste était pour elle, la preuve que je nourrissais à son égard un sentiment incontrôlable et obscur, contre lequel j’étais impuissant.
En remontant mes traces, elle était parvenue à cette ferme-restaurant où j’avais jadis travaillé. Elle y avait séjourné et y avait rencontré ce breton marginal d’une trentaine d’années qui avait le même prénom que moi. Elle l’avait déniaisé et avait passé avec lui le restant de ses jours.
J’ai eu de ses nouvelles, il y a quelques mois. Elle avait été victime d’un ictus. Elle n’a jamais cessé de m’écrire poste restante chez mon père : je reçois une lettre tous les cinq ans.
Le poème
Je vais t’écrire le poème de l’œsophage du pigeon
Un poème qui mêlera le caillou et le grain
J’y recenserai les faunes qui fréquentent les guérets de mon cœur
Je prendrai le temps qu’il faudra pour les apprivoiser quitte à redessiner tous les jardins
Je veux que les chemins de ce poème poussent jusqu’à tes mains leurs troupeaux de bêtes phosphorescentes
On pourra y rencontrer des femmes aux cheveux verts, d’idéales bohèmes, les saisons de l’enfer et de vastes oiseaux des mers à la démarche incertaine
Le fontainier de nos amours doit encore achever le visage lacustre des dernières citées
Je veux à tout prix éviter les grands édifices nostalgiques dont les hommes sont fiers
Les orangeries du songe, les dinanderies de ta vulve et le vaisselier de nos émois sont des métaphores que tu trouveras dans le poème
La nuit et le jour attendront la fin de ce poème pour se rencontrer ailleurs que sur le cercle des aurores
J’ai prévu d’organiser une crémaillère
Je louerai plusieurs clavecins atomiques pour prévenir les mammifères marins
Les fumeurs d’arcs-en-ciel traduiront la pluie dans toutes les langues
Ça sera une fête derrière la paupière transparente de l’anaconda
Les libellules électriques du carbonifère transporteront les invités jusqu’à l’entrée de mon poème
Il y aura du fromage d’orque, des beignets d’orchidée, de la gelée de coccinelle et du sorbet de rossignol
Il y aura des applaudissements dans le théâtre en porcelaine de tes clavicules
Enfin, quand l’aube sera pleine à craquer de tes yeux, je laisserai venir à moi le poème comme une bête nonchalante
Je laisserai sa main immense caresser le ciel comme une mousson oblique
Je laisserai descendre le poème sur la peine des hommes comme une lave lucide
La sirène des pompiers remontera la rue Garibaldi
Dans le pot de géranium la terre sera sèche comme une écaille de tortue
Margot
Leila s’était fait une nouvelle copine. Celle-ci habitait en face de chez-moi, dans une communauté dont je connaissais bien les membres. Perle discrète, Margot avait pris la place d’un peintre hyperréaliste dont le chat n’avait pas fait l’unanimité. Elle nous avait reçue dans la cuisine, la seule pièce commune. Elle savait que nous étions un couple désuni. Pas un mot ne sortait de sa bouche. Ses longs cheveux noirs lui tombaient sur le visage. D’une voix trainante, Leila meublait cette fin de matinée absurde avec des aphorismes enjoués, tandis qu’une araignée invisible tirait déjà ses fils entre le corps sans vie de Margot et le mien. Le présent bouillonnait en silence en essayant d’échapper aux viscosités d’un passé auquel nous aurions voulu donner peu d’importance. Mais tel un rapace affamé, lesté d’une proie trop lourde pour ses jeunes serres, je peinais à prendre mon envol.
Leila avait rendez-vous quelque part avec quelqu’un, elle devait partir. Montre-lui où tu vis, c’est juste en face. Elle me jetait dans les bras de Margot en imaginant qu’ainsi elle se concilierait une sorte de procuration. Elle savait qu’une idylle pouvait naître entre cette fille gothique un peu autiste et moi. Tu veux voir où j’habite ? Pour toute réponse, Margot se leva. En sortant, je lui demandai si elle avait la clef de la coloc. Pour toute réponse, Margot claqua la porte. Son corps souple faisait craquer derrière moi le grand escalier de bois. De l’autre côté de la rue, entre les boiseries grinçantes du vieil Otis, nos corps se touchaient presque. Un long cheveu noir s’était collé sur ma joue. Quelque part dans les étages, un saxophone fissurait l’air déjà brulant qui se refermait en laissant dans nos cerveaux, des copeaux roses.
Je la précédais dans le couloir étroit. La grosse clé força la serrure et la porte s’ouvrit brutalement sur l’exiguïté du local, la tristesse bosselée du crépit, les tomettes disjointes, le matelas sans drap. Je jetai mon sac sur le lit et, en me retournant, reçu ses lèvres sur ma bouche. Sa langue puissante cherchait la mienne derrière le rideau de ses cheveux. Sa taille était fine et ses hanches mobiles. Elle se débarrassa de son t-shirt tout en continuant de coller sa bouche contre la mienne. Elle avait les dents en avant. Elle n’avait rien d’autre à cacher et pas de soutien-gorge. En deux coups de hanches, son jean prit le même chemin. Elle était impatiente de se mettre nue. J’imaginais qu’elle voulait oublier son visage escarpé en bradant son corps alliciant. Ses tennis avaient disparu mais elle avait gardé ses socquettes. Elle ôtât sa petite culotte et s’attaqua à mon pantalon. Elle caressait mes couilles avec ses cheveux et malgré le va-et-vient de ses incisives sur mes corps caverneux, je sentais que je n’allais pas tarder à rejoindre le monde des idées pures de Platon. Je regardais bouger son épine dorsale dans la grande galerie de l’évolution. J’avais envie de la toucher. Je tripotais ses oreilles cartilagineuses derrière ses cheveux. N’y tenant plus, j’arrachai sa bouche de mon sexe et la remontai jusqu’à la mienne pour gouter nos odeurs mêlées. Je me débarrassai complètement de mon pantalon et tirai le matelas sur le sol, fit un lit de fortune avec deux draps propres et nous nous serrâmes l’un contre l’autre jusqu’au soir sans prononcer plus de deux phrases.
Ses cheveux longs et fins me rendaient fou. J’aimais son corps qui réagissait toujours sous ma main hésitante. Elle était capable de rester allongée contre moi pendant des heures, sans dire un mot. Quand je proposais de sortir, d’aller faire un tour, ou faisais mine de me lever, elle s’agrippait à moi en poussant un gémissement derrière ses lèvres closes. Pour combler son manque d’affection, nous passions ensemble toutes nos nuits à la communauté. Nous restions collés l’un à l’autre jusqu’à midi. Elle dormait avec un couteau automatique à cran d’arrêt sous l’oreiller. Treize centimètres d’acier inoxydable prêts à jaillir, planqués derrières nos carotides. C’était son mec qui lui avait donné. Ton mec ? Mon mec. Ça fait combien de temps que tu ne l’as pas vu ? Trois mois. Il est où ? Je ne sais pas. Il est en prison ? Peut-être. Le fait est que, quelques jours plus tard, je croiserais dans l’escalier, un gars presque obèse, à l’âge incertain, le cheveux roux et rare, le regard vide et bleu. Je n’ai jamais su quels rapports ils entretenaient.
Margot faisait des études d’anthropologie à la faculté de Nice. Elle m’avait invité à la suivre, persuadée que ça m’intéresserait. Elle faisait le trajet à pied pour économiser les tickets. Elle marchait devant moi. Pendant une heure et demie, mon regard ne quitta pas ses mollets musclés. Nous prîmes place dans un amphi clairsemé où une pointure livrait aux jeunes cerveaux avides, les clés de la nature humaine. Je n’avais pu m’empêcher d’intervenir pour développer l’hypothèse mimétique. En sortant, Margot m’avait dit qu’ils avaient besoin de gens comme moi. Mais je n’avais pas la volonté requise. Connaissant mon souci du détail et de la perfection, je redoutais de me laisser absorber par cette discipline. Je n’admettais pas qu’une activité, quelle qu’elle fût, pût m’empêcher de rater ma vie comme je l’entendais. Nous devions maintenant nous concentrer sur les six kilomètres de marche qu’il nous restait à parcourir pour rejoindre le vieux port.
Margot arrondissait ses fins de mois en arrondissant son corps devant les objectifs très subjectifs de photographes semi-professionnels. Je trouvais parfois des traces de dakin autour de ses orifices. Le rose lui allait bien. Ça lui donnait l’air d’une squaw sur le chemin de la guerre. Un jour, en revenant d’une séance, elle me racontât qu’une fille plus âgée qu’elle était déjà présente. C’était la première fois qu’elle se mettait nue devant une fille. Au cours de la séance, la fille l’avait masturbée. Elle ne s’était pas démontée et avait masturbé la fille à son tour. À la fin de la séance, le photographe l’avait embrassé sur la bouche en murmurant merci entre chaque baiser.
Margot avait un profil relativement serein qu’elle présentait aux personnes qu’elle côtoyait. Elle dissimulait son profil sauvage et cabossé derrière le rideau de ses cheveux. Jamais je n’avais osé la questionner à ce sujet. L’habitude et l’amour avaient fait en sorte que mon cerveau me renvoyât une image homogène constituée des plus doux morceaux.
Un jour où je croisai mon ami et néanmoins bailleur en bas de chez moi, sans faire étalage d’une originalité prétentieuse je lui demandai comment il allait – je savais qu’il y avait de l’acide hydroxyque dans le méthane de sa relation conjugale et que je n’allais pas tarder à devoir me trouver un nouveau toit – il me répondit, oh, moi, tu sais, tant que je n’en serais pas réduit à sortir avec des filles comme Margot… Je lui avais répondu, alors tu vas mieux que moi. J’avais vu son visage encaisser la révélation des Premiers Analytiques d’Aristote. Promis, je ne savais pas. Comme nous avions ri !
Je ne sais plus comment nous avions mis fin à notre relation, Margot et moi. Il n’était pas question pour nous de rester amis. Il m’arriva, un an plus tard, de la surprendre en bordure du vieux Nice, perdue dans la contemplation de l’étal d’un vendeur d’olives. Je m’étais approché par derrière et l’avais embrassé dans le cou par surprise en priant pour que son couteau fût resté sous son oreiller. Retrouver sa bouche et son odeur m’avait fait monter les larmes aux yeux. Je lui avais offert des olives et nous nous étions fixé un rendez-vous pour le lendemain soir, au niveau du marché aux fleurs, côté mer. Elle était arrivée en s’excusant de n’avoir eu le temps de s’épiler qu’une seule jambe. Je remarquai que c’était celle de son bon profil. Ainsi Margot ne s’offrait jamais tout entière, elle gardait sa zone d’ombre, son mystère, sa blessure qui ne guérissait pas.
Nous étions descendus sur la plage. Je m’étais allongé sur les galets et elle s’était installée sur moi, à califourchon. Sa triple épaisseur de jupons faisait autour ne nous une corolle sulfureuse. Le roulis imperceptible qu’elle imprimait à son bassin, pendant que nous discutions, faisait naître dans l’esprit des gens qui nous observaient à la dérobée, des suppositions révolutionnaires. Elle me proposa de venir voir où elle habitait.
J’aurais dû, comme elle l’avait fait la première fois où elle était montée chez-moi, coller ma bouche contre la sienne, me dévêtir à la hâte et enfouir ma tête sous ses jupes. Je n’avais pas sa liberté. C’est déjà bien de l’avoir imaginé. Elle occupait alors, dans un immeuble du vieux Nice, une chambre d’où l’on pouvait entendre les psalmodies bouddhistes du propriétaire et de ses disciples. Sans doute pour me donner du courage, elle me racontât comment, la semaine précédente, elle avait invité à boire une tisane le gars qui la ramenait de la fac en voiture de temps à autres, comment il l’avait prise brusquement, sans un mot, sur la table, et comment il était parti, toujours sans un mot.
Une tristesse insondable fissurait mon cœur. Je restais sans force. Je lui annonçai que j’allais quitter Nice le lendemain. J’allais construire une maison quelque part en Haute-Vienne, afin de consumer toutes mes économies. J’avais calculé qu’avec cet argent j’aurais pu encore zoner cinq ans, mais je sentais confusément que le temps allait me rattraper avec son cortège de ménades grimaçantes. Il fallait que je quitte ma zone d’inconfort. Adieu Margot.
Nadège
À une époque, je prenais des cours de djembé. Nous étions un petit groupe que je ne fréquentais pas en dehors de ces cours. Je me rappelle le prof, un rondouillard chevelu au sourire moustachu, qui chouchoutait les filles. Il y avait aussi une jeune motarde à la langue bien pentue, étudiante en médecine et mignonne comme un cœur, qui était venue vivre chez sa grand-mère pour se rapprocher de l’université, une fille de la campagne qui faisait ce qu’il faut pour rester en première classe dans le train Corail de la méritocratie. Tout le contraire d’un type que je connaissais bien.
Un jour, elle nous avait prévenus qu’elle avait convaincu sa copine Nadège de venir voir à quoi ressemblait le cours de percussion. Elle pensait que ça pourrait la reconnecter aux énergies fondamentales de Gaïa, notre mère la Terre. Elle nous avait demandé d’être gentil avec elle et avait planté son regard futé dans le mien. Ça sentait le coup arrangé ou je ne m’y connaissais pas. Nadège était de type curvy flava, avec une grosse tête, des grands yeux, une grande bouche et une ribambelle d’à qui mieux mieux. Elle restait sur ses gardes malgré les encouragements du maître de musique.
Nadège était en décrochage scolaire. Elle ne venait pas à bout de sa troisième année de médecine. Son père, proctologue réputé, avait cédé son cabinet à son unique fils qui n’allait pas tarder à trouver la mort dans un accident de moto. Elle avait abandonné dans la foulée ses études de violon. Elle aurait préféré apprendre le piano mais son père, violoniste amateur réputé autant que contrarié, organisait tous les weekends autour de son stradivarius, des quatuors, en compagnie de ses amis musiciens de l’orchestre de l’opéra de Nice qui montaient avec armes et bagages à la somptueuse villa accrochée au flanc du coteau le plus huppé de la ville, aux frais de l’amphitryon. Pour les cinquante ans de mariage de ses parents, l’ami de la famille, Paul Tortelier, avait joué un potpourri des suites pour violoncelle de Jean-Seb. Il avait la même tête que sur la minicassette que j’avais achetée en solde à la fnac, quelques années auparavant. Le père de Nadège me faisait peur. Son crâne rasé, son corps imberbe et ses muscles de culturiste sénior me rappelaient les nazis de certains James Bond. Il m’avait posé deux ou trois questions pour cerner le bonhomme et ne m’avait plus jamais adressé la parole. J’étais à ses yeux une sous-merde. Je ne pouvais pas lui en vouloir.
Nadège était aussi en décrochage affectif. Elle venait de se faire larguer par un étudiant noir pour lequel elle avait eu des sentiments profonds. Une grosse claque. Elle n’était pas encore dépressive mais on ne savait pas trop où elle en était. Aucun projet à l’horizon. Elle vivait de subventions parentales qui semblaient intarissables. Elle se plaisait à raconter qu’elle s’appelait Nadège parce qu’elle était le dernier enfant de la famille, le garçon tant espéré après trois filles consécutives (Nadège vient du russe nadesja qui signifie l’espérance). Un espoir donc, mais un espoir déçu, estampillé comme tel. Aussi, pour ne pas finir dans les ordres, elle s’était appliquée à emprunter les voies du père afin de s’attirer ses grâces. Cette stratégie avait atteint ses limites et Nadège devait maintenant trouver une nouvelle grille affective pour donner du sens au monde et à ses œuvres.
À cette époque, mon bailleur et néanmoins ami me pressait de trouver un nouveau gîte car la femme de sa vie l’avait jeté dehors après un record de six mois de vie commune. Nadège m’ayant proposé de m’héberger en cas de coup dur, je me pointai un soir avec mes sacs de sports à la porte de l’appartement que lui prêtait sa mère, en face de l’opéra où l’on jouait La Chauve-Souris de Johann Strauss fils. Je lui demandai si elle pouvait m’accueillir le temps que je trouve un logement. Elle n’avait a priori pas envisagé un dépannage à durée indéterminée mais elle accepta de bon cœur. Nous essayâmes de baiser, ce soir-là, afin de faire plus ample connaissance. Ce fut un désastre. Ses gros seins gélatineux coulaient le long de ses flancs et mon petit pénis jouait au squash contre les parois de son vagin. Je parvins à éjaculer en imaginant que des pirates nous avaient enchaînés l’un à l’autre et nous fouettaient avec des lanières qui avaient macérées dans de la saumure d’anchois. En ouvrant les yeux, je vis que son visage était baigné de larmes. Elle s’excusa en m’expliquant qu’elle pensait à son amour brisé. Nous étions très mal barrés.
Nadège n’avait pas prévu d’adopter un animal de compagnie mais je savais me faire discret, j’étais drôle, câlin, propre, plutôt mignon, j’avais la peau douce et mon parcours déjanté n’allait pas lui donner des complexes existentiels. Mon séjour allait durer deux ans. Sexuellement je n’y mettais pas beaucoup du mien et il ne se passait pas grand-chose. Pourtant Nadège faisait des efforts. Elle se promenait dans l’appartement, seulement vêtue d’un soutien-gorge qui faisait durcir ses seins XXL, ou d’une simple chemise qu’elle m’empruntait. Elle m’avait même emmené passer un weekend à la montagne, dans le chalet familial, sur les conseils d’une de mes ex qui lui avait assuré que l’altitude réveillait mes ardeurs.
Je ne pense pas l’avoir fait jouir une seule fois en deux ans. Pour autant, nous avions fini par nous aimer, un peu, beaucoup.
Les seules expériences amusantes, nous les eûmes après nous être séparés, à l’occasions de sorties culturelles qu’elle s’offrait en montant à la capitale, vêtue d’une simple robe de coton à rayures rouges très près du corps et d’un cache-lolos à baleines. À contrejour on distinguait le buisson qui prospérait en haut de ses cuisses. Je l’hébergeais et l’accompagnais à travers la ville, de cinémas coquins en parcs propices, d’attouchements furtifs en caresses profondes, sous les yeux des voyeurs occasionnels ou à l’insu des amis qui partageaient nos restaurants. Peut-être que si nous avions commencé notre relation de la sorte, nous serions encore ensemble actuellement.
Aux avant-dernières nouvelles, elle était en couple avec un chef de rang en reconversion et habitait un appartement que lui avaient acheté ses parents, Avenue Jean Médecin.
Elle fut l’avant-dernière fille avec laquelle je couchai. Une sombre histoire de chlamydia avait mis un terme à notre éternité. La dernière fois que je l’ai vue, elle m’avait emprunté de l’argent. Je lui avais demandé de ne jamais me le rendre.
Odile
À l’occasion d’une grande fête de la comédie, organisée par Jacques Weber, le directeur du Théâtre de Nice, je m’étais inscrit à un stage de Commedia dell’arte. Pour une somme modique, l’on pouvait bénéficier d’une formation de deux semaines avec une pointure italienne et rencontrer toute une ribambelle de jeunes esprits déjantés, assoiffés de gloire et de lumière. À l’époque, je prenais aussi des cours de chant avec une mezzo-soprano enceinte qui avait mis un terme à sa brève carrière après avoir épousé un homme d’affaires. Elle me faisait travailler la colonne d’air et sa main posée sur le bas de mon ventre glissait parfois sur mon pubis. Je n’avais alors pas d’autre choix que de mobiliser mes cordes vocales avec un engagement total, pour éviter une érection pédagogique.
Les cours de théâtre étaient variés et intenses. L’objectif était d’apprendre à improviser en s’appuyant sur les personnages de la Commedia dell’arte. À la fin du stage, nous avions donné un spectacle en plein air sur une estrade installée sur la place du marché. On m’avait fait endosser le personnage de Lélio, l’amoureux comblé. J’étais amoureux d’une certaine Colombine, servante de son état, qui me trouvait bien sot et bien compassé, alors qu’Isabella, ma promise, était folle de moi et savait le démontrer. Si mon air timide et emprunté avait eu son franc succès (c’était le seul jeu dont j’étais capable si tant est que ce fût un jeu) ce fut uniquement parce qu’il mettait en valeur l’exubérance d’Isabella, surmaquillée dans une robe à corset bleu et vert, qui tordait sa chevelure en hurlant, Lélio, je t’aime, de sa voix puissante et rauque, m’enlaçant les cuisses de ses bras blancs et potelés en pressant ses seins contre mes genoux.
Ma petite amie, Nadège, avait applaudi la scène qui qui renvoyait à une réalité qu’elle connaissait bien. Elle était toutefois un peu jalouse d’Isabelle qui avait mêlé à ses outrances un peu de la confusion de ses sentiments à mon égard.
Le rôle d’Isabella était en effet tenu par Isabelle, ci-dessus décrite et nommée. Dans la vie de tous les jours, Isabelle était vêtue d’une jupe de cuir et d’un manteau sur mesure, de même matière, qu’elle avait dessinés et confectionnés elle-même. Elle avait les lèvres rouge vermillon et les yeux fardés avec art de poudres vertigineuses. Elle m’avait fait visiter sa double mansarde, m’avait montré son ordinateur, sa machine à coudre et ses créations et m’avait raconté sa vie compte triple. Elle faisait des allers-retours entre Nice, Paris et Berlin. C’était une fille dynamique et généreuse qui vivait toutes ses vies avec passion. Elle ne passait pas inaperçue et, à plus d’un égard, éclipsait ceux qui croisaient sa route.
Mais c’est avec Odile que j’avais passé le plus sombre de mon temps durant ces cours de comédie. Une grande fille brune aux cheveux longs et lisses, au sourire qui balançait entre séduction et ironie. Sa mâchoire carrée et sa voix grave lui donnaient un caractère masculin qui en imposait. Nous avions la même façon d’observer le monde qui s’agitait autour de nous, jouissant de notre maladresse dérisoire et de notre ridicule qui ne tuait que nous.
À la fin du stage, j’avais organisé une soirée chez Nadège qui m’hébergeait depuis plus d’un an. J’avais invité nos amis habituels, les personnes de la troupe dont j’étais proche et notre maître de comédie. Vous ne pouvez pas vous tromper, c’est juste derrière l’opéra, rue Saint-François de Paule. Nadège m’avait prévenu qu’elle arriverait tard dans la soirée. Odile m’avait accompagné pour m’aider à préparer les spaghettis. Elle avait été impressionnée par les volumes de l’appartement et nous nous étions roulé une pelle devant la haute fenêtre qui donnait sur les colonnes de l’opéra. Il neigeait. L’on se serait cru en Russie. Elle avait déclaré que, comme tous les homosexuels, j’embrassais bien. Les gens étaient arrivés par petits groupes. Je m’étais senti obligé de mettre un peu d’ambiance en improvisant un rythme de samba sur mon Djembé. Lívia, une exilée brésilienne, était entrée en transe et avait secoué son corps de rêve. Dans ma vision latérale, je percevais le tremblement de ses cuisses sous la bannière de sa minijupe à motifs ethniques pastels. Les gens discutaient avec animation, j’étais heureux.
Au moment de partir pour rejoindre une réception organisée par les huiles première pression à froid de l’intelligentsia niçoise, le maître de comédie m’avait serré dans ses bras en me disant avec son accent italien qu’il savait que j’étais quelqu’un de bien. Une humiliation à l’italienne, sortie d’une bouche qui se sentait obligée de dire quelque chose de gentil, au risque de tout casser. Je savais qu’il disait cela en dépit de mes piètres performances car il imaginait que j’appartenais à une illustre famille compte tenu du lieu que j’habitais. En somme, je n’étais pas doué pour la comédie mais je trouverais ma voie grâce à mes gènes de bonne famille. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Pour sauver la face et semer le doute dans son esprit, je lui avais dit que je n’étais pas doué pour la comédie, précisément parce que ma vie était une comédie.
Pendant la soirée, Odile avait ramassé la neige qui recouvrait l’appui de fenêtre et avait envoyé des boules dans l’appartement du grand capital. Elle était complètement soule et je n’avais pas essayé de la calmer. Je m’étais contenté de ramasser la neige et de la mettre dans le faitout qui avait servi à cuire les pâtes.
Après le stage, Odile avait réuni autour d’elle une petite bande, dont je faisais partie, pour monter Othello ou le Maure de Venise dont elle avait remplacé intégralement les répliques par des noms trouvés dans le bottin. C’était affreusement compliqué à mémoriser. Nous nous réunissions trois fois par semaine dans un théâtre qu’on nous prêtait. Le projet était parrainé par une amie d’Odile, une metteuse en scène très âgée qui avait eu son heure de gloire. Elle assistait Odile lors des répétitions. Les rôles principaux étaient tenus par une jolie trentenaire et un jeune garçon de vingt-deux ans, très grand. Odile les poussait à se rapprocher toujours davantage, à être naturels, à se laisser aller. Elle filmait certaines séquences afin de les étudier plus tard.
Il s’avéra très rapidement que j’étais incapable d’entrer physiquement dans un personnage. J’avais déjà prévenu Odile qu’elle ne devait pas prendre pour de la provocation ou de la morgue, mon incompétence qui était bien réelle. Elle m’avait rassuré en me demandant de faire confiance à ses qualités de direction d’acteur. Au bout d’une semaine, elle m’avait trouvé un remplaçant pour jouer Iago, en la personne d’un jeune-homme dynamique aux mains moites qui était accompagné dans tous ses déplacements par un vieillard chenu et ringard qui n’avait avec lui aucun lien de parenté, une sorte de mentor qui croyait en son poulain et se couvrait de ridicule en faisait à longueur de temps des jeux de mots archinuls. Sans pour autant trouver d’explication, l’on ne pouvait s’empêcher d’établir un parallélisme entre ce tandem improbable et celui que formait Odile avec sa vieille copine. On avait tous imaginé que celle-ci se rapprocherait du nouveau venu, que la cacochymie opérerait entre les deux canonissimes, mais elle estima qu’il était trop vieux pour elle et fit en sorte qu’il ne l’approchât pas à moins de cinq mètres. Elle avait passé l’âge de se prendre la tête avec des tocards.
Pour que ma joie de vivre et mon humour continuassent à ensemencer la troupe, Odile me chargea de filmer les séances afin qu’elle pût se concentrer sur la direction d’acteur. Ce fut donc avec délectation que je découvris les joies de la prise de vue. Je faisais des gros plans sur la vielle sorcière qui jouait avec son dentier entre deux messes basses, sur les visages inquiets des acteurs qui faisaient semblant de s’embrasser, sur le sourire acharné d’André Dussollier qui déformait le visage un peu sadique d’Odile, quand elle encourageait les bouches des acteurs à se rapprocher davantage, sur les pitreries ridicules de mon remplaçant qui surjouait le rôle à la façon d’un représentant de commerce, pour les besoins de la distanciation brechtienne.
Après les répétitions, nous nous retrouvions parfois chez Isabelle tandis qu’Odile raccompagnait chez elle sa vieille copine. Les deux rôles principaux avaient fini par sortir ensemble, ce qui simplifiait les choses pour tout le monde. Une fois, nous avions invité le représentant de commerce aux mains moites à la condition qu’il laissât son chaperon sur le palier. Il avait pris la direction des festivités en nous offrant un spectacle d’effeuillage. Il s’était retrouvé complètement nu aux pieds d’Isabelle qu’il avait suppliée de lui ordonner ce qu’elle voulait. Elle lui avait demandé de se masturber devant elle mais il avait interprété sa demande comme un manque d’engagement de sa part et avait fini par se rhabiller. J’avais néanmoins été impressionné par la complexité de ce garçon culotté.
Odile m’avait demandé de ne plus filmer sa vieille copine. J’avais espacé mes interventions et, dès lors que les deux acteurs principaux eurent rompu, le projet avait rapidement capoté. Isabelle était retourné vivre à Berlin. J’avais recroisé Odile à quelques temps de là dans une rue de Nice. Elle était enceinte.
Pierrette
Il y avait cette grande fille sportive qui donnait des cours de physique-chimie dans une boîte à Bac. Elle passait de temps en temps à la communauté de la rue Garibaldi. Ce jour-là, elle était accompagnée d’une fille qu’elle avait rencontrée à un stage de danse. Elle essayait de se remettre d’une rupture sentimentale. J’avais constaté qu’elle dépassait d’une tête tous les hommes qu’elle avait fréquentés. J’avais essayé de la consoler en lui apprenant des rudiments de djembé. Je m’étais assis derrière elle, l’avais enveloppée de mes bras grêles et l’avais prise par les poignets afin de guider les mouvements de ses mains sur la peau de chèvre. Tes bras autour de mes épaules, avait-elle dit, ça fait du bien. J’étais gêné car mon cœur tanguait pour l’amie inconnue avec laquelle elle était venue. Cette fille se nommait Pierrette. Son être tout entier semblait s’imprégner des bonnes vibrations que chacun de nous dégageait en cette fin d’automne.
Pierrette aussi était gênée car elle avait immédiatement perçu l’attirance qu’elle exerçait sur moi. Cela ne nous empêcha pas de nous rapprocher et, au terme d’une longue promenade en bord de mer qui s’était prolongée tard dans la nuit, elle m’avait invité à attendre le matin dans son lit, jusqu’à son départ pour Paris, prévu à l’heure où blanchit l’arrière-pays. Jamais je n’avais été autant troublé par une fille. Mi-bohème, mi-sorcière, elle était enveloppée d’une mystérieuse aura qui affolait mes champs magnétiques. Tant et si bien qu’une fois allongé complètement nu à côté d’elle, je fus incapable de bander. J’espère que ce n’est pas de la magie noire ? C’est pas grave, de toutes façons, on est fatigués, avait-elle banalisé. Puis nous nous étions endormis en forme de cuillère.
Elle m’avait assuré que je serais toujours le bienvenu à Paris, dans son modeste appartement de la butte. Deux jours plus tard, j’avais suivi ses petits cailloux et frappai à sa porte. Elle ne m’avait pas sauté au cou mais son sourire accueillant m’avait rassuré. Elle était surprise de me voir si tôt. En vérité, je n’avais pas voulu lui laisser le temps de m’oublier. J’étais le bienvenu mais elle avait pas mal de choses à faire. Je passais donc mes journées à ravitailler son réfrigérateur et à mijoter de bons petits plats. Le soir elle me racontait qu’elle avait passé l’après-midi à boire du champagne avec un ami restaurateur, ou qu’elle avait fait un saut à l’institut de magie sexuelle dont elle était l’une des papesses qui se faisait régulièrement sodomisée par des hordes de satanistes hallucinés. Une autre fois, il était question d’une mission consistant à rechercher un appartement londonien d’exception, pour le compte d’un mystérieux homme de l’ombre. Sans me troubler, j’affectais de trouver tout cela très naturel et me contentais des nuits qu’elle voulait bien m’accorder. À tort ou à raison, j’imaginais plus simplement qu’elle cherchait un homme de pouvoir en mesure de subventionner sa vie occulte.
Dans la rue, tous les hommes se retournaient sur elle en me faisant des clins d’œil que j’ignorais avec prudence, affectant une impassibilité de garde du corps, le regard perdu dans des pensées complexes, pour leur signifier qu’on ne jouait pas dans la même cour, qu’ils n’avaient pas les clés, bref, qu’ils n’avaient aucune chance. Dans le métro, ils s’agglutinaient autour de nous. Nous changions régulièrement de voiture pour retrouver un peu d’air. Dans mes rêves, elle oubliait de s’habiller et se déplaçait avec une tête de chat, parmi des hordes de fantômes.
À l’occasion d’un festival des pratiques spirituelles, elle m’avait fait découvrir le temple des Mille Bouddhas de La Boulaye, dans l’ancien canton d’Issy-l’Évêque du Morvan collinéen, où elle avait ses entrées chez les lamas jusqu’au Rinpoché suprême. Des ateliers nous permettaient de découvrir chaque pratique. Des druides faisaient des câlins aux arbres, des pyrobates avaient organisé une marche sur le feu sous les étoiles rallumées du dévonien. Il y avait des fakirs pour ranger les couverts, des médiums pleins d’esprit, des yogis à mémoire de forme et des récitants de tout poil. Les diseurs de bonne aventure n’arrivaient pas avant dix heures. Chaque nuit, nous faisions illégalement l’amour entre les boiseries d’un grand dortoir inoccupé. Le matin, sur les coups de six heures, le gong nous réveillait et nous courrions à notre séance de méditation qui déclenchait chez moi des érections. Quelques marginaux avaient élu domicile sur le site, dont une ex-junky sans âge qui avait installé sa caravane sous les murs du temple. Elle n’était pas bouddhiste mais elle trouvait l’endroit feng shui. Nous avions sympathisé avec un comptable trentenaire au cheveux ras qui sortait d’une retraite de trois ans. Le reste du temps, je jouais aux échecs avec un jeune Allemand tourmenté, tout en discutant avec sa copine qui avait des cheveux de jais, une peau laiteuse et le cœur spongieux.
Pierrette m’avait présenté son petit frère qui vivait en couple dans un appartement entièrement refait du XVIIe arrondissement, un beau gosse poli et souriant, ravi de me rencontrer. Comme sa sœur, il n’était pas doué pour les études mais il avait des tas de projets. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour mener une vie normale. Leur père était banquier mais ne leur versait soi-disant aucun argent.
Nous avions entretenu un temps une correspondance pendant que je construisais une maison dans le Limousin à deux pas de l’habitation de mon père. Pierrette répondait rarement à mes lettres. Un jour, elle m’avait envoyé Clown d’Henri Michaux, un auteur que je ne connaissais pas. Un jour, un jour peut-être... Je m’étais imaginé qu’elle avait écrit ce poème en pensant à moi. J’étais très impressionné. Je l’avais invitée à venir partager mon boudin aux pommes.
Il y avait un festival de théâtre sur l’Île de Vassivière. Un jour où un metteur en scène homosexuel m’avait demandé de tenir un rôle féminin pour lui donner la réplique, au cours d’une lecture publique, elle avait fait une crise de jalousie. Nous nous baignions dans le lac et faisions sécher nos corps nus au soleil, encerclés par des zombis voyeurs à la peau rose. L’après-midi, quand nous faisions l’amour au bord d’un chemin, elle me demandait d’aller moins vite. Le soir, je la faisais rire. Je croyais qu’elle était la femme de ma vie. Le jour où elle est partie, je l’ai senti impatiente.
J’ai revue Pierrette un an plus tard, pour l’aider à faire son CV. Elle avait fait un stage d’informatique et avait travaillé quelques mois comme coach. Le directeur de l’entreprise avait jugé qu’elle serait plus utile à ce poste qu’à celui d’informaticienne pour lequel elle avait été embauchée. Il la faisait venir dans son bureau où il lui racontait sa vie, ses joies, ses peines et ses déboires. Elle me disait qu’elle travaillait avec des ingénieurs. Ça semblait important pour elle. Je décidai donc de devenir ingénieur et je m’inscrivis au CNAM. Six ans plus tard, j’obtenais mon diplôme. Je ne savais pas ce qu’elle était devenue. Une partie de moi l’attendait jusqu’à la fin de mes jours.
Quentine
En arrivant à Nice pour profiter de mon allocation chômage, j’avais dû m’inscrire à une formation. J’avais le choix entre un Bac de Maintenance des microsystèmes informatiques ou un Bac plus deux en Informatique industrielle. J’avais choisi la maintenance, considérant qu’une activité manuelle aurait la vertu de m’ancrer davantage dans la réalité, si toutefois celle-ci existait. Je craignais qu’une activité industrielle dans le nord du pays risquât de nuire profondément à mon psychisme dont l’équilibre requérait un éclairement que les régions septentrionales n’étaient pas en capacité de lui fournir. Quelques années plus tard, j’achevais le gros œuvre d’une maison que je construisais à côté de celle de mon père, au centre de la diagonale du vide, quand je reçu une convocation qui me donnait rendez-vous la semaine suivante à Mâcon, une ville dont les murs en tuffeau étaient rongés par la maladie des pierres, comme la plupart des agglomérations de province.
J’arrivai bon dernier, sac au dos, le cours avait déjà commencé. Le prof était sympa. Je m’assis à une place libre, au premier rang, à côté du moustachu alcoolique avec lequel j’allais rester en binôme pendant douze mois de théorie des circuits, d’assembleur, de Goupil, de carte mère, d’oscilloscope et de fer à souder. Mon bac scientifique faisait de moi le plus diplômé de la classe mais il s’avéra que je fus le moins efficace dans la pratique alors que le plus nul en théorie s’avéra de très loin le plus efficace dans la détection des pannes et la découverte de leurs origines. Son cothurne disait aussi, à qui voulait l’entendre, qu’il avait un très gros sexe. Le centre de formation occupait une aile d’une manufacture d’armes désaffectée. Je partageais une chambre impossible à chauffer avec deux bretons : l’un, fataliste, ressemblait à Jean Gabin, l’autre, dépressif, ressemblait à Alain Souchon.
Nous étions une quinzaine d’apprenants, hommes et femmes, de vingt à trente ans, célibataires ou en couple, voire mariés, avec ou sans enfants. Tout le monde avait joyeusement régressé au stade de jeune adulte adolescent. Curieusement, peu de couples s’étaient formés. J’avais fini par m’amouracher de Quentine, une brune au corps couvert de tatouages, qui n’avait pas la langue dans sa poche. Pourtant, des traces de timidité la rendait parfois touchante au détour d’un silence ou d’un battement de paupière. Elle était d’une intelligence exceptionnellement vive, capable de résoudre tous les problèmes à la vitesse de la lumière au galop. Je me demandais quelle maladie du sort l’avait empêchée de faire des études. Elle avait choisi la maintenance non par goût mais parce qu’elle habitait dans le coin. Elle avait une petite fille de cinq ans et un mari qui était en prison. Je lui avais écrit une déclaration d’amour sur le tableau, entre midi et deux :
Sous le pont de Fleurville déborde la Saône
J’aime tes yeux noirs qui brillent d’un feu de grange
Tes doigts intelligents et ta moustache jaune
J’aime l’insulte rauque Quentine mon ange
Qui gerce les lèvres bleues de ta bouche immense
Quand sur tes aines fières mes mains se balancent
Elle décolorait sa moustache avec de l’eau oxygénée. Nous nous galochions à qui mieux mieux. Tant et si bien qu’elle avait fini par m’inviter chez elle. Je dormais dans le canapé jusqu’au jour où. Sa voisine, qui avait cinq enfants, ramenait sa fille de l’école et la gardait jusqu’à son retour. Le mari de la voisine était au chômage et il lui manquait plusieurs dents. Un grand type à rouflaquettes un peu dégarni, aux allures félines et aux traits acérés. Assez inquiétant, en vérité. Lorsque nous le rencontrions, nous étions dans l’obligation de goûter au vin blanc qu’il stockait dans un tonnelet en plastique. La discussion effleurait les enfants, le courage de sa femme, les turpitudes des nantis et la révolution qui allait venir. De temps en temps, il nous donnait des champignons. Nous rentrions complètement bourrés nous faire une omelette et des pâtes pour réparer nos estomacs.
Un weekend, elle invita quelques amis de la manufacture pour nous présenter son mari qui était sorti de prison. C’était un jeune homme très beau. Il jouait sur le canapé avec sa fille quand je suis entré dans le salon. Lorsque nous étions à table, au moment du jambon, la petite déclara à la compagnie que sa maman avait un secret. La maman avait répliqué avec sang-froid que si c’était un secret, alors il ne fallait le dire à personne. La petite qui semblait en phase n’avait pas insisté. La Saône débordait entre mes omoplates.
Renée
Dimanche 20 mars, c’était le printemps. Cet après-midi-là, j’avais rendez-vous avec Renée.
On s’était rencontrés après une séance de cinéma. La chambre de mariage. Toutes les femmes et les enfants d’un village tunisien sont rassemblés chez les parents de la future mariée. Ça jacasse, ça plaisante, ça bouge, sourires, mamelles… Une bouteille de gaz explose. Les hommes se retrouvent seuls au village en compagnie de quelques vieilles et de la folle. Les emmerdements viennent juste de commencer.
Après le film, les associations à l’origine de la manifestation avaient laissé l’initiative du débat à un pique-assiette culturel au teint de cigare éteint. Nous nous étions immédiatement retrouvés dans le pôle de la MJC pour tomber d’accord sur les choses de la vie. Puis j’avais suivi Renée dans un café d’un peu avant minuit où elle m’avait offert de partager sa Krique. Je n’aime pas la Krique, trop sucré, mais j’aime partager.
C’était une grande fille unique, un peu à l’étroit au milieu de ses trente-trois balais. L’esprit juvénile, l’œil bleu, le cheveu crépu, médecin à ses heures. Elle m’avait raconté ses exploits, je lui avais raconté mes prouesses. Je suis stagiaire à l’Afpa. C’est bientôt les élections, j’espère décrocher un second stage dans l’informatique. Mais je comptais davantage sur ma petite gueule. Au fond de mes yeux, il y a une étincelle que d’aucuns prennent pour de l’intelligence. Quand je n’ai pas d’opinion sur la question, j’allume les veilleuses et je laisse causer. Je me taille une tranche de paix intérieure pendant que l’autre parle de sa pluie et de son beau temps. Pendant ce temps, le temps avait passé et il avait bientôt été temps de regagner bien tard nos domiciles fixes respectifs.
Son regard franc, légèrement métallisé, son nez qui en veut, son front têtu, dégageaient une impression de force qui contrastait avec la molle structure sous-maxillaire. La chair tirait un peu sur la peau qui plissait au niveau de l’oreille externe. Souvent, le visage dit tout ce qui peut être dit, le reste est écrit ailleurs.
Mais nous n’en étions pas à dévoiler nos charmes. Elle m’avait raccompagné dans sa Fox jusqu’à la manufacture d’armes désaffectées ou m’attendaient deux bretons réciproques. Nous nous reverrions à la réunion bimensuelle de la commission qui avait la responsabilité de la programmation cinématographique, à laquelle Renée m’avait convié. Oui, c’est ça. À la commission.
Il y avait là des gens très petits et d’autres très grands. Mais c’est un détail. Ils discutaient pour savoir s’ils allaient adhérer à un groupement. Perdre un peu de leur « liberté » pour accéder à des films « porteurs ». On me demanda mon avis. Je fus un peu pris au dépourvu. Vite, j’allumai mes feux de détresse et je développai la marinière. Hop, hop. Moi, vous savez, en tant qu’adhérent, je m’inquiète surtout pour la programmation. Si vous êtes sûrs de ne pas faire dans la culotte, je vous laisse carte blanche. Bon bon du bonnet, la séance est levée. Nous allâmes boire un pot avec le directeur de la MJ. Chacun sa caisse, il n’y avait qu’à suivre la voiture de Renée. C’est une meneuse d’hommes, je me dis comme ça, je n’aurais pas beaucoup à me fouler pour trouver le chemin de son lit. Mais au fait : est-ce que j’ai envie de coucher avec elle ? Ce n’est pas certain. L’amour vient en mangeant. À trente-trois ans les femmes ont les cuisses chaudes et les yeux pleins de larmes. De toute façon ça se fera. Elle en a envie et elle a pris les choses en main.
Nous nous assîmes à la même table et partageâmes une Krique plus ou moins une bouteille. Gérard, le directeur, commanda une Leffe. Cela n’apporte pas d’eau à mon moulin à paroles mais on a tendance à oublier que l’eau entre pour 90 % dans la composition de la bière. J’aime bien remettre les choses à leur place.
Gérard avait la Leffe en pente douce. Très vite, il fut question de son dada. Quand venait le week-end, Gérard entassait la famille dans la Rover et roulait vers les Rocheuses. À trente bornes de chez lui, sur les contreforts du massif, tu pouvais t’habiller en cow-boy, t’exercer au maniement du lasso, tirer au pistolet, boire du whisky et te cramer les doigts en retirant de la braise des pommes de terre brûlantes. Tout cela en pleine nature, à l’abri des regards indiscrets. Tu pouvais même monter à cheval à poil si le cœur t’en disait. Ils organisaient des attaques de diligence, construisaient des arcs, des tipis, tannaient le cuir. Parfois ils figuraient dans des films. Que demande le peuple ?
Il aurait bientôt cinquante ans, Gérard. Ça ne le dérangeait pas, pourvu qu’on lui foutu la paix du calumet. Moi, je n’étais pas contre. J’étais mal placé pour remettre en question. Ce n’était pas la place qui manquait à côté de mes pompes et j’étais le premier à en profiter. Ça ne voulait pas dire que je marchais tout le temps à côté, je les aimais bien mes pompes, mais je regardais autour de moi avec circonspection, je faisais le tour de ma question.
Ce fut l’heure pour Gérard de regagner ses pénates emplumées. J’eu une pensée pour mes bretons. Ils devaient dormir à l’heure qu’il était. Avant de partir je leur avais montré comment faire fonctionner mon réveil. D’habitude c’était moi qui gérais. C’est dire combien j’étais sûr de mon coup.
Mais l’affaire n’était pas encore dans le sac. Ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas tenu quelqu’un dans mes bras que j’étais prêt à me passer de Cupidon. Je me disais comme ça que Cupidon ne pouvait décocher qu’une seule flèche à la fois. Si les cœurs étaient suffisamment rapprochés, la flèche pouvait les réunir en les transperçant tous deux de part en part, comme les ballons qui s’agitent derrière les élastiques du stand de tir de la fête foraine. Je me racontais des salades à la Prévert sur les enfants qui s’aiment, mais ce n’était pas gagné. Il demeurait selon moi que le meilleur moyen de faire naître un amour réciproque était de rapprocher les deux cœurs dans l’espace, par exemple en faisant l’amour (on ne saurait mieux dire), en espérant que Cupidon passât à proximité.
Toujours est-il que nous étions en route pour la manufacture d’armes désaffectées que squattait mon centre de formation pour adultes consentants. Pas un chat, même gris. Les feux passaient au vert puis à l’orange puis au rouge, puis recommençaient. C’était rassurant. Un panneau indiquait la direction de l’hôpital. Tu veux aller dormir à l’hôpital ? Tu habites là-bas ? Non non. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Certes, j’avais vendu la mèche. Mais ne m’avait-elle pas tendu la perche ? Par déformation professionnelle, les médecins sont toujours prêts à porter secours à l’accidenté. Maman, les cygnes ont-ils des dents ? Dans l’habitacle, le silence avait le goût du ponch.
La voiture s’arrêta. Je me lançai dans une histoire à la mords-moi-le-nœud pour gagner un peu de temps – ou plutôt pour en perdre (quelle hypocrisie ce lac des cygnes). Est-ce que tu aurais envie de dormir dans une vraie maison ? Je savourai un court instant l’élégance de la métonymie. Allons-y.
La Fox démarra dans un nuage de poussière brune. Renée contre-braqua pour éviter de justesse un dromadaire dont l’œil lippu auscultait la pénombre de son nez ambulacraire. Nous voilà en route pour de nouvelles aventures. Le capitaine hareng fumé et le professeur première pression à froid parviendraient-ils à tirer Lamartintin de la griffe des signes tatoués sur l’avant-bras des rastaquouères ?
Ironie du sort. Elle habitait à cinquante mètres de chez ma vieille copine Quentine avec laquelle j’avais rompu pour des raisons de planning familial. Des coquilles oui mais des coquillettes ! Des hallus oui mais des allumettes. L’ascenseur jusqu’au 7e était un vieil orang-outan sur le point de passer au rouge : pas rassurant. L’intérieur était vaste et charmant, bien rembourré de coussins, de canapé-lit, de sofas, d’affiches et de tableaux. Les baies vitrées étaient immenses, beaucoup de tendresse imprenable sur les lumières de la ville. Tu as faim ? Non. Je lui laissai un peu d’avance en décidant de prendre une douche. Vite fait. D’ailleurs, j’avais déjà fini.
J’arrivai avec mon petit paquet de linge devant la quéquette. Elle était déjà étendue sous la couette. Seigneur Jésus, nous voilà comme au premier jour de la récréation, tous nus dans la cour. Je ne t’ai pas fait le coup de la bouillotte. Je suppose que je dois la remplacer ? Sa peau était douce. Je l’effleurais du bout des doigts. Je n’avais pas encore vu son corps. C’était aussi bien. Elle était bouillante. Ça me faisait bander. C’était bon signe.
Je n’osais pas y mettre trop de mains. Je pensais, les filles bien en chair jouissent à fleur de peau. Elles n’aiment pas être pétries, malaxées, ensalivées. Le gluant les répugne. Elles aiment le sec, le propre, les attouchements, les sujétions, les chinoiseries. Elles fantasment volontiers. Leur jouissance est très sophistiquée et inattendue.
Mes pommettes l’avaient fait craquer. Elle trouvait que mon corps était juvénile. Elle avait oublié tous ces muscles de l’adolescence. Elle pensait que les charnus étaient plus rassurants, plus généreux. Ingénument, elle me confia avoir le sentiment de détourner un mineur. Je ne lui fis pas l’injure de lui assurer que j’avais la même impression, dans l’autre sens. D’ailleurs cela aurait été faux. Lorsqu’elle se troublait, son visage était inondé de jeunesse. Une douceur très neuve. Je remarquai soudain qu’elle avait de profil le même regard et la même bouche que le garçon juif d’Au revoir les enfants.
Elle aurait voulu avoir des seins plus gros. C’est généralement ce dont on parle après l’amour. Après l’amour, est-ce encore l’amour ? Après l’amour, la première fois au moins, les femmes auraient aimé avoir des seins plus gros et les hommes une plus grosse queue. C’est dire à quel point la confiance règne !
Puis elle m’a montré à ses amis médecins. J’ai fait la connaissance des pontes du Mâconnais. Ils me considéraient comme un placebo aux vertus maïeutiques qui ne pouvait être que bénéfique à Renée qui se remettait mal de son divorce. On a fêté ensemble l’amnistie des deux chirurgiens de l’actu. J’ai goûté au Côtes de Toul et aux œufs en meurette. Le soir venu, nous sommes allés voir un film archinul : Les saisons du plaisir de Mocky. Je savais que tout ça finirait cramponné à la tinette. Mais que faire ? Jamais diarrhée ne fut plus pressée de regagner la mer. J’avais avalé une sorte de gel à base de silicone afin de protéger ma paroi stomacale. Cela m’avait permis de ne pas avoir à souffrir de l’acidité gastrique et de pouvoir dormir entre deux séances de tripes.
De son côté, elle s’était réveillée avec la fièvre du dimanche matin. À 10 h 30, au petit déjeuner, le mal était passé. On ne s’aimait plus.
Elle me reprocha l’audace avec laquelle j’avais demandé conseil à l’un de ses collègues chirurgien, à propos d’un kyste séreux dans le gras de ma lèvre inférieure. Je lui avouai ne pas avoir pu résister à la tentation de me rassurer auprès d’un avis compétent.
Peut-être était-elle jalouse du diagnostic de son confrère (elle avait évoqué un simple caillot). Toujours est-il qu’elle me reprochait ma requête. Le temps de l’amertume était venu. Mais ils n’ont pas cessé de parler de médecine ! Oui mais en général, comme on parle de sa profession ! En général ou en généralistes ? Elle avait laissé tomber son scalpel au fond de son regard. Je ne me rends pas compte, je n’ai pas de profession, imagine que tu aies eu un ordinateur et que tu m’aies demandé comment formater ton disque dur, je t’aurais renseignée avec plaisir. Oui, mais les médecins, c’est différent, ils sont hyper sollicités toute la journée, ils sont épuisés, et leurs amis ont tous des problèmes de santé comme tout un chacun, il faut avoir la délicatesse de ne pas les emmerder avec ce genre de question.
Ses yeux étaient comme deux pierres d’azur. Très beaux, très lumineux, très froids. Je lui laissai la partie belle et battis en retraite. Elle cherchait le contact, le combat à mains nues. Je me dérobai. Elle redonna du mou. Note bien que Julien est différent, la médecine, c’est sa vie, il n’aurait pas pu faire autre chose que chirurgien. Et nous étions repartis dans l’éloge triangulaire de Julien. Heureusement que tu ne lui as pas montré ton kyste devant moi, j’aurais été affreusement gênée.
Elle mit le lave-vaisselle en marche. Je révisai mes cours d’informatique. Ce diamanche-là, la Saône était sortie de son lit. Mais que les amours revinssent et nous en reparlerions. Es-tu capable d’avoir des sentiments ? La question sonna clair à mes tympans amicaux. Des sentiments, tu veux dire, l’amitié, l’amour ? Je suis un lâche. Elle me le démontrait. Pourtant, nous avions fait l’amour. On s’était aimé au moins une fois. Était-ce notre faute si nous avions eu pitié l’un de l’autre et si nous avions profité de la pitié de l’autre ? Seigneur, était-ce notre faute si nous nous étions ressemblé ?
Ça faisait une semaine que je ne l’avais pas vue. Ce week-end-là, elle suivait un stage d’analyse de films à Lyon. Je l’avais oubliée à ce point que je n’avais plus peur de la rencontrer de nouveau.
Solange
Je descendais dans le midi à bord de ma GS dorée pour me rendre à un mariage. Ma petite amie était déjà sur place. Nous avions prévu de remonter ensemble et de nous arrêter un jour ou deux chez ma mère, à Orléans. J’avais tout mon temps. Une météo exceptionnellement clémente m’avait permis d’emprunter la route Napoléon. J’avais ramassé une fille en tennis à la sortie de Sisteron. Elle était trop jeune pour faire du stop ou pas assez vieille pour ne pas en faire. Toujours est-il que je m’étais arrêté.
- Vous allez où Mademoiselle ?
- À Digne.
Cette petite robe blanche très décolletée sous la doudoune ouverte sur octobre m’avait pris au dépourvu. Mais il était trop tard, elle était déjà installée à la place du passager. Je vis, mais un peu tard, qu’elle portait des bas de coton. C’était inattendu sur cette route célébrissime qui serpentait entre la roche et la broussaille. J’avais aperçu le haut de sa cuisse quand elle était montée dans la voiture et s’était assise. Le temps qu’elle s’installe correctement et je n’y pensais plus. Elle avait un petit sac à dos vert, très moche, qu’elle avait jeté sur la banquette arrière. Je la trouvais bien hardie. Elle devait avoir dix-neuf ans, sans rien casser.
Elle avait laissé pousser ses cheveux tout l’été. Je ne savais pas pourquoi elle me racontait ça. Le silence devait la mettre mal à l’aise. La route se tortillait à flanc de relief. De place en place, des aires de stationnement avaient été aménagées pour permettre aux touristes d’admirer la Durance. Elle me demanda si je pouvais m’arrêter, elle avait envie de faire pipi. La GS s’immobilisa dans le gravier avec des craquements CSP+.
La fille n’alla pas bien loin. Elle remonta sa robe en laine et s’accroupit à l’abri de la portière grande ouverte. Elle ne portait pas de culotte.
- C’est la couleur de votre voiture qui m’a donné envie de faire pipi.
Je jetai malgré moi un coup d’œil sur le siège du passager pour m’assurer qu’il n’y avait pas de trace d’humidité. J’essayais de ne pas prêter attention au gazouillis du jet contre les nymphes. Je baissai la vitre et le courant d’air porta jusqu’à mes narines, l’odeur azotée de l’urine. J’hésitai à allumer la radio. On ne captait pas grand-chose dans le secteur.
Le chuintement avait cessé depuis quinze bonnes secondes. Je jetai un œil en direction de la vallée. Elle était toujours accroupie à contrejour, la tête inclinée, les yeux mi-clos, la bouche écrasée de bienêtre. Dans ses cheveux, quelques mèches de soleil jouaient avec le vent. Les mains passées derrières les cuisses, elle écartait ses petites lèvres, comme un abdomen de grenouille sur une planche à dissection. Au-dessus du périnée distendu, ourlée d’une sorte de raphé membraneux, la béance de l’orifice vaginal était impressionnante. Les ongles de la main gauche étaient coupés courts, contrairement à ceux de la main droite dont la longueur était le résultat d’un entretient permanent. Je détournai le regard, et lançai un paquet de kleenex à la guitariste.
- Il y a un sac en plastique dans le vide-poche de la portière, pour vos immondices.
Elle revint s’asseoir et agita les doigts devant mon visage avec espièglerie – ceux avec les ongles – en répétant :
- Immondices, immondices.
Je ne sais pas ce qui me pris mais le fait est que je les attrapai et les fourrai dans ma bouche comme un malade mental. Elle me regardait amusée, comme on regarde jouer un chiot. Au moment où mon corps était sur le point de donner le meilleur de lui-même, elle retira prestement sa main avec un petit rire enfantin et stupide. Je remis le contact et nous reprîmes la route.
- Attachez votre ceinture.
L’odeur d’urine qui me restait dans la bouche ne tiendrait jamais jusqu’à Nice.
- Ça m’a donné soif, tout ça, déclara-t-elle.
Je tendis une petite bouteille de Cristaline à ma passagère.
- J’ai bu ma dernière cannette de thé froid en arrivant à Sisteron, m’excusai-je.
Je lui fis signe de garder l’eau minérale.
- C’est parce que j’ai bu à la bouteille, s’enquit-elle naïvement ?
Je préférai ne rien répondre.
- Qu’avez-vous fait de votre guitare ?
Je déposai l’auto-stoppeuse dans le centre-ville. J’attrapai son avant-bras pendant qu’elle récupérait son affreux sac à dos vert et m’excusai pour ce qui s’était passé. Elle me fixa quelques secondes, les yeux mi-clos. En sortant, elle se pencha plus que nécessaire et souleva sa robe pour me montrer ses fesses et son pain aux raisins poilu. La portière claqua et elle écrasa son cul contre la vitre froide. Puis elle partit sans se retourner, en criant :
- Demandez Solange, au Buffet de la gare.
Je n’aime pas les adieux. Mais là, ce n’était pas pareil. Je garderais, dans un coin humide de ma mémoire, le souvenir d’un petit bouton rouge qui ne disparaîtrait jamais tout à fait.
Explication de texte du chapitre Solange
Thérèse
J’aimais, quand elle riait, sa façon d’ouvrir la bouche et de conserver cette expression un court instant lorsque le rire avait cessé, comme si elle attendait quelque chose, comme si l’ivresse d’une première surprise ne devait pas se dissiper. Elle était maigre comme une couleuvre anorexique. Ses cheveux coupés courts découvraient sa nuque sur laquelle je déposais, n’ayons pas peur des mots, des baisers fiévreux. Elle m’avait dit qu’elle n’était pas un cadeau. Nous ne dépassâmes jamais le stade du baiser chaste sur la bouche. Heureusement, elle avait les lèvres gercées. Quelque chose au fond d’elle était verrouillé à double tour. Je m’installais sur son lit, elle se callais entre mes jambes comme dans un fauteuil et je l’enveloppais de mes bras à rallonge.
Nous venions de terminer une formation de programmeur. J’étais stagiaire et j’espérais obtenir une embauche. Elle était à la recherche d’un emploi et passait des entretiens. En attendant, nous étions logés sur une sorte de campus aux portes de Paris, du côté de Montreuil. Il y avait là toutes sortes de gens en cours de réinsertion, dont nous faisions partie.
Au bout de trois semaines, elle m’annonça qu’elle avait réussi un entretien, qu’elle allait commencer à bosser. Elle était très excitée. J’étais content pour elle bien que son enthousiasme me semblât un peu exagéré. Elle trouvait son futur chef génial. Elle avait hâte de travailler avec lui. Sa voix était déformée par l’émotion. Elle faisait peur. Elle m’annonça qu’elle n’allait plus être disponible, qu’elle allait devoir travailler tard. J’étais content qu’elle ait trouvé une bouée de sauvetage mais je craignais qu’elle ne fût broyée par l’organisation toxique de certaines petites et moyennes entreprises. Quoi qu’il en fût, le temps des câlins n’était plus. Je lui souhaitai de réussir et nous nous quittâmes en nous promettant de ne jamais nous revoir.
Ulka
Ulka était indienne, elle avait fui son pays et son père qui la frappait à coups de ceinture. Elle était très féminine, les attaches longues et fines, des hanches larges, les fesses hautes, une cascade de cheveux anthracite et de grands yeux brillants au milieu d’un petit visage presque noir. En attendant de trouver un emploi, nous étions logés sur une sorte de campus aux portes de Paris, du côté de Montreuil. Elle était la plus jeune d’entre nous. Elle avait soif de vie et de contacts. Elle avait suivi une formation d’aide comptable mais elle voulait apprendre à danser, à s’habiller avec goût, à faire l’amour. Je n’étais pas inquiet pour son avenir dans ce beau pays qu’était la France.
J’avais l’habitude de faire un petit tour jusqu’aux immeubles de la cité voisine, le soir, avant d’aller me coucher. Elle avait proposé de m’accompagner. Elle n’osait pas marcher à côté de moi, elle suivait légèrement en arrière, en riant comme une bossue. Il faisait frais, ça sentait la levure de bière. Une usine agroalimentaire devait se trouver dans les parages. Pour canaliser l’excitation de la jeune Ulka, je proposai de faire une pose sur un banc. Il n’y avait pas de crottes de pigeons, il fallait en profiter.
A peine étions-nous assis qu’elle se jeta sur moi, m’embrassant par-ci par-là. Revenant de ma surprise, je pris sa tête entre mes mains et, entre grandes puissances, lui roulai une pelle. Elle dit, moi, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l’obtenir. Elle venait de se faire dépuceler par un jeune maghrébin sympathique et viril avec lequel je discutais parfois, mais je ne savais pas encore qu’il faisait partie de notre histoire.
J’avais invitée Ulka au cinéma. Impossible de me rappeler le film. Sur les Champs-Élysées, les gens me regardaient sévèrement. Nous étions drôlement fagotés. Sa jupe un peu courte sur ses cuisses noires et ses fesses qui montaient jusqu’à ses cheveux, ne passaient pas inaperçues. Il me traversa l’esprit qu’ils la prenaient pour une prostituée. Je m’empressai de l’embrasser pour dissiper de possibles malentendus. Mais il fallait se dépêcher pour ne pas manquer le dernier métro.
Nous passâmes plusieurs weekends dans sa chambre. Elle était inquiète et je n’étais pas un très bon professeur. Tu ne trouves pas que j’ai les hanches trop larges ? Je la rassurais comme je pouvais. C’est vrai qu’elle avait les hanches très larges mais ça ne me dérangeait pas. Un samedi midi, on frappa à la porte. C’était le jeune maghrébin viril. Ulka, je sais que tu es là, il faut qu’on se parle. Sa voix était douce et j’avais la mort dans l’âme. Tels deux primates fautifs, nous convînmes, à grands renfort de gesticulations, de faire la sourde oreille. Le mâle dominant finit par s’éloigner. Redoutant une ruse, nous continuâmes de garder le silence pendant dix bonnes minutes.
C’est par ce type d’homme que je suis attirée physiquement mais vraiment, avec lui, ce n’est pas possible. Il fallait se rendre à l’évidence, mes compétences intellectuelles étaient seules responsables de l’attirance que j’exerçais sur Ulka. Je suppose que trois mois plus tard elle ne m’aurait pas fait une telle déclaration. J’avais bénéficié d’une ingénuité de première pression à froid. Je la quittai. Ce fut ma dernière leçon, hélas. Hélas pour la dernière, hélas pour la leçon. Il paraît que le mensonge et sa petite sœur la dissimulation ont permis aux androïdes d’atteindre le sommet de la chaine alimentaire. On a peut-être l’évolution qu’on mérite mais le monde a la perfection en horreur.
Vania
Voici une lettre à une amie, qui parle de Vania, la Polonaise.
Roman de ma vie,
Je t’écris pour te dire que je viens de faire l’acquisition onéreuse d’un parapluie vert et bleu.
De véritables torrents dévalaient comme cent mulets en chaleur les pentes de la butte Montmartre.
Des torrents d’eau, cela va sans dire, pas de nostalgie.
Ce n’est pourtant pas les laveries et autres matiques qui manquent dans le quartier ! Mais Dieu n’a rien à secouer des machines à tambour lorsqu’il se met à tringler les nuages en jurant à tous les diables !
Tout ça pour dire que la vie est un songe auquel il est impossible, en l’état actuel de nos connaissances, de trouver un sens. Dans le doute, les machines à tambour tournent dans les deux sens.
Toujours est-il que je continue à me chier dans les bottes, en compagnie de compagnons compagnonniques, voire compagnonnesques, sur des programmes que je n’ai pas écrits (j’enrage). À ce propos, je viens de me ramasser une angine pas piquée des anges. Ça passe du nez aux bronches avec une agilité déconcertante, obscurcissant davantage mon esprit saturé d’algorithmie.
À part ça, je visite la capitale en compagnie d’une touriste polonaise. Je n’ai pas encore visité la Polonaise (bien sûr). Elle a vingt-sept ans et je suis prêt à parier rien du tout qu’elle est comme la neige de son pays. Comme toutes les filles des pays de l’Est, elle a du PAP.
C’est une artiste peintre. Capricorne ascendant Verseau. Destin voué à la vie intérieure et à l’épreuve. Le mari en mourant la laissera dans une situation confortable (tu comprends mon hésitation).
Au cinéma, l’autre jour, à la fin de la séance, je lui ai fait remarquer qu’elle avait perdu sa jupe (je te jure). Elle portait une culotte, alors je me suis permis. Sinon, j’aurais détourné le regard et aurais fait semblant de rien. Elle ne serait pas aller bien loin sans s’en apercevoir. Je suppose que la robe s’était dégrafée pendant qu’elle était assise. À moins qu’elle eût oublié qu’elle l’avait dégrafée pendant la séance, pour se mettre à l’aise. Elle m’a tendu sa cigarette et elle a réajusté sa robe avec un flegme très polonais. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça.
Je me suis inscrit au CNAM. Pas de problème.
Vivement dimanche qu’on aille à la messe faire les folles !
Je t’embrasse commère !
À cette époque où on pouvait allumer une clope dans une salle de cinéma, je venais de terminer une formation de programmeur en informatique industrielle. J’effectuais un stage avec promesse d’embauche. J’étais logé provisoirement sur un campus de l’Afpa. Il y avait là toutes sortes de gens abimés, en cours de réinsertion. J’avais sympathisé avec une trentenaire Polonaise rigolote qui faisait dans la comptabilité. Elle m’avait sollicité car j’étais a priori le plus cultivé des fantômes qui hantaient ce lieu de transition. Une de ses amies polonaises était de passage à Paris pour deux semaines. Elle lui avait proposé de l’héberger mais le hasard du calendrier international des Polonaises avait fait en sorte que la venue de son amie coïncidât avec la période de validation de ses acquis. Elle devait bachoter et participer aux épreuves. Elle me missionna pour sortir l’ingénue. Paris by night, les Champs-Élysées, Montmartre, le musée du Louvre et tutti quanti. C’était son premier voyage en France. Elle lui laisserait sa chambre sur le Campus et irait dormir chez un copain.
Vania était grande, blonde, un visage long et pâle, les fesses plates. Elle était habillée simplement, avec des vêtements bon marché. Elle était fière et consciente de sa valeur mais elle n’était pas riche, même si son père occupait un poste important dans une administration gouvernementale. Elle avait fait l’équivalent des Beaux-Arts. Les Polonais n’avaient pas encore répondu à la question « Consentez-vous à l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne ? » Je la mis toute de suite à l’aise, j’étais pauvre et mal fringué, une veste déstructurée par l’usage, dont la texture rappelait celle de certains sacs utilisés dans l’agriculture. Mes chaussures ferrées faisaient trop de bruit. Et j’étais, moi aussi, fier et conscient de ma valeur. J’avais un bac plus deux en informatique. Mon père était artisan pluri-compétent dans la diagonale du vide et ma mère était une brillante cheffe comptable du Gâtinais.
Vania était choquée par le nombre impressionnant de noirs qu’on croisait dans Paris. Ce n’était pas ainsi qu’elle s’était imaginé la capitale du plus beau pays du monde. En Pologne, on haïssait les noirs. C’était ainsi depuis la nuit des temps. Heureusement, ils étaient, là-bas, très peu nombreux. J’avais mis un point d’honneur à lui faire visiter Barbès. Sa blondeur attirait tous les regards. Je partais du principe que son aversion culturelle masquait une attirance naturelle pour les fesses musclées. Je la provoquais gentiment en lui promettant que si elle restait un mois de plus à Paris, elle finirait par sortir avec un noir. Mon insolence la faisait sourire. Son français s’améliorait de jour en jour. Vers la fin de son séjour, elle admit qu’elle s’était habituée à la présence des noirs. J’étais très fier d’elle.
Pour la récompenser, je l’invitai dans un restaurant juif du Marais. Je pensais qu’elle retrouverait certaines spécialités de son pays. Mais quand elle consulta la carte, elle refusa de commander quoi que ce soit. Le prix du moindre plat permettait à un Polonais de manger pendant une semaine. Par respect pour son peuple, elle ne pouvait décemment se livrer à une telle débauche alimentaire. J’étais affreusement gêné. Pris au piège, je commandai une spécialité qu’elle ne voulut pas goûter, je l’avalai et nous prîmes la fuite.
À part ce malheureux couac, j’avais fait en sorte qu’elle reparte avec une idée positive des Français. Par galanterie, je l’avais draguée juste assez pour dorloter son égo, mais point trop afin de préserver la liberté de son regard sur les choses. Il n’était pas question de gâcher ce précieux voyage dont elle attendait beaucoup, avec une amourette qui aurait obscurci son esprit et son parti pris des choses.
Pour me remercier de mon accueil, elle m’avait offert une lithographie de sa composition. Avant de monter dans le métro en direction de Roissy, sous le regard attendri d’un grand noir aux yeux injectés de sang, elle avait déposé sur ma bouche un baiser en forme de papillon.
Wanda
Nous nous croisions de temps en temps autour de la fontaine des Trois Grâces. Toujours, ses yeux étaient maquillés comme jamais. Ses robes en provenance de la galerie des glaces du château de Versailles, faisaient des taches anachroniques dans l’univers en expansion. Elle était comme un oiseau étourdi posé sur une branche trop fine. Un jour où j’étais chez ma mère, elle était passée avec son petit ami en compagnie de mon frère. Nous avions aussi échangé quelques lettres quand je résidais à Nice. Je ne sais plus comment ça avait commencé. Des années plus tard, elle m’avait invité à son anniversaire. Elle était venue m’attendre à la gare en compagnie d’un ami. Elle était intimidée. Nous commençâmes de nous fréquenter.
Elle faisait des études d’architecture. Je l’avais accompagnée à un stage de pastel sur la côte d’opale. Je poursuivais mes études d’informatique au CNAM. J’avais pris un peu de galon. Ça me prenait toutes mes soirées mais j’étais libre les weekends. Je les passais chez-elle, rue du Cocu. J’apportais toujours une bouteille de champagne. C’était le seul moyen que j’avais trouvé pour la mettre en joie. La pièce à vivre était tendue de tulle mauve. La seule fois où nous fîmes l’amour dans cette pièce, j’étais allongé sur le sol, appuyé contre les deux marches qui conduisaient à la cuisine. Elle était à califourchon sur mon érection, ses jupons éparpillés autour d’elle. Soudain, elle s’était excusée en m’inondant d’un liquide transparent. J’avais dit, c’est pas grave. Ça ne sentait pas l’urine.
La nuit, sa chatte rousse se glissait sous les draps, entre nos corps nus. Elle avait rapporté le chaton presque mort, d’un voyage en bateau aux îles Samoa, et l’avait appelé Sogigata (le baiser du serpent). L’animal avait survécu mais était extrêmement irritable. Je l’avais vu bondir à la tête du chien loup de sa meilleure amie avec une rage peu commune. Il s’en était fallu de peu que le pauvre chien ne perdît la vue. Il m’avait fallu des mois pour l’apprivoiser. Elle s’installait sur mes genoux mais je n’avais pas le droit de la toucher. Elle savait qu’elle pouvait compter sur moi pour que cette règle fût respectée à la lettre. Elle avait été un excellent professeur. Sévère mais juste. Je n’avais plus peur de me réveiller châtré. J’appelais même Wanda, mon petit chat. Sogigata restait cependant un excellent moyen de contraception.
Nous passions parfois chez ses parents. Wanda et son frère s’adoraient. Il voulait faire du cinéma. Il avait décroché un second rôle dans un film de Louis Chapelière. Sa mère était mince, souriante, inquiète, fragile. Son mari l’adorait mais ce n’était a priori pas tous les jours la Saint Jean-François Régis. Je le voyais s’abrutir de bière au fur et à mesure que la soirée avançait et que s’éloignait l’éventualité d’une conciliation. Il multipliait les devis mais sa femme n’était pas du genre à signer les yeux fermés. Ni ouverts d’ailleurs. Elle n’avait pas besoin d’un chat hystérique pour tenir les hommes à distance.
Fut un temps, Wanda passait certaines nuits de la semaine dans mon studio d’altitude, aux Lilas. Nous avions installé un rideau épais qui coupait la pièce par le milieu pour qu’elle puisse travailler sur ses projets, tard dans la nuit, pendant que je dormais. Le rideau passait au milieu du lit. Mes érections nocturnes lui tenaient compagnie. Elle n’a jamais abusé de la situation.
Un été, elle était descendue dans le midi pour participer à un stage de restauration de monuments anciens. Ça n’allait plus très fort entre nous. Son statut d’élève en architecture lui conférait un statut plus plus qui avait attiré l’attention du maître d’œuvre, un homme marié aux allures de templier (tonsuré, cheveux longs, moustache tombante). Comme tous les templiers, il adorait sa femme. Ça s’était terminé dans la tente du bâtisseur. Je venais de rencontrer ma future épouse. N’ayant pas de nouvelles, j’avais loué une voiture rouge et m’étais engagé à cœur perdu sur l’autoroute du soleil.
J’arrivai dans une sorte de camp de vacances pour étudiants. De jeunes recrues apitoyées me lançaient des regards tristes et murmuraient entre elles en faisant des signes mystérieux. Le lendemain je remontai sur Paris. Nous avions fait le point affectueusement avant de nous quitter pour toujours. Elle portait une jupe que je lui avais offerte, ses cuisses étaient bronzées.
Xuân
A cette époque, je passais toutes mes soirées au CNAM, 292 rue Saint Martin. Cette institution, qui n’est pas un club échangiste, s’inscrit dans la longue tradition du partage (connaissances et entraide), sous la bénédiction de Saint Martin qui, comme chacun sait depuis qu’on en fit la promotion au Ve siècle, partagea sa chlamyde – ou tout du moins la doublure de son manteau militaire – avec un gueux qui se les pelait. La relique (la cape) fut conservée dans ce qu’on appellera dorénavant une chapelle (plaisir de l’étymologie). Je profite de cette disgression culturelle pour vous inciter à ne pas confondre le partage de la chlamyde et le partage de la chlamydia. La forme infectieuse de la chlamydia est dotée d’une enveloppe très épaisse, d’où son nom. Si elle n’est pas traitée à temps au moyen d’antibiotiques, cette saloperie transmise à l’homme par l’homme (MST) ou par des oiseaux de mauvais augure, peut être à l’origine de lésions cornéennes, de stérilité, de grossesse extra-utérine, de fausse couche, de pneumonie (version ornithologique) et de cancer (MPG 2014). Le moindre picotement doit vous rendre mort de trouille. Hasard de l’étymologie, chaque dossier d’inscription au CNAM doit contenir un certificat de non-contamination par la chlamydia (fake news or not fake news ?). Nous ne reparlerons plus de la chlamydia mais vous avez les bases. Comme dit Christophe Dechavanne en fin d’émission (spermatique) : « Sortez couverts ! ». Et évitez, je vous en conjure, de vous baigner dans le canal Saint-Martin. Mais revenons à ces soirées studieuses qui m’ont occupé durant cinq ans, du lundi au vendredi.
J’avais croisé plusieurs fois deux sœurs vietnamiennes dans les couloirs du CNAM. Nous suivions à l’époque le même cours de math info (mathématique pour l’informatique). Dans l’amphi, j’étais toujours fourré avec une certaine Nathalie de petite taille. J’aimais ses longs cheveux blonds et lisses, ses jeans déchirés, sa voix légèrement rauque, son rire éclatant et soudain, et la lumière de ses yeux turquoise dans son visage d’une pâleur botticellienne tirant parfois sur le rose. Elle avait une sœur jumelle qui, était-ce possible, la surpassait en beauté. Beaucoup les confondaient. Personnellement, je leur trouvais de nombreuses différences. Les énumérer ici ne nous mènerait nulle part.
Xuân, sa sœur et moi suivions le TP d’Arsencio, un génie des mathématiques chevelu, au nez immense. Mince, le visage ravagé par les psychothérapies et le tabac, il chaussait du quarante-cinq et aimait les arsencionettes pleines d’avenir. Nous discutions souvent avec lui après le cours. Les élèves l’adoraient. J’arrivais souvent en retard à son TP mais j’avais repéré qu’il y avait toujours une place libre au premier rang, à côté de Xuân. Elle y posait son sac afin que personne ne s’assît à côté d’elle. Je me présentais avec mes chaussures ferrées et mon jean de trois semaines et forçait le barrage. J’apprendrais plus tard qu’elle prenait cette précaution, non pas pour m’être agréable, mais parce qu’elle redoutait les odeurs d’oignon et de charcuterie des Français.
Parfois je lui empruntais un bic sans sommation. Je voyais bien que je la choquais et je m’en réjouissais. Cependant, elle avait remarqué mon écriture de fille et l’usage immodéré que je faisais du 4 couleurs. Elle en avait déduit que j’étais un bon élève et potentiellement une aide précieuse. Un jour, elle m’avait caressé l’avant-bras en disant que j’avais les mêmes avant-bras que son frère. J’avais mis ce comportement étrange sur le compte de la culture asiatique que je ne connaissais ni de lèvre ni de dent. Un jour, les deux sœurs désertèrent le TP d’Arsencio… Le CNAM était plein de gens imprévisibles.
Quelques semaines plus tard, je les croisai devant le mk2 Beaubourg, rue Rambuteau. Je les avais vues arriver et avais pris soin de tourner la tête sur le côté afin qu’elles ne me reconnussent pas. Le stratagème semblait avoir fonctionné quand j’entendis derrière-moi une voix de débile mentale qui hurlait mon prénom. Xuân m’avait reconnu. Beau joueur, je les invitai à prendre un verre à la terrasse d’un café de la place Beaubourg. Xuân prit un Coca et sa sœur un jus d’orange. Sa sœur, dont le français était plus fluide, menait la discussion. Je leur avais demandé quel était leur rêve, à ce moment précis. Xuân rêvait de posséder une maison et sa sœur voulait voyager. Le jus d’orange, les voyages, les cheveux bouclés, la silhouette élancée, les traits saillants accaparaient mon attention pendant que le regard de Xuân se laissait envahir par des nuées d’oiseaux blessés. Soudain, pariant sur son mauvais français, je me penchai vers Xuân et murmurai à son oreille, tu es amoureuse de moi, n’est-ce pas ? Elle fit la sourde oreille et me parla de ses difficultés en math. Sachant que j’allais bientôt déménager, je lui offris mes services au cas où elle aurait besoin d’un soutien scolaire. Je lui laissai mon numéro de téléphone et mon adresse, en oubliant de mentionner mon nom.
Xuân réussit de justesse son partiel de math et souhaita m’informer qu’elle n’aurait pas besoin de mes services pour le rattrapage de septembre et que je pouvais partir en vacances sans attendre. Entre temps, j’avais déménagé. Elle obtint mon nom auprès de Nathalie. Elle se rendit à mon ancienne adresse à laquelle le concierge lui conseilla d’écrire, supposant que j’avais mis en place un transfert. Je reçu une lettre de remerciement à laquelle je ne jugeai pas nécessaire de répondre. N’obtenant pas de réponse et craignant que sa lettre ne fût égarée, Xuân obtint mon nouveau numéro de téléphone grâce à un employé de La Poste qui le trouva sur le Minitel.
Je reconnu immédiatement sa voix. Je lui proposai de m’accompagner à la piscine Georges Vallerey pour voir à quoi ressemblait une asiatique en mayo de bain. Ensuite, nous irions au cinéma. À ma grande surprise, elle accepta. Elle était arrivée avec une heure d’avance. Elle claquait des dents dans son mayo de bain une pièce, ses lèvres étaient bleues et elle ne savait pas nager. Au moment de quitter l’établissement, à la fin de mes ablutions, j’avais failli partir sans l’attendre tant elle avait mis de temps à se doucher et se rhabiller. J’apprendrais trente ans plus tard qu’elle était restée longtemps sous la douche pour se réchauffer.
Elle avait fini par sortir de sa coquille Saint-Jacques. J’étais furieux mais je la vis pour la première fois. Ses seins se baladaient librement sous une robe d’été à bretelles bon marché en coton mélangé d’élasthanne. Quand elle riait, elle me maintenait devant elle à distance, bras tendus, pour que je ne vois pas ses dents de pays non aligné. La peau de ses bras nus était douce et fraîche comme un début de printemps. C’est à ce moment précis que je tombai amoureux d’elle. Nous allâmes dîner au Bol en bois, un restaurant macrobiotique de la rue Pascal (encore un mathématicien philosophe). Puis, avant de l’épouser, je l’emmenai voir La Loi du désir de Pedro Almodóvar afin de vérifier si nous étions faits culturellement l’un pour l’autre : « C’est le film-clef de ma vie et de ma carrière. Il montre ma vision du désir, quelque chose de très dur et de très humain. Je veux dire par là la nécessité absolue d’être désiré et le fait qu’il soit rare que deux désirs se rencontrent et correspondent. »
Y a-t-il un homosexuel derrière l’écran ?
Je n’ai jamais eu d’expérience homosexuelle durant ma courte vie. Il n’y a pas lieu de s’en attrister. Cela dit, quand j’étais petit, j’aimais ma mère, mon père, ma maîtresse et un camarade plus jeune que moi. En ce temps-là, l’amour ne faisait pas la différence entre l’admiration, l’affection, l’amitié… Dans mon cerveau, la levée de l’inhibition centrale de la sécrétion de GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) s’accompagna d’une obsession de plus en plus marquée pour les jeunes femelles de mon espèce. Je pris conscience assez tard qu’il existait des homosexuels. Je suis donc bien placé pour en parler.
Le premier homosexuel que je rencontrai s’était arrêté pour me prendre en stop. A cette époque je rentrais chez mes parents tous les weekends après avoir passé le restant de la semaine à user mes neurones sur les bancs de l’université. Parfois j’avais de la chance, d’autres fois non. Heureusement, mes horaires coïncidaient souvent avec ceux d’un homobiliste qui ressemblait au colonel Olrik, l’ennemi juré de Blake et Mortimer, la quarantaine, la mèche hitlérienne et la moustache Dalinienne. La main posée sur mon genou, il m’expliquait que tous les grands hommes avaient été homosexuels. Le grand César, Richard Cœur de Lionne, l’illustre Napoléon en personne, Isaac Newton dont le cerveau était paraît-il le plus volumineux au monde, Tchaïkovski et son Casse-Noisette, Léonard de Vinci qui fit le portrait de son amant déguisé en femme… Et Olrik. Olrik ? Le méchant dans Blake et Mortimer. Peut-être, mais attention, tous les méchants ne sont pas homosexuels. Et vice versa. Et vice versa.
J’avais pris l’habitude de mettre mes affaires dans un carton que je posais sur mes genoux afin d’élever une muraille de protection contre la main baladeuse de l’érudit. Il avait fini par se convaincre que je n’étais pas consentant. Il ne m’avait pas tenu rigueur de mes basses manœuvres et avait apprécié que je continuasse de monter dans sa voiture malgré tout. De mon côté je remerciais Hermès (qui d’autre ?) d’avoir peuplé la terre d’hommes homosexuels pour venir en aide aux voyageurs en difficulté.
Je rencontrai un second homosexuel dans un train, entre Rome et Grosseto. L’été hachurait le compartiment de ses encrages fuligineux. Il me faisait face. Il avait les yeux verts. Son visage bronzé au second degré dévoilait ses dents trop blanches. Son vieux français valait mon jeune italien. Après s’être intéressé au livre que je lisais, il avait craché le morceau avec une sorte de jubilation articulatoire : je suis le professeur de grec et de latin. J’avais suivi une initiation au latin en classe de cinquième. C’était aussi l’année où j’avais vu une chatte pour la première fois. Je pensais à l’époque que ma vie pouvait prendre fin, je n’avais plus rien à regretter. Le latin m’avait appris que les roses pouvaient se décliner de multiples façons. Tel un petit prince qui allait de château en château, je n’étais alors qu’un apprenti rhodologue. J’avais depuis fait quelques progrès mais j’étais encore en phase de découverte et l’homosexualité n’était pour moi qu’une autre façon de glorifier la femme. Je restais donc avenant et soucieux d’en apprendre davantage sur le monde protéiforme qui s’offrait à moi. Quand ce n’était pas pour de l’opportunisme, cette ouverture d’esprit pouvait être prise pour un consentement et me mettre dans des situations délicates. Le professeur de latin voulait savoir ce qui m’amenait en Italie, quels endroits j’avais prévu de visiter. Pour qu’il ne se fasse pas des idées, je lui avais répondu que mon objectif était de rejoindre ma petite amie qui travaillait dans le royaume normand de Sicile, au Club Med de Cefalù. À la station suivante, quand le train s’arrêta, le professeur se leva, marcha jusqu’à la porte, se retourna brusquement et me dit, André, tu as de très beaux yeux, puis il disparut, happé par la canicule qui s’engouffrait dans les wagons en même temps que l’odeur sucrée des aloès.
Le troisième homosexuel que j’allais rencontrer ne se trouvait pas très loin. J’avais poursuivi mon périple en faisant de l’autostop. Les trains étaient couteux, d’une lenteur désespérante et la chaleur qui y régnait aurait pu tuer un tardigrade malgré les tunnels nombreux et la proximité de la mer. Une vespa s’était arrêtée à une trentaine de mètres. Le garçon semblait réorganiser ses bagages. Il m’avait fait signe d’approcher. D’autorité il avait entrepris de fixer mon sac à armature sur l’extension de son porte bagages qui n’avait pas résisté. J’étais gêné mais il ne se démonta pas et trouva une solution pour consolider l’ensemble à grand renfort de cordages. Je ne sais plus si nous portions des casques. Nous nous arrêtions toutes les deux heures pour faire de l’essence ou simplement nous dégourdir. J’avais les fesses en marmelade. C’était la première fois que je parcourais autant de kilomètres sur un deux roues. Le soir nous bivouaquions au bord de la route. Mon compagnon n’était pas de nature inquiète. Il était beau, musclé, bronzé, pas très grand, souriant. Un après-midi, il s’était arrêté pour organiser une pause coquine. Entre deux rangs de ceps, il avait étendu en pleine vigne une couverture bariolée au centre de laquelle il avait disposé du raisin dans une corbeille en osier. Seulement vêtu d’un short, il s’était allongé sur un coude tel un dignitaire romain et m’avait invité à le rejoindre. Je n’en croyais pas mes yeux. Je ne touchai pas au raisin de peur qu’il interprétât mon geste comme un assentiment. Je voyais d’un mauvais œil ce contretemps. Il finit par laisser tomber et nous continuâmes notre voyage en direction du sud. Il me proposa de prendre le guidon pour pouvoir souffler un peu. Le fait que je n’avais jamais conduit ce genre de petit bolide n’était pas un obstacle, il m’apprendrait. Et nous voilà repartis, lui derrière et moi devant. Je ne boudais pas mon plaisir de conduire le scooter mais je ne fus pas long à en connaître le prix. Ses mains, qu’il avait posé sur mes hanches, glissaient imperceptiblement en direction de mon sexe qui se rétrécissait jusqu’à devenir un simple résidu de peau, posé sur mes deux couilles. Mais de couilles il était toujours question et je sentais maintenant ses doigts de promener sur mes cuisses. Je m’arrêtai en catastrophe sur le bas-côté pour opérer un changement de conducteur en bonne et due forme. Sans m’en tenir rigueur, il me fit visiter Naples dont il était originaire. Nous parcourûmes un dédale de ruelles où des enfants enguenillés aux joues creuses nous regardaient comme des chats sauvages, les pupilles dilatées par un appétit féroce. Il me déposa au sud de la ville et s’en retourna en levant le bras en signe d’adieu. Je n’étais pas mécontent de retrouver l’herbe poussiéreuse des talus, le cul en compote mais indemne.
Le quatrième homosexuel m’avait pris en stop au niveau de l’obélisque de Fontainebleau. Une voiture de luxe avec un petit chien de luxe qui pleurait sur la banquette arrière, asphyxié par le parfum de luxe qui saturait l’habitacle. Le jeune-homme portait des vêtements de luxe et différents accessoires en métaux précieux, collier, chevalière, gourmette. Ses ongles étaient manucurés de frais et la couleur de ses cheveux n’était pas naturelle. Il s’exprimait avec des phrases sobres. Alors que nous descendions la nationale 7 en direction du sud, il m’avertit qu’on allait passer devant son lieu de travail. Je lui demandais s’il travaillait dans les eaux et forêts. Non, pas vraiment. Tiens, voilà un collègue. Une prostituée sortait d’un chemin de traverse en évitant les flaques d’eau de sa démarche chaloupée. Je finis par comprendre que mon bienfaiteur n’était pas en tenu de travail. Je profitai de l’occasion qui m’était offerte pour lui poser toutes sortes de questions auxquelles il me répondit avec la précision d’un grand professionnel : combien d’heure travaillez-vous par semaine ? Comment ça se passe pour les déclarations de revenu ? Changez-vous souvent d’endroit ? Avez-vous des clients réguliers ? Comment ça se passe avec la concurrence ? Est-ce un métier dangereux ? Est-ce qu’on gagne bien sa vie ? Que faites-vous du petit chien pendant que vous travaillez ? La nature de nos échanges avait créé entre nous une sorte de complicité éphémère. Il avait fait un détour de quelques kilomètres pour me déposer devant chez mes parents. Avant de repartir, il m’avait proposé sur le ton de la plaisanterie de revenir cette nuit pour me sucer. J’avais répondu que ça ne serait pas possible.
Je rencontrai un cinquième homosexuel dans le supermarché où je faisais parfois mes courses après ma journée de travail. J’hésitais devant une paire de gants qui a priori ne me convenait pas. Un petit homme de type méditerranéen s’était approché de moi avec l’intention de me conseiller. De quoi se mêlait-il celui-là ? Ses arguments me laissèrent croire qu’il travaillait dans le magasin. Aucun vêtement ou insigne n’attestait qu’il fît partie du personnel. J’en déduisis que c’était un surveillant en civil et il dû lire dans mes yeux une colère qu’il attribua peut-être au fait que je ne trouvais pas ce que je cherchais. Il me souhaita une bonne continuation et me donna, du dos de la main, une claque amicale sur le ventre. Le salaud ! Il a voulu vérifier que je n’avais pas dérobé un article que j’aurais caché sous mon T-shirt ! Le gérant avait dû le mettre sur mes traces compte tenu que j’avais déjà été mis en cause dans ce magasin. En effet, un jour où je manquais cruellement de confiance en moi et que le ciel bas et lourd me comprimait la dure-mère, après avoir récupéré dans ma 4L de service un vieux bouquin qui trainait et une paire de Pataugas moisies, j’étais passé au supermarché pour acheter cinq cents grammes de fromage blanc, bien décidé à ne pas en rester là. Le crottin de Chavignol me faisait envie mais je trouvais son prix excessif. J’avais longtemps hésité avant de prendre le crottin et de m’isoler dans un rayon tranquille où j’avais enfoui le larcin au fond de ma poche de jean pour m’en faire une couille de rechange. Je devais me convaincre que la force était avec moi, que le monde m’avait à la bonne. Mes allées et venues hésitantes avaient mis tous les stands en alerte. Le charcutier s’était coupé un doigt, le fromager s’était enduit le visage de cancoillotte et le responsable en blouse blanche que je retrouverais à la sortie avait risqué le lumbago en laissant trainer au carrefour de deux allées sa tête derrière lui, comme une panthère rose en goguette. Je n’avais pas de plan précis mais j’étais persuadé que ma lucidité constituait un avantage décisif sur ces gens qui projetaient de me confondre. En arrivant au niveau des caisses, je m’aperçus que le personnel au complet était sur le pied de guerre. Les caissières surexcitées se tordaient sur leur siège en gloussant. C’était la fin de la journée, le magasin allait bientôt fermer. Je pouvais concevoir qu’après une journée à faire biper des denrées sous cellophane, l’on pouvait se réjouir d’assister en direct à la capture d’un délinquant. Je pris ma place dans une file, derrière un vieil homme. Le responsable en blouse blanche l’aidait d’un air affable à mettre ses achats dans un sac en forme de méduse. Je n’avais qu’un article et je savais que la caissière souriante me proposait un sac avec insistance car il était important de séparer le monde légal situé à l’intérieur du sac, du monde illégal situé à l’extérieur du sac. Toutes les caisses s’étaient arrêtées de biper. Le responsable en blouse blanche se mit en travers de ma route et prononça d’une voix inaudible des mots confus où il était question d’un crottin de Chavignol. Inquiet pour sa santé mentale, je le regardais avec des yeux ronds en le tenant à distance avec mon bouquin sur lequel étaient posées mes Pataugas puantes. Incertain du tour qu’allait prendre mon aventure, je chancelai et l’une des chaussures chut. Traversé par un éclair de génie, l’homme en blouse blanche se jeta sur la pompe, persuadé que le crottin était caché à l’intérieur et que je tentais une diversion. Il plongea sa main au fond de la godasse, se releva, me la tendit. Je lui présentai le livre pour qu’il replaçât sa prise à côté de sa sœur sans que j’eusse à toucher l’objet putride et je le remerciai pour son sens aiguë de la relation client. L’éclat de rire des caissières sonna la fin des investigations. La blouse blanche s’effaça et je pris la fuite d’un pas mesuré en veillant à l’équilibre de mon fragile équipage. J’avais restauré ma foi dans le monde au centre duquel je me trouvais. Vous comprenez qu’avec un tel passif, je regardasse le méridional au dos de la main familier avec circonspection. Quelques jours après avoir rencontré mon contrôleur présumé, je le revis en passant devant chez lui alors que je me rendais à une répétition. Je le reconnu, il me salua d’un air enjoué et comme nous manquions de regards externes, je le provoquais gentiment en lui proposant de nous accompagner. Il s’empressa d’accepter. C’est ainsi que, sur un malentendu, naquit entre nous une amitié étrange. Il avait deux fois mon âge et portait un postiche. Il s’incrustait à toutes mes fêtes, me suivait dans certains de mes déplacements et trouvais que j’avais trop de copines. Il m’avait fait découvrir la Provence, les olives et ses vieux amis. Je lui rappelais des jours heureux qu’il avait vécu jadis en compagnie d’un jeune homme qui avait les mêmes goûts que lui. C’était un séparatiste corse, cuisinier de formation, reconverti dans le tiercé et peintre amateur spécialisé dans les tableaux pornographiques. Un beauf sensationnel et généreux qui ne se déplaçait qu’en DS. Il vivait de minimas sociaux et habitait chez une vieille femme qu’il chérissait comme sa mère, en compagnie d’un berger allemand nommé Sultan qui me terrorisait, de ces sortes de bêtes qu’on ne rencontre que dans les casses et les garages. La dernière fois que je le vis, j’étais de passage dans une ville de province à la terrasse d’un café en compagnie de mon frère. Nous évoquions le bon vieux temps et le Corse fut rappelé à notre mémoire avec des mots moqueurs. Le hasard fit qu’il se trouvait à soixante-dix kilomètres de son domicile mais à quelques mètres de notre table, en compagnie de sa vieille logeuse qu’il avait emmenée faire un tour en DS. Il nous avait probablement entendu mais il n’en laissa rien paraître quand nous les avions rejoints pour agrandir la tablée.
Plus tard, mes relations, privées ou professionnelles, avec des homosexuels, n’auraient pas la saveur de ces premières rencontres. La banalisation des relations et l’âge adulte auraient raison de ce parfum d’étrangeté qui auréolait mes premières découvertes.
Zutisme
Néologisme auquel je donne ici le sens d’intertextualité parodique. Des parodies ou des références pas toujours explicites aux œuvres ci-dessous se retrouvent dans les textes.
Wikipédia nous dit que le Cercle des poètes zutiques (dit aussi Les Zutistes) était un groupe informel de poètes, peintres et musiciens français qui se réunissait à l’Hôtel des Étrangers, à l’angle de la rue Racine et de la rue de l’École-de-Médecine, à Paris, à partir de septembre 1871. Charles Cros, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine en firent partie. L’Album zutique, était son livre de bord.
Andrée
- Ma bohème (poésie 1870) Arthur RIMBAUD :
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées ! - Stupeur et tremblements (roman 1999) Amélie NOTHOMB
- Le facteur sonne toujours deux fois (film 1981) Bob RAFELSON (roman de James M. CAIN)
Émilie
- Bréviaire des échecs (1934) Xavier TARTAKOVER
- L’Après-midi d’un faune (églogue 1876) de Stéphane MALLARMÉ (illustrations d’Édouard Manet) dont voici le début (de l’après-midi) :
Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
Marie
- Pride and Prejudice (Orgueil et Préjugés) (roman 1813) Jane AUSTEN :
Lydia, ma chérie, je suis sûre que Mr Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune.
- Year of the cat (chanson 1976) Al Stewart :
She comes out of the sun in a silk dress running (Elle sort du soleil dans une robe en soie courant)
Like a watercolor in the rain (Comme une aquarelle sous la pluie)
Don’t bother asking for explanations (Ne vous embêtez pas à demander des explications)
She’ll just tell you that she came (Elle te dira juste qu’elle est venue)
In the year of the cat (L’année du chat) - Sad Lisa (chanson 1970) Cat Steven :
Though my love wants to relieve her (Même si mon amour veut la soulager)
She walks alone from wall to wall (Elle marche seule de mur en mur)
Lost in her hall, she can’t hear me (Perdue dans son couloir, elle ne m’entend pas)
Though I know she likes to be near me (Même si je sais qu’elle aime être près de moi)
Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa (Lisa, Lisa, triste Lisa, Lisa) - Le Pont Mirabeau (poème 1912) Guillaume APOLLINAIRE :
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours - Le Cœur supplicié (poème 1871) Arthur RIMBAUD : Mon triste cœur bave à la poupe…
- Amers, Invocations (1957) Saint-John PERSE : Et vous, Mers, qui lisiez dans de plus vastes songes, nous laissiez-vous un soir aux rostres de la Ville, parmi la pierre publique et les pampres de bronze ?
- La Chute de la maison Usher (nouvelle 1839) Edgar Allan Poe
Pauline
- Bad, Bad Leroy Brown (1973) Jim CROCE. Wikipédia nous explique que La chanson parle d’un homme du South Side de Chicago qui, en raison de son attitude et de sa taille imposante, a la réputation d’être le « baddest man in the whole damn town » (l’homme le plus mauvais de cette foutue ville). Un jour dans un bar il fait la connaissance de Doris, une jolie femme mariée à un homme très jaloux. Lors d’une bagarre mémorable, Leroy apprend à ses dépens qu’il ne faut pas convoiter la femme d’un autre. La bagarre avec le mari laisse Leroy à terre comme un puzzle défait avec quelques pièces en moins « Leroy looked like a jigsaw puzzle – With a couple of pieces gone ».
- La Boîte de jazz (1985) Michel Jonasz :
Un peu parti un peu naze
j’descends dans la boîte de Jazz
histoire d’oublier un peu le cours de ma vie
Quetty
- Rubrique-à-brac (série de bande dessinée à partir de 1968 pour Pilote) GOTLIB
- Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) Bartók
- Te V’là (chanson 1969) Robert CHARLEBOIS :
Un puits entre les dents
Des yeux à s’noyer d’dans
Ton coeur en lune de miel
Te v’là
Le blond d’engin de tes cheveux
Ton âme aigrie plein de p’tits cris
Mon wrench pis ton nombril
Pis tes fesses en peau d’castor, wow wow - Chanson pour Marilyn (chanson 1963) Claude NOUGARO :
Quel est le film, le scénario
Qu’il te faut tourner de nouveau
Et dans quel néant s’illumine
Le néon de ton nom, Marilyn - T’en souviens-tu la Seine (chanson 1964) Anne SYLVESTRE :
Je te disais la Seine
Qu’on avait les yeux d’la même couleur
Quand j’avais de la peine
Quand j’égarais mon cœur
Sheyda
- Le Grand Blond avec une chaussure noire (film 1972) Yves ROBERT
Talene
- Amoureux solitaires (1980) LIO :
Eh toi, dis-moi que tu m’aimes
Même si c’est un mensonge - Une petite musique de nuit KV 525 (Sérénade no 13 pour pour quintette à cordes en sol majeur 1787) MOZART
- Les Choses de la vie (film 1970) Claude Sautet (roman de Paul Guimard publié en 1967) : je ne vous en dis pas plus.
Unnveig et Vicky
- Gaby (chanson 1980) Alain BASHUNG :
Ho, Gaby, Gaby, tu devrais pas m’laisser la nuit
J’peux pas dormir, j’fais qu’des conneries
Ho Gaby, Gaby, tu veux qu’j’te chante « La Mer »
Le long, le long, long des golfes
Pas très clairs - Songs of Innocence : The Little Girl Lost (poème 1789) William BLAKE :
In the southern clime, (Dans le climat du sud)
Where the summers prime, (Où les étés sont premiers)
Never fades away: (Ne disparaît jamais)
Lovely Lyca lay. (La belle Lyca était couchée) - Illuminations : Aube (poème 1873) Arthur RIMBAUD :
J’ai embrassé l’aube d’été.
[…]
Au réveil il était midi. - Le Petit Prince (conte 1943) Antoine de SAINT-EXUPERY :
C’était un jardin fleuri de roses.
– Bonjour, dirent les roses.
Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. - Madame Bovary (roman 1857) Gustave FLAUBERT :
Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait de dessous ses draps ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou, et, l’ayant fait asseoir au bord du lit, se mettait à lui parler de ses chagrins; il l’oubliait, il en aimait une autre! on lui avait dit qu’elle serait malheureuse; et elle finissait en lui demandant quelque sirop pour sa santé et un peu plus d’amour.
Zoé
- Le Petit Prince (conte 1943) Antoine de SAINT-EXUPERY :
Quelque chose s’était cassé dans mon moteur, et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. - Siffler sur la colline (chanson 1969) Joe DASSIN :
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue
Zaï zaï zaï zaï
Angèle
- Un long dimanche de fiançailles (roman historique 1991) Sébastien JAPRISOT :
Et pourtant, Kléber m’a dit, plus tard, ce que je devais croire : qu’on prend ce qui vient, au moment où ça vient, qu’on ne lutte ni contre la guerre, ni contre la vie, ni contre la mort, on fait semblant, que le seul maître du monde, c’est le temps.
Barbara
- Le Bateau ivre (poème 1871) Arthur RIMBAUD :
J’ai vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très antiques,
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ; - Alcools : La Chanson du mal-aimé (poème lyrique 1913) Guillaume APOLLINAIRE :
L’époux royal de Sacontale
Las de vaincre se réjouit
Quand il la retrouva plus pâle
D’attente et d’amour yeux pâlis
Caressant sa gazelle mâle - La cabane du pêcheur (chanson 1994) Francis CABREL (parodiée en 2002 par Laurent Gerra avec la chanson intitulée Ma Cabane au fond du jardin):
Moi, j’attends que le monde soit meilleur
Là, dans la cabane du pêcheur
Charlotte
- Lolita (roman 1955) Vladimir NABOKOV :
Un pavé de glace bleue à la place du cœur, une pilule sur la langue, et le poids de la mort dans la poche arrière de mon pantalon, je pénétrai d’un pas souple dans une cabine de Coalmont (« Ah-ah-ah » cria la petite porte). - Les Enfants terribles (roman 1929) Jean COCTEAU :
Elle sentait que l’air de la chambre était plus léger que l’air. Le vice n’y aurait pas résisté davantage que certains microbes à l’altitude. - Les Valseuses (film 1974) Bertrand BLIER (roman éponyme 1972) :
Bon, bah, elle s’appelle Marie-Ange. C’est notre fille à tous les deux. Et maintenant à tous les trois, elle est prévenue, elle est d’accord. C’est pas une déesse, mais au lit, y’en a des plus mauvaises. Y’a un seul emmerdement, autant que tu sois prévenu tout de suite, c’est qu’elle prend jamais son pied. Alors si tu la sens un peu inerte et silencieuse, faut pas te biler, c’est sa nature. Nous, ça fait des semaines qu’on essaye de la réveiller, c’est le bide. Toujours le bide.
Daphné
- Quelque chose de Tennessee (chanson écrite par Michel BERGER 1985) Johnny HALLYDAY : elle rend hommage au dramaturge américain Tennessee Williams (Une chatte sur un toit brûlant) : À vous autres, hommes faibles et merveilleux qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu ! Il faut qu’une main, posée sur votre épaule vous pousse vers la vie…
- À la recherche du temps perdu (1919) : À l’ombre des jeunes filles en fleurs (roman) Marcel PROUST :
Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu’est l’amour, et la sorte de création que c’est d’une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde, et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. - Wikipédia nous dit que Tristan et Iseut est un mythe littéraire médiéval dont les poètes normands, auteurs des premières versions écrites conservées de cette légende, ont situé l’action en Cornouailles, en Irlande et en Bretagne. À l’origine, l’histoire est une tragédie centrée sur l’amour adultère entre le chevalier Tristan (ou Tristram) et la princesse Iseut (ou Iseult, Yseut, Yseult, Isolde, Ysolde). Elle précède la légende arthurienne de Lancelot du Lac et de Guenièvre, qui en est probablement inspirée, et a influencé durablement l’art occidental (peinture, littérature, etc.) depuis qu’elle est apparue au XIIe siècle :
Seigneurs, vous plaît-il d’entendre un beau conte d’amour et de mort ? C’est de Tristan et d’Iseut la reine. Écoutez comment à grand’joie, à grand deuil ils s’aimèrent, puis en moururent un même jour, lui par elle, elle par lui. - Le Hareng saur (poème 1872) Charles CROS :
Et, depuis, le hareng saur — sec, sec, sec,
Au bout de cette ficelle — longue, longue, longue,
Très lentement se balance — toujours, toujours, toujours. - Midnight Express ou L’Express de minuit au Québec (film 1978) Alan PARKER : il s’inspire de l’histoire de William Hayes, arrêté et emprisonné en Turquie en 1970, qui avait raconté son histoire dans le livre autobiographique Midnight Express (1977).
Élodie
- Un long dimanche de fiançailles (roman historique 1991) Sébastien JAPRISOT :
Et pourtant, Kléber m’a dit, plus tard, ce que je devais croire : qu’on prend ce qui vient, au moment où ça vient, qu’on ne lutte ni contre la guerre, ni contre la vie, ni contre la mort, on fait semblant, que le seul maître du monde, c’est le temps. - Fables de La Fontaine : Le Corbeau et le Renard (1668) Jean de LA FONTAINE. Wikipédia nous dit qu’il existe deux sources à cette fable : la version d’Ésope (Le Corbeau et le Renard) et celle du fabuliste latin Phèdre (Macédoine – 10 av. J.-C. – vers 54 apr. J.-C., auteur de vingt-trois fables imitées d’Esope). La version de Phèdre (Livre I, 13) a été traduite en français par Sacy en 1647. Cette fable apparaît également dans la quatrième aventure du Roman de Renart, où Tiecelin le Corbeau, qui avait dérobé un fromage à une vieille dame, s’en fait dépouiller par la ruse de Renart.
Maître renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau… » - Fables de La Fontaine : Le Loup et l’Agneau (1668) Jean de LA FONTAINE :
C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge. - OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (film 2006) Michel HAZANAVICIUS :
– Nous avons besoin de vous sur place. Un Expert. Un spécialiste du monde Arabo-Musulman. Cherchez ce qu’avait découvert Jefferson et trouvez qui l’a tué. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde. Américains, Soviétiques, Anglais. Confortez les positions de la France, instaurez la paix en Égypte, sécurisez le Proche-Orient.
– Pas de problème.
Fabienne
- Mensonge romantique et vérité romanesque (essai 1978) René GIRARD :
Le triangle réapparaît toutes les fois que Stendhal parle de vanité, qu’il s’agisse d’ambition, de commerce ou d’amour. (…)
Pour qu’un vaniteux désire un objet il suffit de le convaincre que cet objet est déjà désiré par un tiers auquel s’attache un certain prestige.
Gerda
- L’Exorciste (roman 1971) William Peter BLATTY :
— Il est dit que le démon agit contre la volonté de la victime.
— Oui, effectivement, Il n’y a pas péché dans l’état de possession. - Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire orale française (XIVe siècle) qui a connu de nombreuses versions au cours de l’histoire et selon les pays où il a été repris, nous dit Wikipédia. On dénombre une centaine de variantes du conte. La plus ancienne version retranscrite et figée est celle de Charles Perrault, parue dans Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités (1697). Cette version est plus malheureuse et plus moralisatrice que celles qui suivront :
Le petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé.
Hermine
- Compartiment tueurs (roman 1962) Sébastien JAPRISOT (anagramme de Jean-Baptiste ROSSI) :
Le tort qu’elle avait c’était de toujours penser qu’on allait lui reprocher quelque chose. Elle savait bien quoi et qu’en outre c’était faux. La femme qui se raccroche à sa jeunesse en se payant du bon temps. Cette misère qu’on appelle le péché. L’ogresse du retour d’âge. Le démon de midi et quart. Elle avait été mariée vingt ans, avec un homme qu’elle n’avait jamais trompé, qui avait toujours vécu malade, qui était à peine moins présent, maintenant, dans son cadre sur la commode de la chambre. - La Fièvre du Samedi Soir (film 1977) John BADHAM : Night Fever (chanson de la bande originale) Barry Gibb des Bee Gees :
Sweet city woman (Douce femme de la ville)
She moves through the light (Elle se déplace à travers la lumière)
Controlling my mind and my soul (Contrôlant mon esprit et mon âme)
When you reach out for me (Quand tu me tends la main)
And the feelin’ is right (Et le sentiment est bon) - Fontaine et Areski est un groupe de musique français des années 1970, composé de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem.
- Higelin ’82 : Encore une journée d’foutue (chanson 1982) Jacques HIGELIN :
Je ne sais pas ce qu’il m’a pris ce matin
Quand je me suis réveillé
Je me voyais déjà parti sur un voilier
Dans les pays lointains
Au bord d’une plage avec une belle fille
Qui m’bat à la nage et qui me déshabille
Pendant que j’gambille
Autour d’un poisson chat
Est-ce que t’entends ce que je vois ?
Julia
- Subway (film 1985) Luc BESSON avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert :
Tu pourrais sourire un peu.
Quand je souris, ça me donne envie de vomir, qu’est-ce que tu préfères ? - Le Cinema (album et chanson 1962) Claude NOUGARO :
Sur l’écran noir de mes nuits blanches
Moi je me fais du cinéma
Sans pognon et sans caméra
Bardot peut partir en vacances
Ma vedette c’est toujours toi
Pour te dire que je t’aime rien à faire, je flanche
J’ai du cœur mais pas d’estomac
C’est pourquoi je prends ma revanche
Sur l’écran noir de mes nuits blanches
Où je me fais du cinéma
Leïla
- Pornokrates. Une femme nue, en bas, les yeux bandés, est tirée par un cochon qu’elle tient en laisse – Tableau pornographique de Félicien ROPS (1833-1898)
- Alcool : Nuit rhénane (poème 1913) Guillaume Apollinaire :
Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme
Écoutez la chanson lente d’un batelier
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds - Ma Bohème (poème 1870) Arthur RIMBAUD :
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées ! - Une saison en enfer (poème 1873) Arthur RIMBAUD :
Je lui faisais promettre qu’il ne me lâcherait pas. Il l’a faite vingt fois, cette promesse d’amant. C’était aussi frivole que moi lui disant : Je te comprends. - Les Fleurs du mal : L’Albatros (poème 1861) Charles BAUDELAIRE :
Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
Margot
- La République : allégorie de la caverne (philosophie 387-370 av. J.-C.) PLATON : Wikipédia nous dit qu’elle expose en termes imagés les conditions d’accession de l’humain à la connaissance du Bien, au sens métaphysique du terme, ainsi que la transmission de cette connaissance. L’allégorie met en scène des humains enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l’entrée et voient non pas des objets, mais les ombres des objets qui sont projetées contre le mur. Ils croient voir la vérité, alors qu’ils n’en voient qu’une apparence.
- Premiers Analytiques (philosophie) Aristote ((384-322 av. J.-C.) : exposent les règles et les formes du syllogisme en général. Un syllogisme est un raisonnement déductif rigoureux qui, ne supposant aucune proposition étrangère sous-entendue, lie des prémisses à une conclusion (exemple « si tout bée état et si tousser eh bé, alors tousser état »).
Nadège
- Suites pour violoncelle seul (1717-1723) Jean-Sébastien BACH :
Paul TORTELIER : https://www.youtube.com/watch?v=qUPkSMlcV9A
Odile
- Othello ou le Maure de Venise (tragédie 1603) William SHAKESPEARE :
IAGO : Oh ! Le lâche !… Voilà quatre fois sept ans que je considère le monde ; et, depuis que je peux distinguer un bienfait d’une injure, je n’ai jamais trouvé un homme qui sût s’aimer. Avant de pouvoir dire que je vais me noyer pour l’amour de quelque guenon, je consens à être changé en babouin. - RODERIGO : Que faire ? J’avoue ma honte d’être ainsi épris ; mais il ne dépend pas de ma vertu d’y remédier.
Pierrette
- IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ETOILES (poème 1917) Guillaume APOLLINAIRE :
Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d’automne
Comme la mémoire s’éteint dans le cerveau
De ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir - Clown (poème 1939) Henri MICHAUX :
Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.
Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler.
D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînement « de fil en aiguille ».
Quentine
- Au-delà des grilles (Le mura di Malapaga) (film 1948-1949) René CLÉMENT : Pierre (Jean GABIN), meurtrier de sa maîtresse infidèle, arrive à Gênes où il rencontre Marta (Isa MIRANDA), une serveuse de restaurant. Entre eux se noue une brève idylle chargée de menaces, car Marta a une petite fille, Cecchina, dont la jalousie confine à la haine.
- La vie ne vaut rien (chanson 2001) Alain SOUCHON :
La vie ne vaut rien, rien
La vie ne vaut rien
Mais moi quand je tiens, tiens
Mais moi quand je tiens
Là dans mes deux mains éblouies
Les deux jolis petits seins de mon amie
Là je dis rien, rien, rien
Rien ne vaut la vie
Renée
- La chambre de mariage (film 1987) Bilge OLGAC
- Méditations poétiques : Le Lac (poème 1820) Alphonse de Lamartine :
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ? - Les Lumières de la ville (film 1931) Charlie CHAPLIN
- Le Lac des cygnes (musique 1871 et ballet 1877) Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI (livret de Vladimir Begitchev inspiré d’une légende allemande) :
Wikipédia raconte assez mal que le jeune prince Siegfried fête sa majorité et que sa mère, la reine, lui annonce que, le jour suivant, au cours d’un grand bal pour son anniversaire, il devra choisir une future épouse. Vexé de ne pouvoir choisir celle-ci par amour, il se rend durant la nuit dans la forêt où il rencontre la jeune et belle princesse Odette, la princesse cygne. Un terrible sorcier, nommé Rothbart, lui a jeté un sort : le jour, elle est transformée en cygne blanc et, la nuit, elle redevient femme. - Les portes de la nuit (film 1946) Marcel CARNÉ, avec Les enfants qui s’aiment (chanson de Jacques PRÉVERT et Joseph KOSMA) :
Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l’éblouissante clarté de leur premier amour. - Au revoir les enfants (film 1987) Louis MALLE :
Jusqu’à ma mort je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. - Les saisons du plaisir (film 1988) MOCKY avec la chanson Les saisons du plaisir (Mimi Perrin et Gabriel Yared) :
Les saisons du plaisir nous entrainent dans la ronde
Le secret vraiment c’est d’savoir les saisir
Tant qu’il est temps pour prendre du bon temps - Le Bateau ivre (poème 1871) Arthur RIMBAUD :
Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !
Solange
- Fables de La Fontaine : Le Loup et l’Agneau (1668) Jean de LA FONTAINE :
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
Vania
- Le derrière (film 1999) Valérie LEMERCIER :
Et c’est quoi cette matière invraisemblable ? - Le Parti pris des choses (recueil de poèmes en prose 1924-1939) Francis PONGE :
Qu’on s’en persuade : il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poètes. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu’on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d’hommes nous force à prendre part.
Wanda
- Mon cœur avait raison : Sapés comme jamais (chanson 2015) GIMS :
Sapés comme jamais
Sapés comme jamais
Loulou’ et ‘Boutin (bando)
Loulou’ et ‘Boutin (‘Boutin na ‘Boutin)
Coco na Chanel (Coco)
Coco na Chanel (Coco Chanel)
Xuân
- Les Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmy ses papiers (philosophie 1670) Blaise PASCAL (1623-1662) :
La nature de l’amour-propre et de ce moi humain est de n’aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne sauroit empêcher que cet objet qu’il aime ne soit plein de défauts et de misères : il veut être grand, et il se voit petit ; il veut être heureux, et il se voit misérable ; il veut être parfait, et il se voit plein d’imperfections ; il veut être l’objet de l’amour et de l’estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu’il soit possible de s’imaginer ; car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend, et qui le convainc de ses défauts. Il désireroit de l’anéantir, et, ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit, autant qu’il peut, dans sa connoissance et dans celle des autres ; c’est-à-dire qu’il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même, et qu’il ne peut souffrir qu’on les lui fasse voir, ni qu’on les voie. - La Loi du désir (film 1987) Pedro ALMODOVAR :
A l’image du désir, d’aucuns disent que ce film a mal vieilli.
Y : et l’homosexualité dans tout ça ?
- Blake et Mortimer (série de bande dessinée 1946) Edgar P. Jacobs : Wikipédia nous dit (et il faut le croire) que la série raconte les aventures du capitaine Francis Blake, un ancien pilote de la Royal Air Force devenu directeur du MI5, le service britannique de contre-espionnage, et de son ami le professeur Philip Mortimer, un spécialiste en physique nucléaire et l’un des plus éminents scientifiques du Royaume-Uni. Les deux héros se retrouvent souvent confrontés à leur ennemi juré, le colonel Olrik, un criminel de classe internationale ne considérant que son intérêt personnel.
- Salvador Dalí (1904-1989) : peintre de génie monarchiste, pratiquant l’exhibitionnisme rémunérateur.
- Hitler (1889-1945) : peintre sans génie totalitaire, pratiquant l’exhibitionnisme exterminateur.
- La guerre des Gaules (Notes 58-52) Jules César :
César, instruit de ces évènements, et redoutant la pusillanimité des Gaulois, car ils changent facilement d’avis et sont presque toujours séduits par ce qui est nouveau, estima qu’il ne devait se reposer sur eux de rien. - Richard Cœur de Lion : Pendant son règne, qui dura dix ans (de 1189 à sa mort en 1199), il ne séjourna que quelques mois dans le royaume d’Angleterre et n’apprit jamais l’anglais.
- Napoléon à Joséphine : Quand tu m’écris, le peu de mots, le style n’est jamais d’un sentiment profond. Tu m’as aimé par un léger caprice ; tu sens déjà combien il serait ridicule qu’il arrête ton cœur. Il me paraît que tu as fait ton choix et que tu sais à qui t’adresser pour me remplacer.
- Isaac Newton : Les corps qui se touchent exercent les uns sur les autres une pression égale.
- Léonard de Vinci : Regarde attentivement car ce que tu vas voir n’est plus ce que tu viens de voir.
- Le Petit Prince (conte 1943) Antoine de SAINT-EXUPERY :
C’était un jardin fleuri de roses.
– Bonjour, dirent les roses.
Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. - La vie est un long fleuve tranquille (film 1988) Étienne CHATILIEZ :
– Mais madame j’vous jure qu’j’ai jamais couché avec un garçon !
– Marie-Thérèse ne jurez pas je vous en prie ! - La Complainte du petit cheval (poème 1908) Paul FORT :
Sa voiture allait poursuivant
Sa belle petite queue sauvage.
C’est alors qu’il était content,
Eux derrière et lui devant ! - Nathalie (chanson 1964) Gilbert BÉCAUD (paroles de Pierre Delanoë) :
Elle parlait en phrases sobres
De la révolution d’octobre - Les Fleurs du mal : Spleen (poème 1857) Charles BAUDELAIRE :
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; - Les Bronzés font du ski (film 1979) Patrice LECONTE :
Si tu veux un conseil, oublie que t’as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Les prénoms et leurs significations
- Andrée : Rêveuse et enthousiaste
- Bernadette : Courageuse et fragile
- Camille : Passionnée
- Danièle : Téméraire
- Emilie : Douce
- Faustine : Un cœur d’artichaut
- Géraldine : N’aime pas la solitude
- Hélène : Amoureuse
- Ida : Travailleuse
- Jocelyne : Energique
- Karen : Gentille
- Laure : Charmeuse
- Marie : Tendre
- Nelleke : Intrépide
- Ornella : Charmeuse
- Pauline : Sens de la mise en scène
- Quetty : En quette d’attention
- Rose : Eloquente
- Sheyda : Bienveillante
- Talene : Chalengeuse
- Unnveig : Celle qui esquive
- Vicky : Victorieuse
- Withney : L’île blanche
- Xena : L’étrangère
- Yvette : Consciencieuse et sévère
- Zoé : Hypersensible
- Angèle : Déterminée
- Barbara : Etrangère à elle-même
- Charlotte : Bonne étoile
- Daphné : Romantique
- Élodie : Aventureuse
- Fabienne : A fleur de peau
- Gerda : Réconfortante
- Hermine : Soldat
- Iolanda : Modeste
- Julia : Descendante d’Aphrodite qui décide de sa vie
- Katie : Pure
- Leila : Née pendant la nuit
- Margot : Perle discrète
- Nadège : Espérance en l’attente
- Odile : Acharnée
- Pierrette : Petit caillou
- Quentine : Timide
- Renée : Renaissance
- Solange : Solennelle
- Thérèse : Qui récolte
- Ulka : Idéaliste
- Vania : Papillon
- Wanda : Branche fine – étourderie
- Xuân : Printemps